
Diaoulé Karamoko
Editions Pierre Tisné. Paris. 1939. 248 p.
Parti le 2 août pour Bobo Dioulasso, le 4 au soir, j'ai rattrapé à Bari Audéoud qui rentrait de reconnaissance. Ils ont énormément trotté dans la colonne que le commandant Pineau a dirigée dans le sud, après la prise de Sikasso et n'ont pas vu un sofa. Vers la fin de juin, les auxiliaires de la colonne de Sikasso ont tous été licenciés et les officiers répartis dans'différents postes de la région, de sorte que je ne sais trop où je vais aller. D'une part on m'a réclamé à l'Est-Macina; d'autre part, le capitaine de Montguers malade veut rentrer. J'ai bien peur de le remplacer à Diébougou. Le commandant ne s'est pas prononcé. Je suis entre deux situations qui ne me sourient ni l'une ni l'autre. Que vais-je devenir dans tout cela ? Et mes couiriers de France qui courent je ne sais où !
Le 12 août au matin, je fume mélancoliquement une cigarette, assis devant la case qu'on m'a donnée dans la cour spacieuse du poste et je vois entrer un courrier, c'est-à-dire un homme portant un sébé 1 au bout d'une baguette. Un tirailleur de garde le conduit dans la case du commandant. Le planton du commandant sort et va appeler un lieutenant, mon voisin, qui se rend chez le chef, y reste quelques minutes et sort. Le planton vient alors chez moi :
— Le commandant te demande, mon cap'taine.
J'arrive, assez intrigué par ces allées et venues. Le commandant à brûle-pourpoint :
Voulez-vous aller à Touba ?
J'esquisse un point d'étonnement et d'interrogation. Il me montre une dépêche du colonel Audéoud lui prescrivant d'envoyer cent des tirailleurs réguliers de la compagnie de Sikasso à Touba, c'est-à-dire en plein sud. Comme le capitaine Coiffé, de la 15e, qui a pris part à l'assaut de Sikasso, est resté commandant du poste, le commandant m'offre le commandement de ce détachement et ajoute :
— Quand pouvez-vous partir ?
— Mon commandant, immédiatement ; je n'ai pas de gros bagages.
Cette bienheureuse dépêche, c'est la continuation de la vie de colonne. C'est le commandement de tirailleurs réguliers que je n'osais espérer. Et il s'agit d'une région nouvelle : le sud à explorer. Enfin, cela me rapproche de Samory qu'on dit réfugié dans l'Extrême-Sud. Sans doute ce voyage de sept à huit cents kilomètres au cours de l'hivernage du sud sera dur, qu'importe !
— Et bien, répond le commandant Pineau, faites vite vos paquets, car le détachement part de Sikasso aujourd'hui même. Vous avez cent soixante dix kilomètres à rattraper.
A 2 heures, je serrais la main des camarades et : en route ! Ma maison militaire : mon boy Diallo, mon palefrenier Youssoufi, mon ordonnance Kaba Koné sont moins satisfaits que moi.
Bonne route, sans trop de pluie, sans autre difficulté que le pas, sage de la Volta. Pas de pirogues, un mètre cinquante d'eau, du courant et surtout des berges hautes de six mètres, terriblement glissantes par suite des pluies. Je déjeune en route avec les spahis qui hivernent dans une ancienne ferme de Babemba. « Ils me donnent un bon cheval et je gagne Sikasso au galop, ce qui me permet de vous écrire ce mot, après avoir préparé mon départ pour demain matin. Je vous écris du fameux château de Babemba, dont on a dû abattre un étage trop ébranlé par nos obus. Sikasso se repeuple; on y a tracé de grandes artères avec la poudre de Babemba. La ville et la grande plaine sont bien tristes, ce soir sous la buée des grandes pluies d'hivernage. »
Quitté Sikasso le 17 août au matin, avec six hommes d'escorte par un temps lamentable. Je comptais partir à 5 heures, mais il pleuvait tellement qu'on n'a pu trouver les porteurs qu'à une heure avancée de la matinée. Rien de triste comme ces immenses cuvettes noyées sous la pluie. Une rivière débordée "s a pris plus de deux heures, la pluie était froide; la rivière était chaude; sur une autre il a fallu faire une passerelle. En arrivant trempés-mouillés à un petit village, noyé dans la végétation, nous avons l'air de naufragés. On a beaucoup de peine à allumer le feu avec du bois humide. Cela ne sera pas commode d'avoir des vêtements secs pour le lendemain matin.
Le 20, nous voici de retour à Tiong'i, où j'ai touché, en 1896. C'est un petit détour, pour éviter les grandes inondations de la Bagoé. Babemba a détruit la ville. Ce n'est plus qu'une ruine envahie par les hautes tiges de maïs. Tombées aussi les tours qui donnaient un vague air de forteresse du Moyen âge. J'ai grand peine à trouver une case pour passer quelques heures de la journée et être le lendemain à Tengréla. Autres ruines. Tous ces villages étaient bien construits ; maisons de maçonnerie, rues percées, ce n'est pas le dédale des cases des villages ordinaires. Quelques rares réfugiés rentrent petit à petit depuis que les troupes françaises descendent vers ces malheureux pays, trop tard ! Si notre colonne mobile de Bougouni avait marché, nous les auriions sauvés et Monteil aurait sauvé Kong.
Je savais par le docteur Collomb, de Kita, qu'un de ses amis, le docteur Crozat, mé de cin explorateur entré le premier à Tengréla après René Caillié y était mort. Je passe mon temps à graver sur une croix faite de deux planches le nom du docteur. La soirée est pluvieuse, le vent siffle en tempête dans la longue rue de Tengréla encombrée de débris. Pauvre Crozat! Le lendemain, au départ sous la pluie, toujours, je fais rendre les honneurs à sa tombe par ma petite escorte.
Le soir du 22 août rejoint à Tokola le détachement conduit par trois sous-officiers. Nous continuons à descendre à fortes étapes, en suivant vaguement l'itinéraire de René Caillié.
Le 25, nous entrons dans la région montagneuse et campons dans un village perdu sur les hauteurs. C'est un plaisir d'avoir quitté les basses plaines inondées et de monter. Malgré une heure de grosse chaleur, on sent le vent frais du col, des ruisseaux chantent, l'horizon s'élargit. Le ciel est clément. La descente sur de grandes dalles de grès inclinées à 40 degrés est difficile; chutes nombreuses. J'y éreinte un cheval. Puis c'est une rude étape, dans une haute brousse où le chemin serpente à l'infini. Au moment où nous traversons un chemin plan, dur, foulé, je demande au guide où mène le chemin que nous laissons à droite : « ça, c'est le chemin des éléphants ». Dommage que la mission nous emmène au sud, alors que « le chemin des éléphants » s'en va vers l'ouest. Encore une étape : dans la soirée un mot du résident d'Odienné me prescrit de quitter la route de Touba pour marcher sur Beyla.
Le 27, après une rude et belle étape dans la montagne, nous sommes à Timé. C'est là, en 1827 que s'était abattu, miné par le scorbut, les pieds écorchés et infectés, René Caillié, le petit savetier Vendéen de Mauzé, studieux et solitaire qui, dès sa jeunesse, s'était enflammé comme tant d'autres pour la mystérieuse Afrique. Après les guerres de l'Empire, l'attention avait été attirée sur l'Afrique et sur Tombouctou. René Caillié à seize ans part pour La Rochelle avec seize francs dans sa poche, fruit d'une collecte du village. Il se glisse à bord d'un bateau, comme domestique pendant la traversée, aux gages de dix-huit francs par mois. Il voyage pendant plusieurs années sur la côte d'Afrique, apprenant la langue, les usages, mais sans perdre son but de vue. Il travaille dans les factoreries anglaises de Sierra Leone. Son plan est de se confondre avec les marabouts qui se joignent aux caravanes. Il finit par économiser deux mille francs et le voilà parti pour l'intérieur. Il passe pour un Musulman, il lui faut chaque jour déjouer la méfiance de ses compagnons et trouver moyen, on ne sait comment, d'écrire quelques notes sur des feuillets de papier introduits entre les pages de son Coran. Il réussit à atteindre le Niger. Il passe cinq mois à Timé, couché par terre, entre la vie et la mort. Il est sauvé par une vieille femme noire qui l'a pris en pitié, comme un enfant, et qui le soutient avec de l'eau de riz. Enfin la jeunesse l'emporte et il repart. Il arrive à Djenné, s'embarque et atteint Tombouctou : son but, après un an de voyage et de souffrances. C'est un des plus remarquables exemples d'opiniâtreté qui soient connus. Quelle énergie surhumaine il lui a fallu pour se relever à Timé, traverser tout le Soudan, le Sahara et l'Algérie !
En se dirigeant vers le gros centre d'Odienné, il faut passer le Baoulé de Bougouni. A cette époque de plein hivernage, c'est un fleuve de trois cents mètres. Il y a bien un pont, mais il est en partie sous l'eau. Il faut donc se déshabiller et tâtonner du pied avec soin pour trouver sous l'eau les rondins qui forment le tablier. De l'autre côté du pont m'attend Moriba Touré, le chef d'Odienné, grand bel homme avec lequel j'étais en bonnes relations du temps de Bougouni. Encore deux ou trois ponts à franchir et je trouve à Odienné un des plus vieux Soudanais, le capitaine Conrard, quatorze ans et demi clé séjour depuis 1882, les griots chantaient ses louanges dans tout le Soudan.
Nous sommes à Beyla le 4 septembre. C'est le siège du « chef-lieu » modeste de la région sud. Le commandant de Lartigue nous attendait impatiemment. Dans son rapport, il écrira : « Le détachement a exécuté une marche remarquable de vitesse ; mais les hommes se ressentent de cette allure rapide : douze malades se présentent à la visite, tous blessés aux pieds. Il était donc nécessaire de leur donner quelques jours de repos. »
Quelle était à ce moment la situation générale dans la région sud ?
Sikasso était tombée le 15 mai; les troupes victorieuses sous les ordres du commandant Pineau étaient descendues vers le sud. Un parent de Babemba, Fô, qui jadis pendant le siège de Kinian avait failli faire disparaître le capitaine Marchand dans un incendie de camp, est venu trouver Samory à Bori Bana. Le tableau qu'il lui a fait de la force de la colonne Pineau a été tel que l'Almamy effrayé s'est résolu à quitter sa résidence. Au reste, ses plus intimes conseillers, ses compagnons d'enfance, tous originaires des pays de l'ouest, ne demandaient qu'à y retourner. Dans l'ouest, dans le pays Toma en particulier, Samory avait toujours conservé un de ses lieutenants qui lui faisait parvenir les armes et munitions qu'il achetait à Sierra Léone. Les Tomas ayant tué le lieutenant Lecerf en 1894, et en 1898 MM. Bailly et Pauly, chefs de missions, ne pouvaient être que disposés à recevoir l'Almamy.
Il avait ordonné la concentration générale de tout son monde à Séguéla, vers le 15 juin.
Il disposait alors de 4.000 sofas armés de fusils à tir rapide, 8.000 possédant d'autres armes; les uns et les autres constituant les bandes organisées, et 2.000 cavaliers. En outre, il traînait avec lui 120.000 hommes, femmes, enfants, captifs, parmi lesquels 8.000 armés de fusils à pierre et marchant en dehors de toute bande. C'était les populations du Ouassoulou qu'il avait forcées de le suivre lorsqu'il avait du chemin et surtout ses marigots vaseux, où l'on enfonce jusqu'au genou. Il y en a tant et tant qu'on ne se déshabille plus.
« Le 17 septembre, nous entrons dans le pays des anthropophages. Ils en ont bien l'air avec leur tête dure, barbue, et surtout leurs énormes couteaux de boucher, qui leur servent à se frayer un chemin dans la forêt vierge et à d'autres besognes encore ! Les villages ne sont plus ceux du Soudan. Serrés, étouffés par l'immense forêt, les cases sont petites, faites de nervures de palmes.
La piste continue aussi difficile, le passage se complique du fait que nous croisons les gens qui se sont rendus à Woelffel et qui remontent vers leur ancien pays.
A Nzô, le 21 septembre, nous retrouvons mon vieil ami le capitaine Gaden et le lieutenant Woelffel avec trois cents tirailleurs. Nzô est un petit village, perdu dans la forêt vierge et habité par une peuplade anthropophage, les Guérés. Il y a là près de quatre cent cinquante tirailleurs concentrés. On est plutôt serré. Il pleut continuellement.
Le contact est perdu avec les bandes de Samory. Les Guérés de la rive droite du Diougou, dont Woelffel a tiré si bon parti, ne peuvent nous donner aucun renseignement sur la rive gauche, qui est le pays Dioula. Gaden réussit à grand'peine à trouver trois Dioulas, mais ils ne peuvent rien dire de précis : ils nous montrent au sud-est les montagnes boisées, noyées sous la pluie ; Samory est là, dans ce pays mystérieux ; il a construit, disent ses gens, des diassas 2; mais que veut-il ? Les uns disent qu'il veut s'y faire tuer avec ses femmes, ses fils et ses fidèles; d'autres, qu'il n'a pas renoncé à passer le Diougou plus au sud, pour continuer sa marche vers l'ouest ; d'autres enfin qu'il fait chercher une route pour retourner vers les pays de l'est, d'où il est venu.
Wœlffel marche avec peine, appuyé sur un bâton, par suite d'une plaie envenimée par ces marches continuelles dans les marécages, mais son visage rayonne de son magnifique succès de Tiafesso. Gaden est plus maigre et plus solide que jamais. Georges Mangin, son lieutenant est le frère du fameux capitaine Charles Mangin, si connu dans tout le Soudan, avant qu'il allât conduire ses hommes à travers l'Afrique à Fachoda, et plus tard lancer la victorieuse offensive du 18 juillet 1918. Ils sont navrés tous les trois de n'avoir pu, faute de vivres, poursuivre Samory après Tiafesso. Malgré l'activité déployée par le commandant de Lartigue depuis qu'il a pris le commandement de la région sud, les distances, les difficultés sont telles en cette saison de pluies continuelles, que Wœlffel et Gaden ont dû vivre presque au jour le jour.
23 septembre. — A 2 heures, le commandant me fait appeler; il se décide, ne pouvant faire vivre sa troupe dans ce pays ruiné, à envoyer sur la rive gauche du Diougou une reconnaissance, et il m'en donne le commandement par l'ordre suivant :
Ordre N° 437
Une reconnaissance composée : du détachement de la 15e compagnie, à l'effectif de 96 hommes, commandée par le capitaine Gouraud, avec le sous-lieutenant Mangin, adjudant Brail, sergent maire, de la 36 compagnie d'auxiliaires, 112 hommes commandés par le capitaine Gaden, avec le lieutenant Jacquin, sergents Lafon et Bratières, partira demain 24 septembre pour Dénifesso en suivant la route Nzô, Guétoukoro, Kourogouodougou, Guikoura, Niaralassou, Dénifesso.
Cette reconnaissance a pour mission de poursuivre Samory partout où elle le rencontrera, et de le rejeter de préférence vers le sud ou vers l'ouest. Dans le cas où le capitaine Gouraud, commandant la reconnaissance, viendrait à refouler Samory vers le Diougou, il en préviendrait immédiatement le détachement resté à Nzô, qui se porterait sur la rive droite de ce fleuve pour s'opposer au passage.
Quelle Joie !
Le docteur Boyé accompagne la petite colonne. En toute 9 Européens, 212 tirailleurs, 50 porteurs pour une ou deux cantines par Européen, quinze jours de vivres (biscuit, vin, endaubage) pour les Blancs, 10 caisses de cartouches de réserve et une caisse de pétards de fulmi-coton. Les tirailleurs portent 150 cartouches et quinze jours de riz — pas de viande pour eux. Nous sommes tous à pied, condition exceptionnelle au Soudan ; mais la marche sur Nzô nous a démontré le peu de service que rendent les chevaux dans ce pays impossible et le temps qu'ils font perdre dans les mauvais passages.
Ma lettre à mes parents, en date de Nzô, 23 septembre, à la veille du départ se termine ainsi : « Demain, je dirai l'à Dieu vat ! des marins, et nous nous enfoncerons dans cet océan de montagnes et de forêts où s'abrite notre vieil ennemi. Où ? L'on n'en sait rien ! Et il faudra d'abord le trouver ! »
24 septembre. — Départ à 6 heures du matin. La reconnaissance franchit le Diougou sur un énorme tronc d'arbre, et à 9 heures nous trouvons, à Guiro, les traces du passage récent des sofas. Des squelettes sont couchés dans les cases, autour de feux éteints; le pays est vide. C'est la grande forêt vierge avec ses difficultés de marche et sous la pluie.
La pluie. — Nous arrivons vers 2 heures de l'après-midi à Kourogouodougou: personne, que les cadavres étendus dans les cases. Pour nous mettre à l'abri, il faut démonter les toits coniques des cases et les placer sur le sol, en y découpant une ouverture pour s'y glisser. La question des guides se pose, car on voyage peu chez ces peuplades anthropophages, toujours en guerre, et nos trois Dioulas ne connaissent pas le pays au delà du prochain village, Guikoma. J'envoie en avant le fidèle Dia Fodé, vieux chef sofa rompu à ces guerres, qui a fait sa soumission en 1893, et nous est tout dévoué. Avec quelques tirailleurs déguisés en sofas, ce qui n'est pas difficile, car la tenue de nos hommes n'a plus rien de règlementaire, il doit chercher à arrêter quelques indigènes, avant que l'arrivée de la colonne ne les ait fait fuir.
25 septembre. — Nous sommes à 8 heures toujours sous la pluie, à Guikoma. Il est inutile de pousser plus loin l'aventure. Ce n'est qu'à 4 heures que Dia Fodé nous ramène trois anthropophages complètement abrutis, dont il est impossible de rien tirer au sujet de Samory, mais qui pourront nous conduire à Dénifesso.
26 septembre. — Départ à 5 heures. A 7 heures dans les ruines de Niaralassou, nous trouvons le premier fugitif de Samory, une femme, qui nous dit que l'Almamy passe en ce moment même à Dénifesso. Bien que connaissant la folle imagination des Noirs, qui leur fait inventer à plaisir des choses extravagantes — et encore, est-ce particulier aux Noirs ? — nous hâtons la marche à tout hasard, à travers un dédale de collines rocheuses nues et de bas-fonds boisés, pour arriver à 9 heures à Dénifesso. Nous n'y trouvons qu'une centaine de fugitifs pelotonnés les uns contre les autres, sous la pluie.
Ces gens ont quitté Samory depuis l'affaire de Tiafesso du 9 septembre, et ils tournent à l'aventure dans la forêt, vivant de racines. Pas un habitant dans le village, qui d'ailleurs est complètement rasé ; on ne distingue plus que l'emplacement circulaire des cases. Allons-nous donc perdre encore la journée à la recherche de guides imbéciles comme ceux d'hier ? Heureusement notre petite pointe de tirailleurs déguisés qui bat la brousse aux abords du village, arrête et ramène un grand sofa borgne, vigoureux, et armé d'un fusil à tir rapide. Cet homme interrogé déclare qu'il a quitté, il y a trois jours, les femmes de Samory dans un diassa au sud-est, et que l'almamy était dans un campement à côté. Il ajoute qu'il est impossible de suivre le chemin par lequel il est venu, parce qu'il y a trop de cadavres, que ça sent trop mauvais !
Pour exécuter le plan du commandant, pour tourner Samory, il faut évidemment savoir où il est, et nous risquons fort, dans ce pays inconnu et vide, de manger nos quinze jours de vivres à la recherche de guides problématiques ; d'autre part, est-il prudent de lancer une colonne, si légère soitelle, sur cette route empoisonnée, où un sergent envoyé chez Samory à la fin d'août déclarait déjà qu'on marchait dans la pourriture jusqu'aux genoux ? Quelle eau trouverons-nous à boire ? Des maladies ne vont-elles pas survenir ?
Cependant, pouvons-nous abandonner la piste inespérée que nous donne le sofa ?
Au médecin qui décline toute responsabilité, voyant déjà nos tirailleurs empoisonnés, je réponds : « Puisque nous avons la chance de marcher souvent à mi-pente des collines, on prendra l'eau au-dessus du chemin et non en dessous. Après tout, c'est moi qui ai le commandement de la colonne, donc la responsabilité : là où Samory et ses bandes ont passé, des tirailleurs menés par un capitaine français passeront aussi ! Tous les chemins sont beaux quand Samory est au bout !
Je décide la marche vers le sud et en rends compte au commandant à Nzô.
Le sofa nous guide, il n'a pas exagéré. A 1 heure, Zougoufesso est encombré de cadavres qui dégagent sous la pluie des odeurs atroces. La nuit, Jacquin et Boyé, qui couchent dans la même case, en sont chassés par des vers, qui ont abandonné les cadavres, à la recherche d'une autre proie ! Décidément, nous ne coucherons plus dans les villages. La difficulté est grande de trouver un emplacement pour camper. Les moindres clairières ont été utilisées par les gens de Samory et sont encombrées de huttes qui ont toutes leurs funèbres habitants.
27 seplembre. — Départ à 5 h. 30. A 8 heures, passage du Mlé, gros affluent du Bafing, tributaire du golfe de Guinée. C'est un sérieux obstacle : le Mlé, qui en temps ordinaire a vingt-cinq à trente mètres de largeur, a débordé : sur les deux rives s'étend une nappe liquide qu'il faut traverser avec de l'eau jusqu'à la poitrine, pour arriver à une passerelle de troncs d'arbres noyée sous l'inondation. Il faut la chercher du pied à tâtons, en se cramponnant à la corde établie d'une rive à l'autre, pour résister au courant. Samory y a perdu le mois précédent un de ses canons, pris aux Anglais l'année dernière. Le passage de la reconnaissance et de ses cinquante porteurs prend deux heures. Heureusement nous n'avons pas de chevaux.
Nous sommes à 11 heures à Gouangooulé, appelé par les sofas Dabadougou, parce que Mokhtar, un des fils de l'almamy, y a séjourné longtemps avec une grande partie de son arrière-garde, formée des fameux sofas du nom du combat livré en septembre 1891 par les tirailleurs du capitaine Barbecot et les spahis du lieutenant Charles Mangin.
Nous voici à l'entrée des montagnes des Dioulas. Nous nous enfonçons dans un dédale de collines à pentes très raides, couvertes d'une forêt épaisse. Le sentier court généralement à flanc de coteau, coupé de troncs d'arbres gigantesques couchés en travers. L'escalade d'un arbre de deux mètres de diamètre, dont le tronc est lisse et glissant par l'effet de la pluie, demande parfois une heure pour la petite colonne. Impossible de tourner l'obstacle, la végétation épaisse de branches et de lianes formant mur à droite et à gauche. La marche est fatigante dans la boue, et quelle boue ! car partout des cadavres. Je ne dis pas des squelettes, je dis des cadavres, à tous les degrés de la putréfaction. La faim, les fatigues ont fait leur œuvre dans la foule qui suit l'almamy. Dans les fonds surtout, au bas d'une côte trop raide, les malheureux se sont arrêtés pour mourir. L'air ne circule pas sous ces voûtes épaisses. La pluie qui tombe toujours entraîne sur les pentes des flaques verdâtres et grouillantes, qu'on ne peut pas toujours enjamber. Parfois du bout de ma canne, je chasse des vers collés à mes jambières. Il faut avoir le cœur solide. De temps à autre, je vois les tirailleurs qui sont devant moi se mettre à courir : on passe devant un charnier exhalant des odeurs atroces. La cigarette rend de fiers services. Nous comprendrons plus tard comment Samory se croyait ainsi gardé. Les pieds nus de nos braves tirailleurs se ressentiront longtemps de ce bourbier empoisonné, qui envenime les plaies, mais ces braves gens marchent quand même, sans une plainte, comme ils marcheront partout et toujours, où leurs chefs français voudront les conduire.
Vers 2 heures nous sommes en vue de Zélékouma, dont nous sépare un gros marigot. Jacquin va voir avec une patrouille et m'envoie vite un mot : « Inabordable, on sent le village à 400 mètres.,» Nous nous installons dans une petite clairière à moitié inondée, qu'il faut encore débarrasser de ses hôtes. Nous y troublons un repas macabre : une dizaine de fugitifs sont là, accroupis autour d'un feu, sur lequel rôtissent des lambeaux de chair humaine. La tête de la malheureuse femme égorgée a roulé à terre, elle semble nous regarder de ses yeux agrandis d'épouvante.
Dans tout le Soudan, la plupart d'entre nous ont vu depuis longtemps les traces du passage de l'Almamy, mais des traces vieilles, refroidies : la ruine, le vide, l'abandon. Ici, c'est le royaume de la mort, de l'horreur !
28 septembre. — Mauvaise nuit. Pluie continuelle. Mais Dieu merci ! le moral reste excellent et les jambes aussi. D'après les dires des autres sofas, corroborés par ceux de quelques femmes arrêtées à Zélékouma, c'est aujourd'hui que nous devons tomber sur les campements de Samory. Les précautions sont prises, les ordres donnés. Chaque section a son objectif particulier, car une fois engagés, noyés dans cette foule, il peut devenir impossible de donner des instructions. Mais ce ne sera pas pour ce jour-là !
Vers 10 heures, nous traversons un parc de bœufs récemment évacué, les traces sont fraîches. Des traînards rencontrés nous disent que l'Almamy est parti et, en effet, quand à 11 heures au bas d'une pente si raide qu'il faut s'accrocher aux branches pour la descendre, nous tombons sur le diassa des femmes, nous le trouvons évacué. Quelques vieilles, qui restent là, résignées à la mort, avec le fatalisme de ces races qui ont tant souffert, nous disent que Sarankégny, la fameuse favorite, est partie trois jours avant avec toutes les femmes vers le nord-est, et elles nous indiquent la route.
Nous voici repartis sur cette nouvelle piste, après nous être arrêtés deux heures pour casser la croûte. Nous traversons de grandes clairières sur lesquelles le soleil de 2 heures darde ses rayons de plomb. Et toujours monter et descendre ! Pourtant tout le monde suit bien, même les porteurs. Il est vrai que nous sommes en pays anthropophage et que les habitants nous guettent du fond des halliers. On sait que tout homme restant en arrière est un homme perdu et mangé : il n'y a rien de tel pour vous donner des jambes.
A 3 heures, nous traversons un vaste campement, dans un cirque de montagnes et de forêts. Au centre, la case de l'Almamy. C'est là qu'il a séjourné avec tout son monde, depuis son retour du fleuve jusqu'au 25. Des centaines de traînards sont restés là, morts, mourants, désespérés. Ils nous regardent passer. De ces groupes part un cri navrant : Mfâ! konko ! (Père ! j'ai faim!). » Il n'y a rien à faire pour ces malheureux irrémédiablement voués à la mort. Il faut penser aux autres, à ceux qu'on peut encore délivrer, sauver peut-être. Et l'on hâte le pas, le cœur serré, en leur donnant le morceau de biscuit et de viande froide qu'on a dans sa musette.
Dans ce camp, nous trouvons les deux derniers canons pris aux Anglais. Samory les a abandonnés au bas d'une pente trop raide.
Nous faisons là une rencontre importante : je vois venir à moi un sofa bien portant, car ce sont les petits, les faibles qui meurent. Cet homme a quitté Samory dans les conditions suivantes : après avoir assisté à une palabre dans laquelle Samory avait annoncé qu'il envoyait son fils Tidinanki Mory à Touba, pour traiter, ce sofa avait appris qu'il confiait en même temps à quelques fidèles le soin de rechercher une route où l'on pût vivre, pour regagner les pays de l'est. Dégoûté de la perspective de nouvelles fatigues, il avait déserté avec deux de ses camarades. Poursuivis, les deux autres avaient eu la tête coupée ; lui seul avait échappé. Aussi donna-t-il tous les renseignements qu'il possédait.
La marche continue, lente et coupée par les arrêts fréquents, pour donner le temps à quelques hommes déguisés en sofas, qui marchent en avant, de reconnaître les campements de traînards que nous rencontrons. Pendant toute l'après-midi je cause avec le déserteur. Cet homme est très surpris de nous avoir rencontrés : Samory se garde du côté du nord, du côté de Touba, mais de notre côté il ne craint rien. Tout le monde croit qu'il est impossible de passer derrière l'almamy, à cause des cadavres. Nous n'avons devant nous, dit l'homme, qu'un petit poste d'une vingtaine de sofas commandes par un fils de l'Almamy : Macé Amara, et il indique en détail comment Samory est campé : à une quinzaine de kilomètres se trouve un petit village : Guélémou. Là sont les femmes de l'Almamy et toute la dembaya 4, c'est-à-dire sa famille, celles de ses fils, les captifs, etc.… Derrière Guélémou, qu'entoure un petit bois, s'étend un grand campement, au milieu duquel, sur un petit mamelon, se trouve la case de Samory. Le sofa ajoute qu'il a encore beaucoup de monde avec lui, mais les vivres manquent pour la foule ; les gens sont las ; ils se sentent perdus dans cette forêt compacte et différente de la claire rousse soudanaise.
Il semble donc bien que l'Almamy ignore notre approche, qu'il se garde mal et que le moral des sofas est atteint. Le soir venu, on s'arrête dans une petite clairière cachée entre deux marigots très boisés, remplie d'une herbe haute et forte que les tirailleurs doivent fouler pour camper. Peu à peu s'est formée dans mon esprit l'idée que l'occasion s'offre de porter à Samory le coup suprême, et ma résolution est prise. « L'occasion n'a qu'un cheveu… » L'étoile de l'Almamy semble pâlir ; mais son prestige est encore tel que la lutte ne peut finir que par sa mort ou sa capture. S'il est tué au fond de la forêt vierge, personne ne le croira et un beau jour un autre Samory surgira. Mon ami Scal, à Kayes ne me disait-il pas il y a deux ans que Samory était mort depuis longtemps et que c'était un autre Samory qui avait pris sa place ! Il faut donc le saisir vivant et pour cela le surprendre. Il ne nous faut pas un combat qui, si heureux qu'il soit, pourrait lui donner le temps de fuir et de nous échapper. Ce qu'il faut, c'est une surprise complète, brutale. Confiant dans la solidité, l'entrain et la discipline de ma petite troupe, je décide de risquer un coup d'audace en pénétrant sans coup férir dans le camp de l'almamy, pour s'emparer de sa personne avant qu'il ait pu fuir, convaincu que, lui pris, ses sofas poseront les armes. Les ordres sont donnés :
« Avant le jour, le capitaine Gaden enverra une escouade bien commandée, qui cherchera à se glisser de l'autre côté du village de Macé Amara et interdira la route du camp de Samory. (Il est à peu près impossible de sortir des sentiers dans ces forêts).
« La 1re section (lieutenant Jacquin et sergent Bratières) doit traverser au pas de course le village des femmes, sans s'en occuper, pénétrer, sans tirer, dans le camp de l'Almamy et se porter rapidement au débouché du camp sur la route de Touba, seule issue au milieu des montagnes.
« La 2e section (capitaine Gaden) doit suivre immédiatement la 1re, se porter droit sur la case de l'Almamy et l'occuper.
« L'Almamy en personne est l'objectif de ces deux premières sections.
« La 3e section de la compagnie Gaden (sergent Lafon) et la 1re section de la 15e compagnie, avec le lieutenant Georges Mangin et l'adjudant Brail, formeront une réserve à la disposition du capitaine commandant la reconnaissance.
« Le convoi, avec la 2e section de la 15e (sergent Maire) s'arrêtera à l'entrée du village des femmes.
« Comme consigne générale, il est recommandé de conserver les tirailleurs absolument groupés. Défense leur est faite de tirer un coup de fusil sans l'ordre de l'officier ou du sous-officier commandant la section et à ceux-ci le capitaine recommande de ne tirer qu'en cas de nécessité absolue, s'ils rencontrent une résistance sérieuse à briser.
« Pour prendre Samory, il ne nous faut pas un combat. Si heureux qu'il soit, il donnerait à l'Almamy le temps de fuir. Il faut une surprise complète. »
Je commente ces ordres et recommande expressément aux chefs de section de ne pas tirer, de garder leur troupe dans la main, de ne pas tuer l'almamy si possible.
29 septembre. — Après une nuit très froide, le bivouac est levé au petit jour. Par un heureux hasard, Macé Amara a été appelé la veille au camp par son père et sa petite troupe, sans chef, s'est endormie. L'escouade du caporal Fodé Sankaré l'a prise au gîte.
Vers 7 h. 12, nous débouchons sur des pentes dénudées : à nos pieds s'ouvre une vallée verdoyante éclairée par un soleil, qui nous paraît radieux au sortir du jour douteux de la forêt. L'horizon est barré par une longue croupe boisée et derrière ces bois montent à perte de vue des colonnes de fumée indiquant un grand campement. Le sofa déserteur me dit en me les montrant: c'est Lui ! L'allure se précipite peu à peu, en longeant le pied de la croupe ; nous défilons entre de nombreuses huttes remplies d'une foule sans armes, cachés comme nous le sommes dans les hautes herbes, tous à pied, les gens ne nous voient que lorsque nous sommes sur eux. On leur crie de ne pas bouger, de se taire, de ne pas avoir peur, et l'on file. Ils nous regardent passer, hébétés. L'allure est rapide ; l'instant est suprême ; pourvu qu'il ne parte pas de coups de fusil ! Nous passons, coup sur coup, deux marigots encaissés. Sur le bord du second, des femmes sont entrain de laver. C'est le village des femmes de Samory. Jacquin exécutant sa consigne avec un magnifique entrain enlève sa section, traverse le village, le petit bois et tombe dans le marché, que les gens qui ont trouvé du manioc ont installé. Sans se laisser intimider par la foule, Jacquin y plonge avec sa petite troupe. Gaden s'y jette sur ses traces. Il est 8 heures ; partout les femmes font cuire le repas du matin. La surprise est complète.
Samory qui, selon son habitude, lisait le Coran devant sa case, entendant la rumeur produite dans le camp par l'apparition des tirailleurs, s'est levé. Il aperçoit les chéchias et dans le saisissement extrême de la surprise, ne prend pas le temps de saisir une arme dans sa case, où se trouvent plusieurs fusils et un revolver chargés. Il n'a pas le temps de sauter à cheval ; il s'enfuit précipitamment dans la direction opposée, vers la route de Touba, (sur laquelle se trouve la grande garde de ses fils). Au bout de quelques minutes de course, le caporal auxiliaire Faganda Tounkara aperçoit le premier l'Almamy que font reconnaître sa haute taille, son vêtement bleu rayé blanc et sa chéchia serrée d'un turban blanc (costume exceptionnel au Soudan). Les tirailleurs précipitent leur course : en tête le sergent Bratières, le caporal Faganda Tounkara, les tirailleurs auxiliaires Banda Tounkara et Filifing Kéita ; celui-ci arrive le premier sur l'Almamy, qui lui échappe par un brusque crochet.
Tout en courant bravement au milieu du camp rempli d'hommes armés, les tirailleurs crient : Ilo ! Ilo ! Samory! (Arrête ! arrête ! Samory !). Il continue à fuir. A son tour le sergent Bratières, qui le serre de près, lui crie: Ilo ! Samory!. Voyant un Blanc, Samory à bout de forces s'arrête et se laisse tomber à terre. Le sergent le saisit. L'Almamy dit aux tirailleurs de le tuer, et dans son trouble demande au sergent s'il est le chef de la colonne. Jacquin avec le reste de la section arrive au même instant. Il était temps. Le premier mouvement de stupeur passé, de tous côtés les gens sortent en armes de leurs gourbis, mais trop tard. La surprise a si bien réussi, tout s'est passé si vite que les sofas n'ont pas eu le temps de s'apercevoir de notre petit nombre Samory est déjà dans nos mains quand ils songent à le défendre. Jacquin ramène l'Almamy à sa case qu'a occupée le capitaine Gaden et, en lui mettant le revolver sur la tempe, lui fait comprendre qu'au premier coup de fusil son sort est réglé. Samory s'est déjà rattaché à la vie et par ses gestes et ses paroles engage ses hommes à mettre bas les armes.
J'arrivais ce moment au mamelon où se trouvait la case de l'Almamy, avec le peloton de réserve de Mangin, en bon ordre, l'arme, baïonnette au canon, sur l'épaule. Jacquin me remet son prisonnier. Il est immédiatement placé sous une garde spéciale de quatre tirailleurs ; les abords de la case sont déblayés, le carré est formé alentour. En un clin d'œil la nouvelle est connue par tout le camp et met fin, comme j'y comptais, à toute tentative de résistance. Il n'a pas été tiré un seul coup de fusil.
En pays découvert, notre petit nombre eût été vu, un tel coup de main eût peut-être été impossible. Mais nous étions dans la grande forêt : derrière les deux sections lancées en enfants perdus, la réserve en bon ordre, le fusil sur l'épaule, déboucha de la forêt comme d'une trappe, et déchaîna la panique.
L'Almamy profondément ému, affecte l'indifférence, avec son rictus habituel. Calmé peu à peu, il demande s'il a la permission de faire son salam et le fait solennellement, pendant que ses marabouts, ses chefs de guerre, ses griots viennent se rendre. Je fais circuler des patrouilles dans tout le camp, pour opérer le désarmement, réunir les prises.
Je m'étais tout de suite informé de la grand'garde dont on m'avait parlé, sous les ordres des fils de Samory, Sarankégny Mory et Mokhtar. Deux solutions : marcher sur elle et combattre, ou essayer d'amener sa reddition. Où est-elle ? quelle est sa force ? D'autre part il n'est pas sage, dans l'ignorance de ce qui nous entoure, de détacher une partie de ma faible troupe. Dans ces conditions, malgré le souvenir de l'odieux guet-apens de Bouna, j'envoie un homme promettre la vie sauve à Sarankégny Mory comme à ses frères s'ils faisaient leur soumission immédiate.
Pendant toute la matinée, les armes, les cartouches, les barils de poudre viennent s'empiler devant la case du Grand Chef. Le lieutenant Georges Mangin et l'adjudant Brail réussissent à maintenir la discipline pendant qu'on recherche au village des femmes le trésor de l'Almamy. Bientôt les caisses qui le contiennent sont rassemblées et mises sous bonne garde. L'inventaire aussitôt fait permet de l'évaluer à 200.000 francs environ.
Vers 2 heures, pendant que nous cassons la croûte, on vient me dire que Sarankégny Mory arrive. Je prends une section et je le rencontre à une petite rivière. De l'autre côté, un chef attire l'attention, car ces gens sont en loques, comme tout le monde, mais Sarankégny Mory a sa coquetterie ; il a tiré de ses bagages un boubou vert pâle. Il traverse le premier la rivière en se retroussant, enlève son sabre à baudrier orné de plaques d'argent et le remet dans mes mains. Les sofas traversent et jettent leurs fusils à nos pieds.
Quand les femmes se présentent, en tête marche la fameuse Sarankégny. Visage impénétrable que cette femme maigre, presque chétive, avec ses grands yeux Japonais et sa démarche de princesse. C'est la seule personnalité intéressante. Derrière elle, une foule de cinq à six cents femmes, enfants, jeunes gens, petits garçons échelonnés dans tous les âges. Un petit groupe de huit à quatorze ans a fort bon air.
Sarankégny était la seule de ces femmes qui eût des enfants de plusieurs âges, signe évident que la faveur du maître lui fût toujours restée. J'eus plus tard l'occasion de savoir quelle avait été l'origine de cette faveur. La voici. Quand Samory battant en retraite après son échec devant Sikasso fut arrêté par le Ouassoulou révolté et qu'il réussit à passer en soudoyant un chef, il trouva en arrivant à Sanankoro une colonne toute prête, que Sarankégny, à qui il avait laissé le commandement, avait rassemblée. Il put ainsi reprendre immédiatement l'offensive et rétablir son empire.
Les autres femmes étaient soit de jolies femmes, soit celles qui constituaient ce qu'on appelait les mariages politiques, c'est-à-dire la fille aînée du chef de village que Samory venait de prendre et de détruire. Mais je ne savais pas que dans cette foule se trouvaient les mères des six fils de Samory qui tombèrent dans les rangs de l'armée française pendant la Grande guerre et en Syrie.
Plus tard, toute la postérité de Samory fut rassemblée dans son pays, au Ouassoulou, entre Bissandougou et Kankan. C'était une race militaire. En 1915, lorsque je commandais aux Dardanelles, je reçus un renfort de Sénégalais, dans lequel se trouvait un sergent qui demanda à m'être présenté :
— Comment t'appelles-tu ?
— Mandiou Touré ! 4
— Tu es son fils ?
— Oui !
— Qu'étais-tu, lorsque j'ai pris ton père?
— J'étais encore petit.
Et il me raconta dans les grandes lignes la capture de son père. Il fut tué dans l'attaque du lendemain, avec une bravoure magnifique. Un autre devint officier. Quand mon ami, le général Charles Mangin, commandant en chef l'armée du Rhin, me reçut à Mayence, il avait, au poste de garde du palais qu'il habitait, des Sénégalais commandés par un sous-lieutenant qu'il me présenta : c'était un fils de l'Almamy.
C'est l'honneur de la France de s'attirer le dévouement jusqu'à la mort des fils de celui qu'elle a dû combattre, pour imposer au Soudan la paix française, plus généreuse, plus bienfaisante que la paix romaine.
Le soir arrive au camp un convoi de riz envoyé par le commandant, escorté par dix tirailleurs ; ils ont été attaqués en route par les anthropophages et ont perdu plusieurs sacs de riz. Nos communications sont donc coupées. Le commandant m'avertit qu'il envoie un convoi de vivres avec cinquante tirailleurs sur Gourono, comme je le lui avais demandé dans ma lettre de l'avant-veille. La nuit, les tirailleurs couchent en carré autour des cases du mamelon, une sentinelle sur chaque face, sans parler de la garde particulière de l'Almamy, un petit poste sur la route de Touba, un autre à l'entrée du village des femmes que j'ai interdit, un troisième au parc aux bœufs. La nuit est tranquille; deux ou trois coups de fusil seulement.
La journée est employée à détruire les armes et les munitions ; un canon qui restait à Samory est jeté dans la rivière. Tout est brisé, brûlé, noyé. Ses bagages personnels sont rendus à l'almamy ; les reliques du capitaine Braulot et du lieutenant Bunas sont mises avec le trésor, dont on a dressé un inventaire. On organise le départ du lendemain. Nous n'avons plus rien à faire dans la forêt et il est urgent de rapatrier au plus vite la grande foule 5 vers les régions où ces pauvres gens pourront trouver à subsister. Je les dirigerai sur Touba où ils trouveront plus tôt des pays à ressources. Ils rallieront ensuite leurs pays d'origine. La plupart sont dans un état moins mauvais que nous pouvions le craindre. Ce sont les faibles qui ont succombé en route.
Samory au reste s'occupait de son ravitaillement, il s'était campé là où nous l'avons capturé, à cause des champs de manioc environnants et nous avons vu rentrer au camp 2.000 hommes qui en portaient des charges de 25 kilos.
Le bilan de la journée peut s'établir ainsi :
Il se trouvait encore beaucoup de poudre, car dans la journée, trois cases ont pris feu et ont sauté : la plupart des hommes valides avaient un fusil et de la poudre. Beaucoup d'armes à feu ont dû disparaître, jetées dans les halliers pour nous les dissimuler. S'il ne restait plus à Samory que soixante chevaux, alors qu'il avait eu une nombreuse cavalerie, c'est qu'au sud du 120 parallèle de latitude nord à peu près, la mouche tsé-tsé sévit ; les chevaux et les bœufs ne vivent pas. C'est la raison pour laquelle les gens de Samory achetaient avec des captifs soit un fusil à tir rapide, soit un cheval.
Parmi la suite de l'almamy, une des dernières femmes vint se présenter, pauvrement habillée : c'était Diaoulé 6 mère de Karamoko, un des fils de Samory. Or, ce Karamoko, après le traité passé par le capitaine Péroz à Bissandougou avec l'almamy était venu en France et avait assisté à la revue traditionnelle du 14 juillet 1886, qui fut le point de départ de l'éphémère popularité du général Boulanger. Les impressions de ce jeune prince noir sont assez curieuses en ce sens qu'il trouva la France un pays beaucoup plus petit que le royaume de soin père, car débarqué à Marseille il était allé, en chemin de fer, en quelques heures de la mer à Paris, tandis que dans son pays, il fallait huit jours pour aller de la frontière à la capitale. En revanche, il avait été fortement impressionné par la revue : on voyait alors à Longchamp beaucoup plus de troupes qu'aujourd'hui; la revue se terminait par une charge de toute la cavalerie, face aux tribunes. Karamoko crut avoir vu toute l'armée française. L'impression fut assez forte pour que le jour où Samory voulut recommencer la guerre avec les Français, il critiquât sa décision et tînt des propos défaitistes, parlant de la force des Français du danger de les combattre à nouveau, etc… Le fait rapporté mit l'Almamy en fureur, il fit enfermer son fils dans une case, dont il fit murer la porte ; Karamoko y mourut de faim. Sa mère, bien entendu, fut répudiée. C'était cette femme qui venait se mettre sous ma protection, faisant valoir que son fils était mort de son amour pour notre pays. Elle me fit cadeau d'un tapis de selle qui lui avait été offert par le gouvernement français et qui porte un croissant et une étoile, en métal doré. Le velours vert en avait vu de toutes les couleurs dans les éternelles marches des gens de Samory et Diaoulé l'avait raccommodé avec des morceaux de soie rouge.

1er oclobre 1898. — Le départ est fatalement difficile non pas pour la petite colonne, mais pour mettre en route tous ces gens. J'ai rendu leurs chevaux à Samory, à ses fils anciens chefs de colonne ; j'ai remonté, bien entendu, mes officiers et moi-même je suis à cheval, lorsque Diaoulé me saisit la jambe me suppliant de prendre sa jeune et belle fille sous ma protection. On voulait la lui enlever pour la confondre dans la masse de la dembaya. Que serait-elle devenue ? Comme je ne songeais qu'à maintenir la troupe, au milieu des tentations, dans l'ordre et la discipline, je fis rendre la jeune fille à sa mère. Le départ est ainsi réglé : Samory, Sarankégny Mory, Mokhtar, Morifingdian et les porteurs du trésor marcheront sous une garde au milieu de la colonne. La dembaya, avec les chefs importants, suivront immédiatement. Quant à la grande foule, je fais dire à ces gens que je les ramènerai dans leur pays, que je leur conseille de suivre la colonne au plus près ; une escouade d'auxiliaires de Gaden, commandée par le meilleur caporal est désignée pour les protéger.
La distance du camp de Samory à Santa est heureusement très courte, une dizaine de kilomètres, ce qui est toujours bon pour une première étape. En arrivant à Santa, la petite colonne forme le carré : il reste quelques cases, l'une d'elles est affectée à l'almamy. Je vois de loin qu'il y a une discussion : Samory trouve qu'elle sent mauvais ! Cela nous fait rire ; nous en avons senti d'autres !
La route a été facile, parce qu'il y avait eu des communications entre le camp et la grand'garde ; mais à partir de là les gens de Samory sont perdus. Un de mes officiers avait, bien entendu, relevé l'itinéraire de la colonne clans ce pays totalement inconnu. Son travail, mis au net, permet de prendre un azimut dans la bonne direction ; mais les villages anthropophages sont construits dans des conditions de méfiance, qu'il est facile de comprendre. Nous avons vu déjà que les habitants ne pouvaient aller plus loin qu'au village voisin, sans risquer d'être tués et mangés. Pour les mêmes raisons, les villages blottis dans la forêt sont le centre d'une étoile de chemins, ces chemins n'étant d'ailleurs que d'affreux sentiers ; un ou deux seulement mènent à un autre village ; les autres sont des chemins de culture qui, au bout de trois ou quatre kilomètres, aboutissent à un petit champ caché dans la forêt ; le chemin continue jusqu'à un autre petit champ, jusqu'à un troisième ou un quatrième. Et, là, c'est un cul-de-sac ! Je lançai donc dans l'après-midi les lieutenants Mangin et Jacquin sur les deux sentiers qui me paraissaient être dans la bonne direction. Ils rentrèrent le soir, ayant eu beaucoup de mal à passer et aussi mécontents l'un que l'autre.
Cependant, il faut aller de l'avant, il ne peut être question de reprendre la fameuse route des cadavres. Nous prendrons demain matin la piste qui paraît la moins mauvaise.
Un des chefs, Kiesséri, signalé comme dangereux et que je voulais emmener, était resté en arrière. Je renvoie aussitôt le lieutenant Jacquin avec un sergent et sa section. L'ordre est de le ramener coûte que coûte. Le petit détachement revient le soir même ramenant Kiesséri. Je dis au sergent Sénégalais d'aller chercher sa ration. Celui-ci revient : le sous-officier chargé de la distribution l'a envoyé promener, lui disant que l'heure était passée depuis longtemps. Je crois à un malentendu et fais venir le sergent français, à qui j'avais confié le convoi et les vivres. Il arrive en rechignant :
— Comment ! Vous avez refusé de donner les vivres à ces braves gens qui ont fait trois fois la route ?
— Mais, je ne peux pas être le domestique de ces gens-là !
Mon sang ne fait qu'un tour. J'avais été très vif, très colère dans ma jeunesse ; il s'en fallut d'un cheveu que je saute dessus. Je me retins fort heureusement et une heure plus tard, étendu dans mon petit lit de campagne, j'eus honte du mouvement auquel j'avais failli me laisser aller, pensant en moi-même : je suis soldat. Je sais ce que c'est que la discipline. J'ai désiré avoir une troupe à commander, on me l'a donnée dans une grande circonstance, et j'ai failli manquer à mon devoir de chef : un chef ne frappe jamais un subordonné. Je pris une ferme résolution et je crois l'avoir tenue.
Le lendemain, nous n'avions plus à nous cacher, sonnerie du réveil : sonnerie à cheval. Je vois Samory restant à terre, accroupi à la mode indigène, et discutant. J'envoie mon boy-interprète :
— Va dire à l'almamy que je suis en selle ; je l'ai bien traité jusqu'ici, je lui ai rendu ses bagages, je lui ai rendu un cheval, mais il ne doit pas croire qu'il fera de moi ce qu'il voudra. S'il n'enfourche pas son cheval, je le fais amarrer dessus et en route !
Diallo part, la discussion recommence. Finalement, en maugréant, Samory monte en selle. Je demande au boy ce qu'avait l'almamy :
— Tu sais, Samory est un grand chef ; il t'a déjà dit que personne ne l'a jamais vu manger. Il dit maintenant que personne ne l'a jamais vu non plus obéir aux suites de la digestion. Alors, comme il est depuis trois jours entre quatre hommes, baïonnette au canon, il souffre beaucoup du ventre !
A partir de ce jour-là, au bivouac, je lui fis faire un petit gourbi en paille. Ce fut une des raisons pour lesquelles il renonça à son farouche mutisme.
La route est pire que je m'y attendais. Impossible de rester à cheval, parce que les branches nous barrent le chemin, et pendant deux ou trois heures on avance avec la hantise d'être peut-être obligé, en arrivant à un cul-de-sac, de faire demi-tour. Mais avec ces milliers de gens qui suivent comment faire demi-tour dans un tel sentier ! C'est au cours de cette marche que Samory épuisé — car à chaque instant il faut se glisser pour passer sous de grosses branches d'arbres, qu'on ne peut écarter — me demande, après la traversée d'une rivière, de faire halte pour lui permettre de prendre un bain. Il se déshabille avec une royale impudeur, mais « le noir habille. » Je vois ce grand corps de vieillard solide, couvert de blessures — dans ses débuts de soldat, il avait reçu des balles, des flèches, des coups de sagaie, de sabre. A partir de ce bain, il commença à parler.
Nous arrivons enfin à un petit village : Gambadou, comme la brousse est très haute alentour, tout le monde veut se loger dans le village. C'est ainsi que dans l'espace couvert par une trentaine de cases, deux cents tirailleurs, un millier de gens de la dembaya de l'Almamy, soixante chevaux, et cent trente boeufs sont là. J'ai au moins quarante individus couchés sous le toit de ma case qui déborde et qui leur sert d'abri. Tous ces gens font du feu, comment ces toits de paille qui descendent à quatrevingts centimètres de terre ne flambent-ils pas ? C'est qu'ils ont été copieusement mouillés les jours précédents.
3 octobre. — Nous sommes arrêtés dans la matinée par un gros obstacle : le Mlé, le même que nous avons franchi le 25 septembre, mais ici il a plus de quarante mètres et un courant violent. Il faut construire un pont. Pour abattre deux gros arbres, on utilise les pétards de fulmi-coton. J'ai fait admirer le résultat à Samory et à ses fils qui en ont été stupéfaits. « C'était, dis-je à l'Almamy, pour tes diassas ! » Il eut un sourire mélancolique. A 18 heures, le pont est prêt, sept ou huit arbres liés solidement les uns aux autres, avec une liane qui court à soixante centimètres au-dessus de l'eau pour se guider. Nous passons le 4 au matin, non sans peine. D'abord il y a cinq centimètres d'eau sur le pont, et puis les bœufs qu'on pousse à l'eau sont entrainés : j'ai bien cru que tout allait être détraqué ! Il y a eu huit ou dix boeufs noyés. Nous arrêtons près de Gourono, dans un ancien campement de Samory, où je suis forcé de renvoyer la section de l'adjudant Brail en arrière pour réparer le pont à moitié disloqué par la crue qui continue. Je ne peux pas abandonner la grande foule aux couteaux des anthropophages.
Le 5 octobre, à la fin du dîner, arrive un courrier du commandant, le premier que nous ayons reçu depuis le 25 septembre. Dans le courrier, cette bonne lettre du commandant de Lartigue : après cette pointe aventureuse dans la forêt, après la prise de Samory, sans nouvelles, ce mot de notre chef nous fut bienfaisant.
Toutes mes bien sincères félicitations, mon cher Gouraud, j'étais bien inquiet de vous, car je ne recevais pas de nouvelles depuis cinq jours. En lisant votre lettre j'ai pleuré de joie, et du plaisir de la bonne nouvelle que vous m'annonciez et de l'honneur que j'avais de commander à des officiers tels que vous et ceux placés sous mes ordres. Remerciez officiers et sous-officiers, exprimez-leur mes sentiments à leur égard et assurez-les de tous mes efforts pour leur faire obtenir les récompenses pour lesquelles vous les proposerez. Votre glorieuse action est telle qu'on ne pourra me rien refuser, en tous cas je serai tenace pour faire réussir toutes mes propositions. Merci à vous et à vous de cœur.
(Signé) : De Lartigue.
« P. S. — Je pars après-demain par la route Fanha-Guenso-Beyla .»
A Gourouno, où il y a de la place, la grande foule serre peu à peu sur nous. Des femmes viennent voir le docteur, avec le bras entaillé de l'épaule au coude. Ce sont les anthropophages du pays, embusqués dans les buissons, qui nosent pas attaquer la grande foule, sachant que nous sommes là, mais d'un coup de coutelas ils enlèvent aux femmes le gras du bras. Ces malheureuses arrivent, avec le bras emmailloté de feuilles, avec de la bouse de vache, médicament employé partout au Soudan ! Le docteur leur badigeonne le bras avec la teinture d'iode. Elles hurlent, mais elles guérissent rapidement. C'est un fait, dans tout le Soudan les blessures guérissent très vite, l'infection ne s'y met pas. C'est ainsi qu'un de mes tirailleurs avait le cou profondément entaillé par un coup de sabre et les deux lèvres de la plaie n'ayant pas été recousues, la cicatrice bâillait avec un écart de sept à huit centimètres : il se portait parfaitement. Par contre, ils ont la terreur des maladies intérieures. J'ai eu à ma compagnie auxiliaire un excellent sergent, qui a fait depuis une belle carrière. On vient un jour me dire qu'il va mourir, je le trouve se tordant sur le sol et criant: « Y a chéitane 7 dans mon ventre ! » Il avait simplement une forte colique.
Le 6 octobre, à peine sommes-nous en route que nous rencontrons trois ou quatre tirailleurs avec des porteurs ayant sur la tête des sacs de courrier. Le clairon sonne : aux lettres ! Samory me demande ce qu'est cette sonnerie.
— Je vais faire une petite halte, pour que tous les Blancs qui sont là, puissent avoir tout de suite leurs lettres.
— Quelles lettres ?
— Mais les lettres de leurs parents, de leur père, de leur mère, de leur frère ou de leur femme.
— Mais comment peuvent-ils savoir en France que vous êtes ici ? Ça, ajoute-t-il, c'est une chose de Blanc !
Pour moi, c'est un énorme courrier, car je rattrape tous ceux qui ont filé en juin, juillet, août jusqu'à Ouagadougou, sont revenus sur Bobo Dioulasso, puis à Kayes et finissent par me parvenir. Nous campons dans la forêt près de Didilou et c'est une joie profonde de lire les lettres, après en avoir été si longtemps privé.
Enfin, le 9 nous sortons définitivement de la forêt pour passer le Bafing et retrouver le commandant de Lartigue à Guéasso. Tout le monde respire ! On ne saurait croire combien la grande forêt vierge, avec son humidité, son ciel au jour douteux, son sol spongieux, pèse véritablement sur le corps et sur l'esprit. Stanley en a su quelque chose quand il alla délivrer Emin Pacha dans les forêts de l'Arouhimi — forêt cependant à qui nous devons être reconnaissants, car c'est bien elle qui a perdu l'almamy. Il avait emporté des vivres ; il avait un troupeau ; il avait des charges de mil, mais dans ces sentiers filiformes, sur des kilomètres, comment faire des distributions !
Samory, ses fils, les personnages importants sont présentés au commandant de Lartigue. L'Almamy qui est depuis quelques jours de plus en plus en confiance, fait mauvaise impression au commandant par sa familiarité et son obséquiosité. Il réclame des cigarettes, des souliers, des kola, du sel. C'est bien l'homme à qui le capitaine Péroz a laissé un souvenir magique. « Non seulement, disait-il, Péroz m'a donné de beaux cadeaux comme les autres, mais il avait encore dans sa case de très belles choses. J'allais le voir, je prenais tout ce que je voulais et il ne me disait rien ! »
Les difficultés de la marche dans la forêt décident le commandant à continuer avec le détachement Woeffel. Nous le suivrons à un jour d'intervalle.
Depuis que nous sommes sortis de la forêt surtout, l'Almamy cause plus volontiers. Physiquement, c'est un homme robuste, grand, avec une barbiche grisonnante indiquant son âge, soixante ans passés certainement ; les yeux enfoncés sous l'arcade sourcilière sont vifs et rusés ; le nez gros et la bouche grande, des dents éclatantes qu'il frotte continuellement avec un morceau de bois tendre. Sa physionomie exprime l'intelligence, la duplicité, et une certaine bonhomie railleuse. Il ne se défend pas de ses cruautés, elles lui semblent naturelles. Il les considère comme une conséquence de la guerre, telle que l'ont comprise et l'ont toujours faite les Noirs dans toute l'Afrique. On lui reproche d'avoir coupé beaucoup de têtes, il doit se dire simplement que cela tient à ce qu'il était assez puissant pour le faire ! Il n'a pas de remords. Après tout, n'y a-t-il pas, dans notre vieille Europe civilisée des gens, qui lui ressemblent ! Il ne parait plus se rappeler comment il a été enlevé à la barbe de ses sofas, sans que ses fidèles aient eu le temps de tirer un coup de fusil. Il aime mieux ne pas parler du temps des vieilles guerres qu'il a soutenues contre nous ; il préfère évoquer les souvenirs des courtes périodes où, en arrêtant ses dévastations, il était en bon accord avec nous.
Je lui fais traduire un jour, dans l'ouvrage de Binger, le récit de la visite qu'il fit à l'almamy assiégeant Sikasso. Binger dit que « Samory écoute avec attention ce qui lui est agréable, mais qu'il prend un air indifférent et semble penser à tout autre chose, quand on aborde un sujet épineux » ; ce passage fait le bonheur des marabouts et griots qui nous entourent. Et le vieil almamy déclare :
— Ah! ces blancs, ils voient tout !
Les dernières étapes sont lentes. Nous sommes désormais en communication avec la base de Beyla, nous sommes ravitaillés. Rien n'impose de demander de nouveaux efforts à la troupe et surtout à la foule fatiguée qui suit.
Un jour que l'almamy paraît de bonne humeur, j'aborde une question que nous nous étions souvent posée. Lorsque, après les rudes combats de 1892, Samory se décida à évacuer le Ouassoulou et à éviter nos colonnes, en prenant le large, il avait toujours réussi à se dérober à temps, comme s'il avait été prévenu. Je lui demande comment il avait fait pour être aussi bien renseigné.
— C'est bien simple, me dit-il, moi qui suis un grand chef, on ne me voit jamais chanter, on ne me voit jamais manger, ni la suite; jamais quelqu'un ne s'est mis à table avec moi. Or, j'appris que les Blancs avaient l'habitude de se réunir pour manger et là, heureux des bonnes choses qu'ils absorbent, heureux de se retrouver, ils racontent tout, des choses importantes aussi bien que des choses insignifiantes. Lorsque j'ai su cela, je ne pouvais pas le croire au début, mais enfin il faut profiter de tout ; j'envoyai mes bilakoros 8 s'engager comme garçons pour servir les Blancs — les Noirs apprennent très rapidement les langues. Ils servaient à table et ils écoutaient les officiers dire : « Les spahis sont arrivés, on ne va pas tarder à partir… » ou bien : « Non, on attend encore les canons, qui arriveront par le premier bateau. » Un autre disait : « On ne fera rien tant que le colonel ne sera pas là ; mais quand il sera là, on partira tout de suite. »
Les bilakoros me prévenaient et quand j'étais sûr que la colonne allait s'ébranler, je partais avant elle. »
Cette confidence m'avait frappé et, commandant la 4e armée en 1918, lors des mauvaises nouvelles, après le 21 mars, après le 27 mai, je ne permis jamais aux officiers qui se trouvaient à ma table, de tenir des propos décourageants. On raconte que, pendant la guerre, c'étaient les cuisiniers qui détenaient les meilleurs « tuyaux » Ils ne pouvaient savoir, au fond de leur cuisine, que ce que leur racontaient les soldats-ordonnances servant à table. N'ayant pas oublié, j'ai souvent été confondu dans le monde de la façon dont on parle de tout, sans aucune gêne; il semble admis que les serveurs, que bien souvent l'on ne connaît pas, n'ont pas d'oreilles !
Parmi les légendes qui courent sur les débuts de Samory, lune des plus répandues, vraisemblable d'ailleurs, dit que Samory était dans sa jeunesse un colporteur, voyageant à travers pays. Sa mère, femme libre, ayant été prise par le marabout, chef de Kankan , Samory s'était engagé obtenir sa libération 9.
Intelligent et brave, il était peu à peu monté en grade, comme on dit en France, et finalement, il était devenu chef de colonne. Un jour, au lieu de ramener les captifs à son patron, le marabout de Kankan, il les distribua à ses propres hommes, sur lesquels son courage au combat et ses qualités lui avaient déjà donné prestige. On revint à Kankan ; on tua le marabout et Samory prit sa place. Depuis, il étendit ses ravages. Sa mauvaise chance voulut qu'il rencontrât les Français.
Dans cette période de retour, où nous causons volontiers, je lui demande :
— Quand tu avais toute ta force, tu avais des colonnes que tu envoyais sous les ordres de chefs, que les Français appelleraient des généraux, — et je lui citai quelques noms, — ils pouvaient te trahir et te faire à ton tour le coup du marabout de Kankan !
Et l'almamy de me répondre :
— Quand un homme aime une femme, il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur et plus la femme est jolie, plus il est confiant. Tout le monde sait ça. Alors, quand je me méfiais de l'un de mes chefs, je lui envoyais une très jolie femme à moi (c'est-à-dire une de ses captives). Cet imbécile lui racontait ce qu'il voulait faire ; elle me faisait prévenir et je faisais couper la tête à l'homme.
Dans le contact quotidien des bivouacs, j'avais remarqué que, par respect sans doute pour leur père, les fils de l'almamy, Sarankégny et Mokhtar, gardés aussi bien que Samory, le fréquentaient peu et n'étaient jamais là quand il venait me voir. Il m'avait semblé aussi que Samory était plus aimable pour Mokhtar que pour Sarankégny Mory. Je cherchai à en savoir la raison. Et voici ce qui me fut raconté :
Sarankégny Mory était, chez les Noirs, ce qu'on appelle chez nous un beau garçon, c'était un prince, et parmi les femmes de son père était une belle Peule. Le bruit courait parmi les sofas qu'un an ou deux auparavant Sarankégny Mory avait été très aimable pour elle. Dans les cas analogues, Samory coupait la tête aux audacieux ; mais celui-ci était le fils de la favorite. Il eut ainsi la vie sauve, et perdit son commandement, qui ne lui avait été rendu que peu de jours avant la surprise du 29 septembre, quand les choses commencèrent à mal tourner. La dembaya était nombreuse et dans les mauvais bivouacs de la forêt, le protocole fléchissait ; l'encombrement permettait des rapprochements.
Un jour, Samory demande à venir me voir. J'envoie Diallo lui fixer : 4 heures, et tenter de savoir ce qu'il veut. Mon boy-interprète revient et me dit :
— Il va te demander une grande grâce ; c'est de couper la tête à Sarankégny Mory.
— Pourquoi ?
— Parce que dans la forêt, il croit que son fils en profite pour retrouver la belle Peule.
Samory vient, me parle d'abord de la pluie et du beau temps et puis :
— Tu as été bon pour moi ; si tu m'as pris, c'est que Dieu l'a voulu. Tu m'as bien traité, comme un chef. Tu m'as rendu un cheval, tu ne m'as pas réduit comme miskin. Je vais te demander une grâce, une grande grâce….
— Laquelle ?
— C'est de faire couper la tête à Sarankégny Mory, mon fils !
— Almamy, tu dis que je suis un grand chef, c'est vrai dans la forêt, mais en réalité ta vie, celle de Sarankégny Mory, celle de Mokhtar, celle de tous tes guerriers n'est pas dans mes mains. Tout est dans les mains du grand gouvernement français. C'est lui qui décidera 10.
Samory s'incline. Je reprends :
— Pourquoi veux-tu que je fasse trancher la tête à ton fils ? L'almamy lève les yeux, me regarde en face et dit :
— Tu le sais bien, et tu sais que je ne dois pas te le dire !
Nous nous retrouvons à Farahoualia, et la colonne fait sa rentrée à Beyla le 17 octobre à 8 heures du matin. Les canons du poste tonnent ; des milliers d'indigènes sont venus contempler ce fameux Samory, qui a jeté si longtemps la terreur sur ces contrées. Le carré est formé devant le poste, Samory au milieu, et l'on rend les honneurs au drapeau.
Pendant que les trois couleurs montent lentement dans l'air pur du matin, et qu'éclate la sonnerie vibrante : Au Drapeau ! Samory se voile la figure avec les mains, comme s'il comprenait que cet instant proclame sa chute ; ses fils regardent, curieux, indifférents, et nous, nos cœurs se tendent passionnément vers ce drapeau bien-aimé ! Minute inoubliable qui paie au centuple, pour des cœurs de soldats, de toutes les peines, de tous les dangers !
Je mis le dernier mot et signai mon rapport de colonne, qui, est la base de ce récit. Il se termine ainsi :
Le capitaine commandant la reconnaissance est heureux de rendre hommage au dévouement et à l'énergie des officiers et sous-officiers, qui ont supporté sans faiblir pendant des journées entières, en plein hivernage, les fatigues de la marche à pied sur une piste extraordinairement pénible; à la discipline, à l'entrain et à l'endurance des tirailleurs réguliers et auxiliaires.
S'il n'avait pas eu sous ses ordres un cadre aussi excellent, des hommes aussi éprouvés que les tirailleurs de la 15e compagnie, qui avaient tous, sur les ordres du capitaine Coiffé, pris part à l'assaut de Sikasso, que les auxiliaires de la compagnie Gaden, qui, admirablement dressés par leur chef pendant dix mois de marches et de travaux continuels, se sont montrés aussi calmes et énergiques que de vieux réguliers, il n'aurait pu tenter le coup de main, qui abattit notre vieil ennemi.
Il ne saurait oublier qu'une surprise aussi complète, un résultat aussi considérable, n'étaient possibles que dans la situation où se trouvaient les troupes de l'almamy, situation due à la chute de Sikasso, à la marche de la colonne Pineau sur Tioroniaradougou, au combat de Doué, et surtout au combat de Tiafesso, due aussi à toutes les colonnes, pendant lesquelles, ont souffert, ont combattu, sont morts, tant de nos camarades.
Dès le lendemain, bon nombre de mes hommes entrent à l'infirmerie pour blessures et abcès aux pieds et aux jambes. Pour moi, lorsque j'allai saluer le commandant, il se plaignit des tirailleurs. Ils étaient entrés dans le village des femmes, y avaient fait du bruit, poussé des cris, etc… Enquête faite, il fut constaté que c'étaient les femmes qui recherchaient les vainqueurs. Fini Samory ! Il faut bien vivre. Ce qui prouve que les Sénégalais n'ont besoin que de quelques heures pour être dans les meilleurs termes avec les populations chez lesquelles ils ont pénétré les armes à la main.
C'est là qu'on put se rendre compte de la famille de Samory. Ses enfants étaient au nombre de trois cent cinquante environ, dont deux cents garçons. Chose curieuse, Samory, quoique ayant passé soixante ans, avait des frères de deux ans, encore, à la mamelle. En effet, son père qui était mort au Djimini à quatre-vingt ans l'année précédente, avait de nombreuses femmes qui lui donnaient chaque année des enfants.
Les premiers jours, après le retour, sont des journées de repos bienfaisantes. Nous sommes encore tous ensemble, le commandant de Lartigue préside la table de la petite popote de Beyla. Les villages alentour et le Ouassoulou tout entier fêtent leur délivrance et retentissent jour et nuit du bruit des tam-tam et des balafons.
Cette liesse générale contraste singulièrement avec l'ennui que manifeste tous les jours davantage Samory. Cela s'explique. Ramené au milieu de la colonne, entouré de certains égards, il pouvait encore se croire en route comme il l'avait été toute sa vie, au milieu des soldats. Maintenant, il n'est plus qu'un captif gardé par des sentinelles au fond d'une cage.
Ce qui doit l'affecter le plus, c'est l'abandon de tous les siens. On organise en effet son départ pour Kayes, où le gouverneur, général de Trentinian, doit le recevoir après avoir pris les ordres du gouvernement.
C'est à qui ne partira pas avec lui. Les femmes elles-mêmes cherchent à se tirer d'affaire, les fils aussi. Sarankégny Mory ne voudra partir que trois jours après son père, pour ne pas voyager avec lui.
Le petit détachement qui emmène Samory à Kayes est commandé par le lieutenant Jacquin avec le sergent Bratières. Il emporte aussi le trésor, enfermé dans douze caisses. J'en ai fait l'inventaire moi-même, avec l'adjudant Brail. Finissant ce travail, le brave adjudant me dit :
— Mon capitaine, je n'ai jamais vu tant d'or 11, croyez-vous qu'on nous en laissera un peu ?
— Moi non plus, dis-je, je n'en ai pas vu plus que vous. Il y a, je crois, un règlement sur les parts de prise. Je demanderai s'il peut nous être appliqué.
J'en fis la demande. Il me fut répondu que le règlement n'était pas applicable aux troupes du Soudan.
Avec le trésor partent les souvenirs de Samory destinés d'une part au Musée de l'armée, la selle, le sabre, le bonnet de guerre de l'almamy, un de ses fusils, un Kropatscheck petit modèle avec des garnitures d'argent, fabriquées par ses forgerons, des dialas 11, les colliers de Saranké Mory et d'Ahmadou Touré, des bagues bizarres, un porte-allumettes et surtout le boubou de guerre de Saranké Mory, riche pièce. D'autre part, nous envoyons au général de Trentinian, la hache de guerre, le chasse-mouches formé d'une queue d'éléphant engainée d'argent et le sabre que m'avait remis Sarankégny Mory au moment de sa reddition.
Le plus grand nombre des gens que nous avions ramenés purent se fixer à nouveau dans leur pays d'origine, dans les villes de Kankan, Bissandougou, Kérouané, origine du pouvoir de Samory. On estima que quarante mille personnes environ étaient rentrées. Deux mille sofas, que la capture de leur chef avait transformés en chômeurs, furent dirigés sur Kayes, pour les travaux du chemin de fer de Kayes au Niger.
A Kayes eut lieu une cérémonie impressionnante : devant tout le personnel civil et militaire du gouvernement, devant la population entière, le général de Trentinian lut à Samory sa sentence :
Samory,
Tu as été le plus cruel des hommes qui se soient vus au Soudan. Tu n'as pas cessé pendant plus de vingt ans de massacrer les pauvres Noirs. Tu as agi comme une bête féroce. Toi et ceux qui sont les instruments de tous tes crimes, vous devriez périr de la mort la plus terrible. Mais les braves Français qui t'ont fait prisonnier, t'ayant promis la vie, ainsi qu'à tous les tiens, le gouvernement français dans sa parfaite loyauté a décidé que vous auriez la vie sauve et que vous seriez déportés sur une terre d'Afrique si lointaine qu'on y ignorera ton nom et tes forfaits. Ton fils Sarankégny Mory et Morifingdian ton conseiller t'y suivront. Quant aux autres, ils habiteront nos postes du Sahel et du Nord, afin qu'ils puissent dire à tous ceux qui songeraient à imiter ton exemple, que personne n'a jamais pu résister aux officiers, aux sous-officiers français et aux braves soldats noirs qui les suivent.

Le gouvernement avait décidé qu'il serait accompagné de quelques-unes de ses femmes. Sur ces trois cents épouses, aucune ne voulut partir volontairement. Il fallut en désigner quatre d'office. Samory fut envoyé au Gabon et interné dans l'île de N'Jolé. Lui qui était en pleine vigueur au moment de sa capture ne vécut pas longtemps, sous un ciel africain, mais différent. Et puis, passé d'un pouvoir absolu, que nous ne connaissons pas en Europe, à la situation du prisonnier, ce fut un gros choc moral. Il ne le supporta pas et mourut deux ans après.
Mokhtar et d'autres de ses fils furent internés à Tombouctou. J'y revis un jour Mokhtar. Il évoqua avec une sorte de plaisir la surprise et la capture de son père.
Qu'allais-je devenir? Mon détachement de la 15e que j'avais amené de Sikasso avait été rappelé, et le commandant Pineau me réclamait. Le commandant de Larticue voulait me garder. Finalement, je reste à Beyla.
Le 7 novembre, le commandant à son tour part pour Siguiri, où il va installer le chef-lieu de la région dans un point plus central. Les jours deviennent monotones. On ne passe pas sans secousse de l'extrême activité au repos.
Cependant, à la mi-novembre, le Journal de l'Afrique Occidentale du 13 octobre nous parvient, donnant la dépêche affichée dans tous les postes de l'A.O.F. par le gouvernement (fac-similé cicontre).
Cela nous fit plaisir, car le courrier du 11 novembre nous avait apporté une autre surprise. L'ordre général n° 69, du 18 octobre 1898, du colonel commandant supérieur donnait un résumé des dernières opérations, se terminant ainsi :
Le commandant de Lartigue rassembla ses forces vers Fanha et, décidé à en finir, se lança sur les traces de Yalmamy. Le succès fut sans précédent. Samory, ses femmes, ses guerriers, etc…
C'est tout! Aucun de mes officiers n'est même mentionné. Le commandant de Lartigue n'a pas été moins étonné, que nous et a fait un ordre à la Région disant que l'oubli de mon nom et de ceux de mes officiers constitue une injustice flagrante et demandant une rectification. Il n'y a donc qu'à attendre.
Les faits furent rétablis par l'Ordre Général no 69 du 12 avril 1899.
Ordre Général No 69.
Prise de Samory
Kayes, 12 avril 1899
« Le commandant (de Lartigue) rassembla donc toutes ses forces à Nzô, puis ayant appris, sur de vagues renseignements fournis par des Dioulas anthropophages que Samory s'enfuyait vers le nord-est, il lança le 23 septembre une reconnaissance forte de deux cents tirailleurs, sous le commandement du capitaine Gouraud, avec mission de rabattre si possible Samory sur la Cavally où le commandant devait l'attendre avec deux cents autres tirailleurs. Dans le cas où Samory changerait de direction, le capitaine Gouraud devrait le suivre et ne pas hésiter à l'attaquer partout où il le rencontrerait.
« La reconnaissance, par d'épouvantables chemins, passa par Dénifesso, Zelekouma, le capitaine Gouraud ayant à ce point appris que Samory marchait vers l'est, se lança résolument à sa poursuite, pénétra à Guélémou au pas de course dans le vaste campement de Samory occupé par environ cinquante mille personnes et parvint à s'emparer de l'almamy et de toute son armée. Résultat sans précédent puisque Samory, tous ses sofas, ses femmes et ses fils, y compris Sarankémory et Moctar étaient tombés entre nos mains.
« Ces opérations exécutées avec vigueur et un entrain admirables, sans aucun arrêt en considération de la saison font le plus grand honneur à tous ceux qui y ont pris part. Les troupes Soudanaises se sont encore une fois montrées à la hauteur de leur vieille réputation par leur énergie, leur abnégation et leur bravoure excessives.
« Outre les récompenses spécialement demandées par M. le Ministre des Colonies, à l'occasion de cette victoire, le colonel commandant supérieur cite à l'ordre du jour des troupes du corps d'occupation :
« M. le commandant de Lartigue : a fait preuve de qualités militaires de premier ordre par son intelligente initiative dans l'exécution des ordres reçus et en réussissant à faire marcher, vivre et combattre sa petite colonne malgré les énormes difficultés rencontrées.
« Le capitaine Gouraud : a conduit avec la plus grande énergie et la plus grande habileté la reconnaissance chargée de poursuivre Samory, après le combat de Tiafesso, a fait preuve d'initiative en se lançant résolument sur les derrières de l'almamy, ce qui lui a permis de s'emparer sans coup férir de lui et de toute son armée.
« Le lieutenant Wœlffel : a conduit avec une audace et une énergie dignes d'éloges une petite reconnaissance qui a abouti au combat de Tiafesso, cause déterminante de la fin de Samory.
« Le sergent Bratières : aidé du lieutenant Jacquin a, de ses propres mains, pris Samory en personne, après l'avoir poursuivi à la course. »
Le 17 décembre, une dépêche du gouverneur me rappelle à l'état-major de Kayes. Je quitte Beyla le lendemain, sans regret. On m'a donné à conduire un certain nombre de sofas pour les travaux du chemin de fer.
La route de Beyla à Kérouané donne de magnifiques vues de montagnes, particulièrement du col fameux du Goïffé.
On me dit que Samory, en passant à Kérouané et à Sanankoro n'a pu s'empêcher de pleurer. Je salue à Bissandougou la tombe du commandant Dargelos, mon ancien chef de Bougouni.
Je monte toujours mon petit cheval Kourma, infatigable. Au cours d'une étape, je m'établis pour la journée sous un bel-arbre, le village étant comme toujours très encombré, avec des rues très serrées et chaudes. Youssouffi, mon petit palefrenier, qui avait emmené mon cheval au village, revient en courant :
— Viens vite ! viens vite ! Kourma ! y a mangé poulet ! Je t'avais bien dit que c'était un homme !
J'arrive et trouve tout le village rassemblé, autour du cheval qui continue tranquillement à manger son mil étendu sur une couverture à terre. Un poussin, assez gros m'a-t-on dit, étant venu picorer, Kourma l'avait happé d'une bouchée. Un cheval mangeant un poulet… c'était évidemment un homme.
Le 2 janvier 1899, à Siguiri, je retrouvai le commandant de Lartigue, qui me montre une lettre du général de Trentinian disant qu'il a envoyé la demande de rectification de l'ordre au ministre, avec prière de demander au colonel Audéoud de faire lui-même la rectification. Je ne m'en occupai plus, et je fis bien, car la question ne fut réglée que dix mois plus tard.
La route me ramène encore une fois à mon vieux poste de Kita. Sur le mur de mon ancienne chambre, on a épinglé une image du Petit Journal Illuslré, à propos de la prise de Samory, représentant mon père, un verre de champagne à la main, au milieu de ses élèves de l'hôpital de la Charité, dont il était alors le médecin-chef.
A Kayes, le 25 janvier, j'eus le bonheur de recevoir du général de Trentinian la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur, cette croix tant espérée de tous les officiers, de tous les soldats, qui fut donnée en même temps à mes compagnons d'armes du 29 septembre : Gaden, Boyé, Jacquin, Georges Mangin, Bratières. Le général me remit aussi le sabre de Sarankégny Mory, la hache de parade, le chasse-mouches et le diala de cabochons de Samory. J'avais conservé dès le début, avec l'autorisation du commandant de Lartigue, la petite chaise de bois sur laquelle Samory était assis au moment de la surprise.
Enfin, je pars rapatrié à la mi-mars, le général de Trentinian me donne une preuve de confiance : il me charge de lui trouver à Saint-Louis ou à Dakar, une villa, où il puisse au cours d'une inspection des troupes dont il est chargé, recevoir pendant quelques semaines Mme de Trentinian qu'il vient d'épouser. Mission flatteuse, mais embarrassante pour un vieux blédard. Ce ne fut pas facile. Je ne trouve rien, ou l'on ne sait rien me procurer à Saint-Louis. Il n'y a à Dakar qu'une « villa » à louer, et encore pour un an. Le général de Trentinian m'ayant donné carte blanche, je louai pour cette période. Hélas ! l'année suivante, épidémie de fièvre jaune et le général ne put pas de longtemps sous-louer sa maison.
Notes
1. Sèbè : papier.
2. Diassa ou sanié : Enceintes de palanques formées de pieux non équarris.
3. Mot qui correspond en arabe à Smalah.
4. Touré était le nom de famille de l'almamy Samory.
5. Ceux qui avaient été à Tiafesso avec Wœlffel ont évalué cette foule à 50.000 personnes, parce qu'ils ont eu l'impression qu'il y a au camp de Samory plus du double de ce qu'ils avaient compté à Tiafesso. Ces chiffreà sont évidemment approximatifs.
6. Diaoulé veut dire : la « bouche rouge ».
7. Chéitane : le diable.
8. Bilakoros : jeunes gens [non-circoncis]
9. Erratum. Gouraud reprend ici une source erronée. Sur l'enfance et la carrière de Samori, il faut se reporter à Yves Person et à Ibrahima Khalil Fofana [Tierno Siradiou Bah]
10. Le gouvernement français pour Samory et les Noirs, c'est une haute personnalité, un empereur.
11. Le Soudan a eu longtemps la réputation de produire de l'or. Il y en a dans le Bambouk, dans le Falémé qui appartient au Sénégal. On en trouve aussi au Kissi, et Samory en avait ; mais les procédés d'extraction étaient simples, les travailleurs n'étaient pas payés et étaient mal nourris.
12. Dialas : longues chaînes à petits cabochons en argent qu'on enroule autour de la coiffure.
 Chaland de Gouraud sur le Niger |
 Danseuses de Kita |
 Une famille de la Forêt |
 Fête de circoncision |
 Filles de Samori |
 Piroguiers Bozo du chaland de Gouraud sur le Niger |
 Route de cadavres |
 Samori sous escorte |
 Samori dans un jardin de bananiers |
 Vue de Segou Sikoro |
 Segou Sikoro |
 Dia Fodé, chef sofa de cavalerie rallié aux Françaiss |
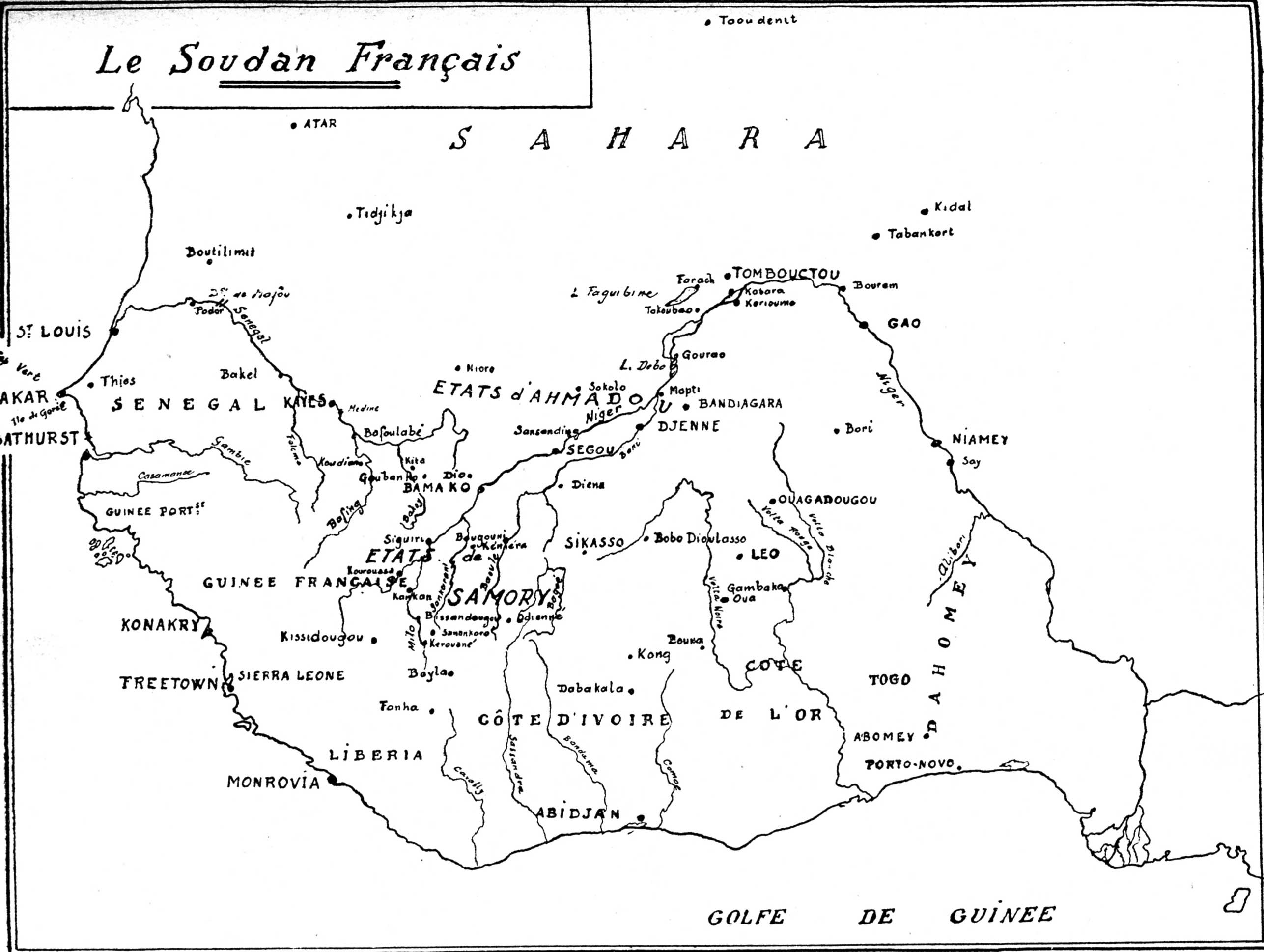
[Home | Bibliothèque
| Histoire
| Recherche | Aser | Bambara | Bambugu | Bozo Jakhanke | Jalonke | Jawara
Kagoro | Kasonke Konyanke | Koranko | Lele | Maninka | Marka | Mau | Mikifore | Nono
Sankaran | Sidyanka | Soninke | Susu | Toronka | Wasulunka
]
Contact : info@ webmande.site
webMande,
webAfriqa,
webPulaaku,
webFuuta,
webCôte,
webForêt,
webGuinée,
Camp Boiro Memorial,
Semantic Africa, BlogGuinée. © 1997-2016. Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.