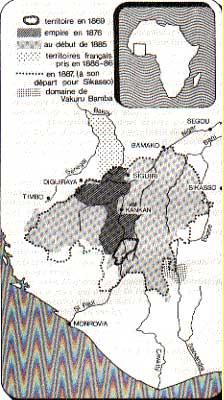
Professeur à La Sorbonne
Avec la collaboration de Françoise Ligier
Editions ABC. Paris. Dakar. Abidjan. 166 pages
Collection Grandes Figures Africaines
Direction historique: Ibrahima Baba Kaké — Direction littéraire : François Poli
L'enfance des héros est souvent entourée de légendes. Car comment admettre que celui qui mènera les hommes ait connu des années obscures ? Araignées inventives, ceux qui l'ont approché tissent autour de sa naissance un réseau de miracles. Samori ne fait pas exception.
Non pas qu'il ait été fils d'homme riche, ou même de guerrier remarquable. Son père, Laafiya Touré, a, pour l'essentiel, délaissé l'aventure que vécurent ses ancêtres, colporteurs dioula qui firent commerce avec les musulmans du Nord. Ayant oublié leur long contact avec l'islam, il s'est fixé, animiste parmi les animistes, dans le bas Konyan, à Manymbaladougou. Là, ses femmes cultivent la terre, et il surveille, entre deux opérations commerciales, ses troupeaux.
Parmi ces femmes, Masorona — sans doute la première — appartient à une puissante lignée des Kamara, alors maîtres du pays. Or, et voilà qu'apparaît la légende, on dit que Masorona demeura stérile pendant deux ans. Laafiya, sur sa demande, alla consulter un devin connaissant la manière de lire dans le sable. Celui-ci, ayant prié Dieu, prédit que dans peu de temps Masorona deviendrait grosse, qu'elle accoucherait d'un garçon et que celui-ci serait illustre parmi les faama.
Un songe devait confirmer cet espoir ; Laafiya vit une nuit un serpent qui, sortant de ses reins, grandissait et montait à l'assaut du ciel. La signification de ce rêve était claire : le fils qui allait naître serait grand parmi les plus grands. Et l'enfant naquit. Il est difficile de préciser le mois : l'année même est incertaine. Il semble que l'événement se soit produit en 1830 d'après certains recoupements.
L'enfance de Samori paraît s'être passée sans grands problèmes. Selon la coutume, il grandit pendant ses premières années au milieu des épouses de son père, puis fut envoyé dans sa famille maternelle pour parfaire son éducation. Le seul témoignage que l'on a sur cette période est le suivant :
« Souvent, il organisait des expéditions avec des jeunes de son âge qui, la nuit comme le jour, allaient marauder des oranges ou des tubercules de manioc dans les champs des villages voisins. Toute une bande de jeunes gens fut très tôt attirée par ce garçon auquel personne ne disputait le rang de chef, car, de l'initiative, il en avait comme pas un, et son sens de l'équité dans le partage du butin lui conservait la sympathie de tous. Les réprimandes et les corrections reçues de ses parents ne modifièrent en rien son comportement… »
Mais qui pourrait douter que celui qui allait devenir le maître d'une grande partie de l'Afrique avait, dès son enfance, le sens du commandement ? Comme ses compagnons, il subit la circoncision, première étape indispensable pour devenir un homme. Sans doute, son père aurait-il fait pousser plus loin son initiation si Samori ne lui avait opposé sa première révolte…
Il semble en effet que l'existence champêtre de Manyambaladougou pèse rapidement au jeune homme. Il étouffe dans des limites trop étroites. Il sent sourdre en lui ce besoin de voyage qui porta ses ancêtres jusqu'à Tombouctou. Comme eux, il se fera marchand. Il ne paraît pas que le vieux Laafiya se soit opposé aux désirs de son fils. Il vend une génisse pour lui permettre de constituer son premier fonds. Il le recommande à des Dioula puissants qui lui serviront de guide.
Intelligent, audacieux, possédant de nombreux appuis des deux côtés de sa famille, Samori a tout pour réussir dans son métier de commerçant. Il cesse vite d'être le colporteur traînant sa marchandise de village en village ; il se fait un nom dans le trafic du cola. Malgré son jeune âge — quand il entre dans la carrière, il a environ dix-huit ans —, il paraît digne rejeton des vertus de spéculation et de calcul qui ont fait la renommée de ses ancêtres. Une seule ombre à ce bel avenir: si le jeune homme possède le sens des affaires, son caractère est ombrageux. La souplesse, l'humilité, grâce auxquelles on décroche des marchés lui sont dès l'abord inconnues. Il se refuse à distribuer les flatteries et les courbettes. Il règle plus volontiers les litiges par la force de ses poings que par les longues palabres où l'on guette, le verbe haut, les réactions de l'adversaire…
Il sait imaginer des stratégies guerrières : ainsi le jour où il parvint avec quelques villageois à mettre en fuite les sofas des musulmans Sissé venus razzier les troupeaux de Manyambaladougou. Curieuses dispositions pour un homme que tout prépare à devenir un honorable commerçant…
Il faut dire que, dans les tractations amiables, son physique le dessert. Il n'a rien du voyageur rassurant, porteur non seulement de marchandises mais de nouvelles, distrayant les femmes, égayant les plus méfiants… Il est grand, plus robuste que la moyenne. Quand il sourit — lorsqu'il sourit —, ses dents aiguisées en pointe sont aiguës comme celles d'un lion. Il a le regard profond et perspicace. Pourtant, ce sont ses mains qui retiennent l'attention : la peau en est, en larges plaques, décolorée. Cette teinte douteuse et rosâtre n'est-elle pas le signe de pouvoirs redoutables et secrets ?
Mais peut-être, l'âge venant, et la fatigue et l'habitude, Samori serait-il devenu en fin de compte un bon marchand. Un événement allait décider de sa vie.
Il était absent de Manyambaladougou lorsque les hommes des Sissé revinrent envahir le village. Honteux d'avoir été mis en fuite par de simples paysans, ils ne se contentèrent pas de razzier les génisses. Ils tuèrent les hommes qui, n'ayant pas fui, leur résistaient et emmenèrent captifs les femmes et les adolescents. Or, Masorona Kamara, la mère de Samori, faisait partie des otages.
Le colporteur est bien loin du Konyan lorsqu'on lui apprend le désastre. Il rentre précipitamment. Les cases fument encore. Cherchant inutilement son père, il finit par le découvrir réfugié non loin de là, chez des parents. L'entrevue est houleuse, Samori bien près d'oublier le respect qu'il doit à Laafiya. Comment celui-ci a-t-il été assez lâche pour ne pas défendre ses épouses ? Comment est-il assez avare pour ne pas payer la rançon qui rendrait la liberté à Masorona ?
C'est décidé ? Laafiya ne veut rien faire ? C'est bien. Samori ira lui-même négocier la liberté de sa mère chez les Sissé. Laafiya tente de le retenir : les pillards lui ont fait perdre une épouse. Faut-il qu'en plus il perde le plus aimé de ses fils, et le premier? Un marchand ne peut lutter contre les sofas …
Paroles inutiles. Samori partira le soir même. Il ne prendra pas d'armes. Tout juste un baluchon contenant ses affaires. Il brûle les étapes. Il se rend, méprisant les conseils, à Madina, chez le terrible Séré-Burlay, faama des musulmans.
Quand il parvient à la cour du monarque, la situation de sa mère est moins dramatique qu'il le craignait : Masorona Kamara est de bonne noblesse ; une alliance tacite unit depuis longtemps les Sissé et les Touré… N'importe. Il ne sera pas dit que la mère de Samori demeure, même honorablement, captive… Le jeune homme s'agenouille devant Séré-Burlay. Il lui demande :
— Pour libérer cette femme, que faut-il ?
Séré-Burlay répond :
— Si tu me fournis sept captifs, tous vigoureux et en bonne santé, Masorona Kamara sera libre.
Samori réfléchit un instant :
— Si j'avais rassemblé l'argent, je te livrerais sans attendre ces captifs. Mais je suis encore jeune et mon commerce rapporte peu de chose. Permets-moi de gagner la rançon.
— Comment le permettrais-je ? Crois-tu que j'aie besoin de marchands ?
— Demeurer marchand n'est pas ce que je souhaite. Accepte-moi parmi tes guerriers. Bientôt j'aurai gagné la rançon de Masorona.
Séré-Burlay regarde le solliciteur. Il voit ses muscles déjà noueux et durs. Pourtant, disent certains témoignages, le faama hésita longtemps. Certaines prédictions affirmaient qu'un jeune homme, semblable en tout à Samori, viendrait un jour le saluer humblement, que celui-là serait son ennemi et plus tard son vainqueur implacable, que les Sissé perdraient leur trône à son profit… Mais comment refuser une si belle recrue ?
Séré-Burlay accepta la requête de Samori, et celui-ci fut affecté dans la garde personnelle du faama.
Voici donc Samori débutant une nouvelle carrière pour laquelle il se sent infiniment mieux doué que pour ses essais de commerce. En très peu de temps, ses exploits lui permettraient de libérer sa mère. Pourtant, il reste ; la vieille Masorona demeure auprès de lui. Le roi Séré-Burlay paraît, de son côté, peu soucieux de perdre un guerrier si illustre. Il le choie, le couvre de présents et lui offre deux très belles captives…
Séré-Burlay paraît avoir oublié les prédictions funestes concernant Samori ; il n'en est pas de même de son frère : Séré-Brèma déteste cet étranger. Il consulte plus souvent qu'il ne faut les oracles ; tous lui rendent la même réponse : Samori renversera les Sissé. Il sera le maître du monde… Un des marabouts les plus célèbres confirme la prédiction : au milieu des guerriers rassemblés, il se dirige vers Samori. Il regarde longuement les traces blanchâtres de ses mains. Il y décèle les signes de sa gloire et la mort de la dynastie sissé… Séré-Brèma a beau prévenir son frère, le mettre en garde contre l'imminent danger, le roi refuse de savoir : il comble d'amitiés Samori, il compte sur sa force pour gagner les batailles…
Samori jouira pendant cinq ans de la protection du monarque. Hélas, vers 1859, Séré-Burlay disparaît brutalement. Il meurt de mauvaises blessures qu'il a reçues au siège de Kobobi-Kourou. Selon les lois de succession, son frère, Séré-Bréma, l'ennemi de Samori, prend la direction du royaume.
Mais comment s'attaquer au jeune homme dont la réputation est grande ? Une manúuvre à son encontre serait peu appréciée. Pendant plusieurs mois, Séré-Brèma, attentif, guette la moindre faute. Celle-ci se produit lors de la prise de Kobobi-Kourou. A tort ou à raison, le nouveau faama déclare que Samori s'est mal conduit pendant l'attaque. Il le condamne à la peine du carcan — honte suprême — pendant huit jours. Le guerrier n'oubliera pas l'injure. Pourtant, il ne se rebelle pas : sa mère, bien que n'étant plus prisonnière, demeure encore chez les Sissé. Les conséquences d'une révolte mal préparée risqueraient de retomber sur elle. Néanmoins Samori le sait : Séré-Brèma désire sa mort, son salut n'est que dans la fuite.
La tradition raconte comment Samori et Masorona réussirent à quitter le royaume des Sissé.
Samori, qui était beau, avait de nombreuses maîtresses. Une de celles-ci lui fit parvenir un message :
— Attends-moi à l'endroit où je lave le linge. Ce que j'ai à te dire importe pour ta vie.
Connaissant la fidélité de la femme, Samori vint au rendez-vous. Il la trouva tremblante ;
— O mon maître, dit-elle, si tu ne me crois pas, tu mourras dans dix jours.
— Comment cela ?
— Tous les vendredis, les sofas dansent devant Séré-Brèma.
— Eh bien ?
— Non pas à la prochaine réunion mais à la suivante, ta mort est décidée.
— Qui te l'a dit ?
— Le faama quand il a confisqué mes bijoux.
— Je ne te comprends pas.
— Il a ordonné qu'on fonde avec eux quatre balles d'or mêlé de plomb. Un marabout les a chargées de son pouvoir ; tes amulettes ne te protégeront pas. Vendredi, dans huit jours, quatre soldats tireront sur toi pendant la danse.
Ainsi parla cette femme et Samori la crut. Pourtant, devant le faama il feignit un grand calme. Il dansa le premier vendredi et sollicita la bénédiction de Séré-Brèma. Trois jours avant la seconde danse, il alla le trouver :
— O faama, dit-il, je viens te prier pour ma mère. Une de nos parentes est gravement malade à deux jours d'ici. Elle souhaite revoir Masorona avant sa mort.
Séré-Brèma accepta sans méfiance le départ de la mère de Samori. Peut-être préférait-il qu'elle soit loin le soir du vendredi fatal. Masorona partit donc. Samori attendit deux jours. Le jeudi, peu après le coucher du soleil, à son tour, il disparut. La mère et le fils avaient depuis longtemps fixé un rendez-vous. Ils se retrouvèrent, mais pour fuir n'empruntèrent pas la grande route conduisant à Manyambaladougou. Ils prirent des chemins détournés. Heureuse précaution : Brèma envoya ses hommes à leur recherche. On dit que Samori et Masorona durent se cacher dans les roseaux pour avoir la vie sauve. Mais ce qui est écrit demeure vrai : quelle qu'ait été la fureur de Séré-Brèma, tous ses efforts furent vains et aucun sofa ne rejoignit les fugitifs.
L'anecdote qui conclut cette fuite mérite également qu'on la rapporte. Un soir, la nuit s'annonçant froide, Samori coupa des branches et alluma un grand feu. Peut-être saisie par la fièvre, épuisée par la longue marche, Masorona frissonnait. Samori prit alors l'unique couverture qu'il possédait et l'en couvrit. La vieille s'endormit, hélas, près du foyer. Au milieu de la nuit, une étincelle jaillit et enflamma la couverture. Samori ayant rapidement éteint l'incendie, Masorona dit à son fils:
« Tu as renoncé à la liberté pour me secourir, c'est pourquoi tous les hommes seront tes captifs. Tu m'as donné ta seule couverture et elle a brûlé, c'est pourquoi Dieu te donnera tant de vêtements que tu ne pourras les porter. Voici des années que je suis séparée de ma fille Masa, c'est pourquoi Dieu te donnera des fils et des filles innombrables. »
Ainsi Samori quitta le royaume des Sissé. Pauvre il était venu, pauvre il s'en revenait, mais il avait acquis des biens parmi les plus précieux : la science des armes et l'expérience.
Cette expérience que Samori vient d'acquérir n'est pas seulement du domaine militaire. Comme nous l'avons dit, le héros est né en milieu animiste ; ses ancêtres, jadis musulmans, étant revenus aux religions traditionnelles. Sa brève carrière de marchand l'avait, tout au moins de façon formelle, ramené vers l'Islam. En effet, chez les colporteurs dioula, être animiste n'est pas admissible. Samori avait donc rasé ses trois nattes et pratiqué les cinq prières plus ou moins dévotement. Une tradition veut que le Prophète lui soit apparu en rêve et l'ait armé de ses propres mains. Cette légende, qui date du temps où Samori, devenu almami, se voudra chef des Croyants, résiste mal au regard de l'histoire. En fait, il semble que le jeune colporteur ait, tout au moins au départ, pratiqué la religion musulmane comme une des servitudes liées à sa profession. Son séjour chez les Sissé lui révèle un autre visage de l'Islam. En effet, Séré-Burlay et son successeur se livrent aux exactions et aux pillages sous le drapeau de la guerre sainte. Est-ce le fait que son village en ait été victime ? Cette fanatique croisade ne parait pas convaincre Samori. Cependant, sur le plan pratique, il constate que les cavaliers musulmans sont bien plus efficaces que la piétaille des païens. Il saura s'en souvenir plus tard…
Mais actuellement, sa seule valeur étant son renom militaire, il est entièrement démuni. Une brève halte le ramène à Manyambaladougou ; là, épuisé par un trop long exil, Masorona meurt brusquement. Le décès de sa mère marque profondément Samori et brise les seuls liens qui le retenaient dans son village. Son séjour chez les Sissé le lui a fait comprendre : plus jamais il ne sera marchand. Il doit assumer son destin, celui de soldat de fortune.
Encore faut-il qu'il trouve à s'employer.
Une fois encore, il est servi par le hasard. Le vieux Laafiya, retiré à Sanankoro, ayant prié son fils d'aller recouvrer une créance. Samori se rendit chez le débiteur qui le reçut fort mal :
— La dette était-elle réelle ?… Que Samori revienne un peu plus tard. Ne voyait-il pas que l'on célébrait des funérailles ?
Que faire lorsqu'on est seul en pays étranger ? Samori réprimait ses désirs de vengeance lorsque survint un puissant souverain. Saranswaré-Mori, faama des Bérété, était venu en personne assister à la cérémonie. Les Bérété, depuis longtemps adversaires des Sissé, tentaient après une pénible éclipse de reconstituer leur puissance. Or, apprenant l'histoire de la créance réclamée par Laafiya Touré, Saranswaré intervint en faveur de Samori. Il mit curieusement son pouvoir dans la balance. Le mauvais payeur dut s'exécuter. Comme Samori s'apprêtait à partir, le faama le retint. Il lui dit :
— Je sais que tu es libre. Veux-tu combattre parmi mes sofas ? Tu auras un, commandement.
Samori ne tarda pas à rendre sa réponse. Non seulement son cousin Téré-Yara Kamara était l'allié de Saranswaré-Mori, mais encore le frère d'arme du faama était un ancien compagnon de colportage. Auprès de quel chef le jeune homme aurait-il trouvé un milieu aussi favorable ? C'est dit : il sera mercenaire des Bérété.
Cette période durera trois ans. Une fois encore, Samori va se distinguer, dans toutes les guerres, aider les Bérété à retrouver un prestige qu'ils n'avaient plus. Pourtant, une fois encore, l'expérience se termine non par la gloire mais par la fuite: à la suite de dissensions internes, Saranswaré-Mori fait assassiner son allié Téré-Yara, dont il redoute l'influence. Samori, dont la renommée s'est accrue, craint de subir le même sort ; au début de 1861, il quitte discrètement la cour des Bérété. Cette fois, il ne s'enfuit pas les mains vides. Il possède non seulement un cheval — cadeau inestimable de Saranswaré-Mori — mais aussi des captifs. Va-t-il s'en contenter ?
A plus de trente ans, le guerrier est las d'obéir à des maîtres. Un héritage venu de sa mère le décide à tenter sa chance et à la tenter seul. Il lance un appel à tous ceux qui désirent le rejoindre. L'appât n'est pas grandiose : il promet simplement qu'il nourrira ses hommes… Oui, mais on sait ce que vaut Samori. On sait aussi que, contrairement aux autres chefs, il a conservé les habitudes de son enfance et partage scrupuleusement le butin.
Aussi est-il entendu. Parmi ses recrues, beaucoup de marginaux jouant leur dernière carte, mais aussi de bons guerriers, des fidèles comme ses deux frères Kémé-Brèma et Maningbé-Mori, qui lui serviront de lieutenants. Avec cette troupe hétéroclite, Samori s'installe à Sokurula, et là, il faut bien vivre. D'une façon que nous devons bien qualifier d'abusive, le chef de bande lève un tribut sur tout le haut Kiro. En son nom ? de quel droit ? Il se présente sans vergogne comme l'émissaire de Saranswaré-Mori.
Le roi des Bérété, déjà mécontent de la façon dont Samori a quitté son royaume, l'apprend rapidement, Comment tolérerait-il cette nouvelle insulte à sa puissance ? Cependant, se méfiant du talent militaire de son ancien sofa, il ne l'attaque pas de front.
Un soir que Samori se repose chez une de ses femmes avec ses deux frères, la case est encerclée. Les Bérété, qui s'étaient assuré des alliances, pénètrent dans la cour. Ils sont nombreux et bien armés. La résistance est inutile, Samori et ses frères se rendent. On les conduit sans ménagement à Sirambadougou, la capitale de Saranswaré-Mori, Samori a, le soir même, la tète et les bras emprisonnés dans le carcan. On renvoie Kémé-Brèma et Maningbé-Mori, piètres comparses.
Le lendemain, le faama rendra visite au prisonnier. Le voir ainsi humilié, exposé aux moqueries de tous, n'adoucit pas sa rage. Il saisit le bâton sur lequel il s'appuie et frappe Samori au front de toutes ses forces !
La cicatrice sera indélébile, comme restera indélébile cette seconde humiliation. Plus d'un mois, Samori subira le carcan. Sans doute la punition aurait-elle duré davantage si un ami, défiant les gardes, n'avait délivré le prisonnier discrètement.
Et voici une fois encore Samori fugitif : il ne possède rien, uniquement un fusil. Il fuit et Saranswaré-Mori le traque. Il le pourchasse de village en village. Un soir, le futur almami devra suffoquer plusieurs heures dans un grenier plein de gousses de néré tandis que les sofas fouillent méticuleusement toutes les cases.
Sans doute les tentatives malheureuses enrichissent les jeunes hommes, mais Samori est maintenant adulte. Il n'est plus temps d'apprendre, mais de construire. Les faits l'ont démontré : son ambition s'accorde mal avec le respect et l'obéissance. Il n'est pas né pour être serviteur. Ses aventures avec les Sissé et les Bérété lui ayant fermé les portes des royaumes d'Islam, où trouverait-il un prince à sa mesure ? Ses seuls alliés possibles demeurent les païens. Eux, ses frères d'enfance, le comprennent. N'est-il pas fils, par sa mère, d'une grande lignée Kamara ? Mais, Samori en a conscience, ses nouveaux partenaires sont faibles, non certes par le nombre, mais par l'armement et l'organisation : on trouve chez eux plus de coupe-coupe que de fusils, davantage de chefs indisciplinés que de stratèges. Il faut pourtant composer avec eux. Le moment est à la fois bien et mal choisi. Bien si l'on s'appuie sur leur peur, mal si l'on veut jouer de leur force. En effet, les Sissé ont dévasté le pays animiste, forçant les conversions, détruisant les villages ; les Bérété, bien qu'ayant subi des revers, ont encore des sofas redoutés. Décimés, malmenés, les animistes se partagent entre la révolte et l'impuissance.
Mais il n'est pas question d'attendre. Il faut trouver l'endroit écarté où l'aigle saura grandir à l'abri des vautours.
Ce lieu, Samori le découvre. Dyala possède peu d'habitants mais est admirablement situé dans les grandes montagnes du Gben : non seulement la région est habitée par les parents maternels de Samori — le village de Masorona se trouve 15 kilomètres plus au nord —, mais elle est proche des terres de Masara-Séri, un des fidèles beaux-pères du héros. De plus, Dyala est accroché sur une hauteur d'où l'on peut contrôler la vallée.
Samori propose ses services au chef du village. Celui-ci accepte sans peine ce concours déjà prestigieux. Non pas qu'il l'ait attendu pour se défendre : les fusils qu'il a rassemblés lui ont évité les pillards et permis — utilisation plus douteuse — de rançonner de nombreux colporteurs. C'est donc à un homme averti que Samori apporte son alliance.
Il fait, s'il le fallait, ses preuves. Mais ses expériences lui ont prouvé que l'ami est souvent plus dangereux que l'adversaire. Aussi sa première action est-elle de s'assurer la fidélité de tous les siens. Il réunit à Dyala non seulement les nobles, ses proches et ses parents, mais également les gens de caste qu'il est indispensable de se concilier.
Ils viennent de tous les villages. Samori leur déclare :
— Tantôt les Sissé vous malmènent, tantôt ils vous assujettissent par les promesses d'une religion dont ils se servent pour nous exploiter. Et moi qui suis votre parent, moi qui vous traiterais comme des oncles, vous refuseriez de m'aider ?
Les exactions de l'ennemi sont encore proches. Le climat est favorable à Samori. Celui-ci se fait humble. Il refuse la gloire. Il renouvelle les marques de respect qu'il porte à ses vénérables « parents ». Que veut-il, lui, l'ancien colporteur ? Uniquement les servir. Qu'on l'accepte comme chef de guerre, « kélétigui », la charge lui suffit, il juge qu'il sera utile.
Et l'assemblée accepte. En prenant ce bon serviteur, elle vient de se donner un maître, mais cela, elle ne le sait pas.
Il faut dire que la puissance dont on a investi Samori paraîtrait à notre époque totalement dérisoire. Qui a-t-il sous ses ordres ? Sept hommes armés de fusils. Non, il ne s'agit pas d'une erreur : sept hommes… et en plus le pouvoir théorique d'appeler sous les armes les jeunes gens des environs. Oui, c'est avec sept hommes que commence l'épopée et que va grandir la légende. Samori a donc intérêt à ménager ses compagnons.
Sa première décision est de fortifier Dyala. Mais comme il est devenu sage, il ne s'aventure pas à couper un seul arbre, à dresser un seul rondin sans avoir consulté ses alliés. Lui-même parcourt les clans Kamara pour expliquer qu'il ne s'agit pas d'un acte de méfiance. Il insiste en parlant des Sissé :
— Ces gens me menacent et je ne puis mettre mon père à l'abri sans une forte clôture. Je suis votre parent et ne vous tromperai pas, tandis que les étrangers viendront tout piller.
Et une fois encore on le croit. Certains voisins acceptent même d'envoyer leurs fils en renfort.
Quand Samori eut terminé de clore Dyala, il fit venir Laafiya et le reste de sa famille. Alors, comme l'année d'avant, il commença à recruter des jeunes gens. Les candidats se présentèrent nombreux et ils ne s'en repentirent pas : Samori, selon sa promesse, nourrissait bien ses hommes. On dit que tous les troupeaux du vieux Laafiya passèrent dans les cuisines de l'armée.
Rapidement, les vaches et les brebis de Laafiya Touré cessent d'être en nombre suffisant. Encore une fois, il faut que Samori parvienne à faire vivre une troupe vorace sans posséder aucun moyen. Et une fois encore, voilà que tout se gâte. Car où trouver le grain, le bétail, les esclaves sans les conquérir par la force chez ses proches voisins, autant dire ses alliés ? Il tente de jouer des rivalités qui divisent les chefs. Il aide celui-ci à punir celui-là. Mais dans ce pays où chacun est plus ou moins cousin ou vassal de l'autre, le jeu est difficile.
Ainsi Samori s'aliène l'amitié d'un des plus puissants des chefs Kamara, le patriarche Manankolo. Celui-ci a accepté, sans trop y réfléchir, l'aide empressée du kélétigui ; grâce à lui, il s'est vengé d'une ville où l'on a molesté ses hommes. La cité détruite, il n'a pas refusé les deux tiers du butin. Très vite, il s'en repent : les autres Kamara lui reprochent d'avoir favorisé les exactions de Samori, de s'être laissé manoeuvrer par ce jeune fauve aux dents trop longues… Et le vieux chef avoue :
« Cet enfant m'a trompé. Il m'a demandé de construire un sanyé contre les brigands et c'est lui qui se conduit en brigand. »
Or, apprenant cette réaction, Samori n'essaie pas de se concilier Manankolo. Au contraire, il le nargue, lui reprochant d'avoir sans réflexion dilapidé tout son butin. Outragé, le vieillard se retourne contre celui qui ne le respecte plus. Il prend soudain conscience de la place qu'occupe le petit marchand de cola. Il décide de le mater et ses alliés l'approuvent.
Samori vient de commettre une nouvelle imprudence, un dernier péché de jeunesse. Les moins belliqueux désirent annihiler ce chancre qui s'étend, chair insatiable au milieu de leur pays. La mise à mort est décidée, deux importantes colonnes sont facilement formées.
On les fait converger vers Dyala. Le kélétigui est cerné de partout. Il prépare ses défenses, mais quelles défenses ? Il possède à peine cinquante hommes, encore a-t-il battu le ban et l'arrière-ban… Va-t-il connaître encore une fois le carcan et la défaite ? Le temps presse : les troupes de Manankolo montent à l'assaut des pentes ; ses alliés ont gravi la montagne sur l'autre versant ; ils vont prendre le kélétigui à revers. Samori est-il perdu ? Pas encore, il possède deux atouts : le génie militaire et des fusils.
Les assaillants, sans commandement réel, se précipitent dans le désordre. L'assiégé fait ouvrir le feu. Bien protégés par les remparts, ses hommes épaulent de façon efficace. Quand la nuit tombe, il ne reste, en dehors des murs, que des morts et des blessés qui râlent. Les cinquante de Dyala sont indemnes et vainqueurs. Samori, sans vouloir s'étonner de la victoire, leur dit :
— Comment auraient-ils pu nous vaincre ! N'avons-nous pas prêté serment, eux et moi, de nous entraider et de ne jamais nous combattre ? Ils ont voulu détruire Dyala. Comment Dieu ne les aurait-il pas punis ?
Cette opinion n'est pas uniquement celle du kélétigui.
D'autres encore, chez les Kamara, influencés sans doute par la victoire, commencent à murmurer qu'il est mal de se parjurer quand on s'attaque à Samori. L'occasion paraît bonne à ce dernier. Il est las de son exil dans les montagnes, petit chef marginal ne devant sa survie qu'à son éloignement.
En fait, il n'a jamais cessé de préparer son retour. Sa place, Samori en a bien conscience, se trouve à Sanankoro, au carrefour des grandes routes qui relient le sud au nord : dans la plaine où il est possible d'entraîner les chevaux. Dès cette époque, le fils des colporteurs qui allaient à pied se passionne pour la mobilité et la rapidité des cavaliers musulmans du nord.
Il décide de redescendre des montagnes. Mais ce ne sont pas les louanges et l'hommage des griots qui l'attendent. Ses « oncles » — terme dont Samori salue les chefs Kamara — professent la plus grande méfiance pour les talents de leur « neveu ». Ils disent :
— Entre ces deux montagnes, c'est notre terre et on ne peut la donner à personne, pas même à un parent. Si celui-ci est trop fort, il nous trahira et prendra le pays.
Samori, feignant de se désister, leur rétorque :
— Je ne voulais pas rentrer. Les Sissé m'honoraient et m'offraient des captifs, mais ils préparaient la guerre contre vous, mes parents, et j'ai voulu vous prévenir. Je sais combattre comme ils le font, mais mon vrai métier est le colportage. Vos fils vont me mépriser et m'obéiront mal. Choisissez donc l'un d'eux pour commander votre guerre ; moi, je vais retourner au commerce.
La menace semble porter. Les Kamara hésitent, soupesant le danger que présentent les Sissé et leur « neveu ». Enfin, retrouvant la croyance un peu légère que leur propre sang ne saurait les trahir, ils supplient le kélétigui :
— Tu viens nous avertir du danger, tu peux nous sauver et tu te dérobes ? Prends nos fils, apprends-leur à bien faire la guerre, nous les obligerons à t'obéir.
La partie est gagnée. Samori expose ses exigences :
— Si je dirige votre guerre, il faut que je vienne là où l'on petit faire courir les chevaux.
Puis, habilement, il tempère :
— Cependant, cette terre est à vous : le jour où vous me renverrez, je partirai derrière la montagne.
Promesse qui coûte peu. L'important est qu'il s'installe à Sanankoro avec sa famille et s'entoure de ses frères qui le secondent fidèlement. Là, il commence à recruter ce qui devient au sens moderne une armée véritable. Evidemment, il n'est pas trop regardant en ce qui concerne les recrues : on trouve parmi ses compagnons beaucoup plus d'hommes de caste que de descendants de familles « honorables ». Mais ces guerriers, dont la plupart n'ont rien à perdre, lui paraissent fidèles. Samori leur apprend l'usage des armes à feu. Suivant, avec ceux qui le souhaitent, les préceptes du Coran, il ne manifeste aucun fanatisme et enrôle, ce qui rassure son entourage, un nombre suffisant d'animistes Kamara. Chacun pratique comme il le désire, du moment qu'il sait obéir et se montre courageux.
Nous sommes alors en 1862 ; Samori va employer les deux ans qui vont suivre à assurer son hégémonie sur tout le bas Konyan. La tâche lui est, une fois encore, facilitée par les dissensions opposant les villages. Alternant avec habileté les épreuves de force et la conciliation, il étend peu à peu son pouvoir. Lorsqu'il mate des révoltes, il ne réduit pas en esclavage les vaincus : magnanime, il les renvoie chez eux, les assurant de son désir de paix. Devenu sage, il parvient même à se réconcilier avec le vieux Manankolo. Afin de ménager la susceptibilité du vieillard, il accepte de se prosterner devant lui ;
« Car, lui dit-il, n'es-tu pas la tête des Kamara ? Je n'en suis que le bras, ma force ne vaudrait rien sans ta sagesse. »
Paroles lénifiantes et somme toute sans conséquences, lui assurant la neutralité plus ou moins bienveillante du vieux chef.
En 1864, Samori peut estimer qu'il a les coudées franches : plus aucune tentative de révolte parmi ses partenaires du bas Konyan. Sans conteste, tout le pays à l'ouest du fleuve Dyon lui-appartient. Il va falloir passer aux affaires sérieuses.
Avec le recul de l'histoire, on peut estimer que, depuis son retour à Sanankoro, tous ses adversaires avaient bien peu de chances de résister à Samori.
Il n'en est pas de même des princes musulmans : les Sissé et les Bérété font figure de géants au milieu du brouillard des autres chefferies.
On peut s'étonner que les uns comme les autres aient constaté, sans s'y opposer, le succès de leur ancien sofa. En fait, Samori ne chasse pas sur leurs terres. Lui, qui sait ménager les gens de peu de poids, est avec les puissants encore plus circonspect. Bien sûr, les Sissé ont dû apprendre que c'est en évoquant leur oppressions qu'il a rallié les premières tribus. Bien sûr, le rassemblement sous un seul maître de populations hostiles ne doit pas être pour leur plaire. Seulement, Séré-Brèma doit faire face à d'autres problèmes. Depuis des années il mène une guerre difficile contre le Sabadougou dans le nord. Tant que Samori évite toute imprudence, les Sissé le laissent exercer ses talents.
De leur côté, les Bérété ont autre chose à faire. Affaiblis par la défection de leurs alliés Konaté, ils poursuivent au Goundo une guerre incertaine.
La situation est donc, pendant deux ans, relativement facile. Mais Samori n'a pas besoin de conseils pour savoir qu'un jour viendra où Sissé et Bérété, ayant réglé leurs différends, s'inquiéteront du danger qu'il représente. Aussi prend-il les devants. Les Sissé lui paraissant plus redoutables, il se tourne vers eux et tente de se les concilier.
En fait, il n'a jamais rompu officiellement avec les ravisseurs de sa mère. Dès 1863 il s'emploie à renouveler les liens devenus plus que lâches. Avec ce génie de la volte-face qui est le sien, il s'improvise leur fidèle champion. Il s'indigne de ce qu'une tribu leur résiste et la châtie. Mais il se garde bien de conserver tout le butin : il en envoie la moitié, respectueux vassal, à Séré-Brèma qui, dit-on, accepta sans enthousiasme le présent. A partir de cette époque, Samori rend scrupuleusement hommage aux Sissé : aucune prise n'entre à Sanankoro sans que la moitié soit envoyée à Madina, leur capitale. Et une fois encore son habileté trouve sa récompense. Quand Séré-Brèma termine ses guerres dans le nord, il estime Samori suffisamment fidèle, il profite de son alliance pour abattre les Bérété.
Il est vrai que Samori l'a poussé dans cette voie. Il a attisé la méfiance envers Saranswaré-Mori. Plus d'une fois, il lui a fait comprendre que si ce dernier fortifiait sa capitale, ce ne pouvait être dans un désir de paix.
En 1864, les Sissé décident de passer à l'attaque. Comme ils veulent être sûrs d'emporter la victoire — les Bérété, bien qu'affaiblis, connaissent la stratégie des musulmans —, ils s'allient avec leur ancien adversaire du Sabadougou et, bien sûr, avec Samori.
Celui-ci, dans la coalition, occupe une place assez inconfortable. Non seulement il est numériquement le plus faible, mais il sait que Séré-Brèma n'est pas dupe de son inconstante amitié. Aussi se méfie-t-il davantage de son suzerain que de leurs ennemis. Le fait que les Sissé et leur armée se trouvent à quelque cinquante kilomètres de Sanankoro ajoute à ses réticences. Sous des prétextes divers, il demeure à l'écart. Lorsqu'il visite exceptionnellement Séré-Brèma, il prend ses précautions et s'entoure d'une escorte. Cette attitude n'échappe pas aux conseillers du maître des Sissé :
— Tu te fatigues à abattre un ennemi, lui disent-ils, et tu oublies qu'un autre grandit auprès de toi.
Séré-Brèma n'a pas besoin de cette mise en garde. Cependant, il explique:
— Si un homme attrape les pattes de deux taurillons à la fois, même s'il est très fort, ils s'échapperont.
Lorsqu'on lui rapporte ce dialogue, le second des « taurillons » rebelles ne fait qu'en rire. Il déclare à ses proches :
— Qu'il vienne donc m'attraper la patte jusque chez moi !
Mais il a bien senti ce que la comparaison contenait de menaces.
Aussi participe-t-il plus que mollement au siège de Sirambadougou, la capitale superbement fortifiée de Saranswaré-Mori. Ce siège durera plusieurs mois : la ville est imprenable autrement que par la famine. Il faut donc attendre la fin de l'hivernage pour que Saranswaré se rende. Vêtu avec des habits de femme, il se jette aux pieds de Séré-Brèma. Celui-ci, en tant que frère de même religion, lui fera grâce.
Les biens et les terres de Saranswaré-Mori furent partagés entre les Sissé et leurs alliés du Sabadougou. Samori, pour sa part, reçut ce qui peut paraître une aumône: sept chevaux que lui-même ou ses hommes avaient conquis.
Car maintenant, aussi bien lui que Séré-Brèma le savent : les Bérété hors de combat, leur affrontement est une question de jours.
Effectivement, les Sissé ne mettront pas longtemps à déclencher l'attaque. Dès la fin de 1865, leurs troupes traversent le Dyon. Et là, elles commettent une erreur au lieu de rechercher le cúur du bas Konyan, elles se tournent contre les alliés de Samori. Que celui-ci ait de nombreux parents, dont sa femme et son fils, dans Lenko que Séré-Brèma assiège est insuffisant pour expliquer l'erreur.
Tout d'abord la tactique semble pourtant réussir. Non seulement Séré-Brèma prend Lenko — dont Samori est parvenu à faire échapper les siens — mais encore ses armées sèment la terreur dans tout le bas Konyan. Ceux qui ont de trop près approché Samori fuient les représailles du terrible faama. Les autres, moins nombreux, font immédiatement allégeance. Sans qu'il y ait eu de réels combats, Samori se trouve isolé. Isolé mais non entamé. Refusant tout affrontement, il fait dire à Séré-Brèma :
— Père, je te laisse ton champ et je vais acheter des colas.
Sans résistance, il abandonne Sanankoro et se réfugie avec ses troupes bien plus au sud, dans la forêt.
Cette fuite, pour peu glorieuse qu'elle paraisse, est en fait extrêmement sage. En effet, Samori le sait bien, ses forces sont trop faibles. Un vivant humilié vaut mieux qu'un héros mort.
Samori prend donc ses quartiers d'hiver chez ces « sauvages du sud » qu'il mépriserait s'ils n'étaient producteurs de cola. Le fugitif connaît bien la région dont il parle la langue : non seulement il l'a parcourue au temps du colportage, mais encore il s'y trouve une tribu, les Toma, qui lui sera fidèle jusqu'aux derniers jours de l'empire.
Néanmoins, l'hivernage est pénible : certaines populations le harcèlent, l'armée se démoralise. Il a fallu abandonner tous les chevaux. Oui, le vent est à la défaite.
Pendant ce temps. Séré-Brèma parcourt le bas Konyan presque entièrement désert. Il peut se réjouir : sans effusion de sang, rien que par le déploiement de sa force, il vient de vaincre le dernier de ses concurrents. Déduction un peu trop rapide : au lieu de se débarrasser de Samori, il laisse quelques garnisons pour surveiller le territoire et ramène le gros de ses troupes à Madina.
Et la saison sèche revient. Samori se morfond dans l'inaction et la moiteur des forêts qui l'étouffent. Oui, mais comment en échapper ? Revenir en vaincu à Sanankoro ? Pourquoi ne pas faire allégeance aux Sissé ! Non, il faut rétablir sa puissance et accomplir un coup d'éclat… Il faut que tout le bas Konyan oublie sa retraite et sa honte.
Il faudrait pour cela qu'il retrouve sa chance, ce qui d'abord n'est pas le cas ; ayant essuyé plusieurs revers en essayant de rassembler ceux qui ont fui, il campe encore en 1867 dans des cavernes, bien loin de Sanankoro. Où donc est le kélétigui , le victorieux, le maître de la plaine ? Ses troupes paraissent sans espoir ; les blessés nombreux achèvent de mourir… Le vieux Laafiya, qui suit partout son fils, ne sait plus quels dieux invoquer.
C'est ce qu'apprennent les troupes de Séré-Brèma laissées en sentinelle. Il semble à leur chef que l'occasion est bonne : ce que la grande armée sissé n'a pas osé tenter, lui va le réussir : capturer Samori, ou tout au moins décimer son armée. L'attaque est soigneusement conçue : le fugitif cerné de toutes parts va être, à l'aube, forcé dans sa tanière.
On raconte qu'une femme de Samori, allant chercher de l'eau, aperçut les assaillants. Saisissant un fusil, elle le porta à son mari. Celui-ci prenait une douche, s'empara de l'arme et, d'un seul coup de feu, atteignit deux sofas . Les autres, pris de terreur, se seraient retirés en désordre.
Même si la défense fut moins pittoresque, les Sissé, poursuivis par les samoriens, s'enfuirent jusqu'à Lenko et repassèrent le fleuve. Essoufflés, ayant perdu une partie de leur armement, ils annoncèrent à Madina que Samori était revenu.
Le kélétigui avait fait de nombreux prisonniers. Il avait également saisi des chevaux et des armes. Ayant organisé un embryon de cavalerie, il envoya des messages à Sanankoro où il fit proclamer son retour.
Nul ne s'y opposa et on l'accueillit comme un maître. Toute conciliation avec les Sissé étant devenue impossible, il eut la joie de n'avoir plus à feindre. Quittant le titre subalterne de kélétigui, il prit celui de faama, réservé aux chefs des grandes hégémonies guerrières.
Les trois années qui vont suivre seront relativement paisibles. Les Sissé engagés dans une guerre contre le Wasulu laissent à Samori le temps de rendre vie au bas Konyan — nous l'avons dit, plus qu'à moitié désert — et surtout de reconstituer son armée. Les rares expéditions illustrant cette période reflètent moins un désir de conquête que la nécessité d'assurer la sécurité de l'Etat. Ainsi la campagne au cours de laquelle il conquiert le Goundo, provient du désir d'éloigner un voisinage hostile. On peut estimer le territoire contrôlé à l'époque par le nouveau faama à une superficie de 60.000 kilomètres carrés et ses sujets à environ 30.000 personnes.
Mais l'organisation et le maintien d'une armée inactive demandent de gros efforts. Ces sacrifices, jugés inévitables en période de guerre, font murmurer en temps de paix. Pour Samori, comme pour la majorité des chefs, une armée doit rapporter plus qu'elle ne coûte. Encore faut-il qu'elle ne soit pas battue. Samori, conscient du danger, ne brusque pas les choses. C'est seulement en 1870 qu'il se risque. Malgré les difficultés que présente l'achat des fusils dans un lieu si éloigné des côtes, il en possède un nombre suffisant ; ses cavaliers, soigneusement entraînés, peuvent se mesurer aux musulmans du nord.
L'important est de déterminer où ces militaires vont pouvoir exercer leurs talents. Pas question de s'attaquer directement aux régions dépendant des Sissé. Bien que Séré-Brèma, vieilli et occupé ailleurs, ne fasse plus montre d'agressivité, sa neutralité demeure indispensable. Chez les Kamara, le vieux Manankolo étant mort, un nouveau chef s'est révélé, jeune fauve aux dents pointues. Samori ne souhaite pas tester son armée sur ce Saghadyigi dont l'ambition l'agace. N'est-il pas plus ou moins son parent ? En fin de compte, le nord paraît la seule région où il puisse maîtriser les tornades. De plus, le nord évoque chez ce descendant de Dioula la voie des grands commerces. C'est donc vers le nord que le faama de Sanankoro tourne son dangereux regard.
Son but est d'atteindre le Sabadougou contre lequel, on s'en souvient peut-être, les Sissé ont longtemps guerroyé. Une fois encore Samori joue de la séduction et de la force. Il n'attaque pas de front son ennemi. Ce n'est qu'en 1872 que le faama du Sabadougou décidera de réagir. Sa réplique sera foudroyante. Elle le peut : selon la tradition, il possédait 1000 cavaliers, soit dix fois plus que Samori. Il infligera donc à ce dernier une pénible défaite. Le faama se replie dans le désordre jusqu'à Sanankoro. De nombreux sofas sont morts, de plus nombreux encore sont demeurés captifs. Comment combler le vide qu'ils ont laissé ? Samori, sans aucune vergogne, s'adresse aux Kamara. Il joue l'humilité diplomatique :
— Je vous ai quittés en homme, dit-il, et je reviens comme une femme. Je ne suis qu'un pauvre Dioula, mais je demeure votre neveu. Ce n'est pas moi que la défaite frappe, mais vous, car le travail que j'ai fait était pour vous, l'injure vous est donc adressée. Aidez-moi, sinon c'est vous qui êtes perdus.
Ce discours, bien que maintes fois entendu, doit paraître convaincant. Quelques semaines plus tard, Samori, ayant reconstitué ses troupes, attaque. Il surprend son vainqueur un soir de grand tam-tam. Le faama du Sabadougou put s'enfuir mais seul et sans cheval, laissant aux mains de Samori la majorité de ses hommes et la plus aimée de ses femmes. Cette victoire, pour éclatante qu'elle soit, devait être consolidée. Dès la fin de la saison des pluies, les hommes du bas Konyan envahirent le Sabadougou.
Il faut noter ici un fait qui va avoir son importance. Au lieu de passer l'hivernage dans sa capitale, Sanankoro, Samori décida de demeurer en pays conquis, dans un petit village nommé Bissandougou. Cette localité sans prestige, située sur la piste de Kankan offrait un avantage : en y installant sa résidence, Samori se libérait de façon définitive de la tutelle de ses « oncles » Kamara. Alors que ses droits sur Sanankoro étaient sans arrêt remis en cause, Bissandougou lui appartenait par la loi du plus fort. Il allait y demeurer près de vingt ans.
L'annexion complète du Sabadougou va réclamer encore trois saisons sèches. Pour y parvenir, Samori se ménage une alliance que l'on peut juger étrange si l'on se réfère au passé, et dangereuse si l'on compare les forces en présence : Séré-Brèma, le vieux maître des Sissé, oublie leurs différends ; il renifle avec appétit l'odeur de la curée ; il veut sa part des dépouilles du faama du Sabadougou. Ce dernier sera pris et exécuté en 1874. Environ un an plus tard, toute résistance aura cessé : Samori se trouve alors maître d'un Etat de plus de 20.000 kilomètres carrés et gouverne un peuple de 75.000 personnes.
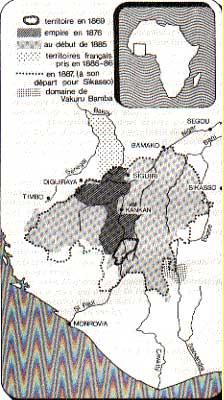
Cependant, si la puissance de Samori est dorénavant respectable, il n'est encore qu'un faama peut-être aussi puissant mais guère plus que ses voisins. Un appel providentiel lui donne, sans qu'il l'ait pour une fois cherché, l'occasion d'augmenter son pouvoir.
Depuis de nombreuses années, les Kaba régnaient sur Kankan, ville alors prestigieuse, à la fois haut lieu du commerce dioula et centre de culture islamique. Etant vouée au négoce, il était normal qu'elle se soit donné pour chef des marchands. Plusieurs Kaba avaient régné sur elle, se contentant de protéger la libre circulation sur les routes du commerce et vivant, somme toute, en assez bon voisinage avec les animistes de la région. Convertis au tidjanisme prêché par El Hadj Omar, leurs descendants devinrent plus agressifs.
En quelques années, un climat de guerre s'instaura entre païens et musulmans, rendant en 1875 la situation de l'Islam assez inconfortable. Tout ce que le pays comptait d'animistes s'étant coalisé contre eux, les maîtres de Kankan, au bord de la défaite, recherchaient une alliance. Ils se tournèrent vers Samori : non seulement la gloire acquise par celui-ci était encore fraîche, mais il se proclamait, malgré ses origines, un très officiel croyant. Le mansa de Kankan, Karamogho-Mori, lui fit porter une importante somme en poudre d'or.
Samori n'hésite pas. Il répond immédiatement à l'appel et se rend personnellement chez les Kaba. Karamogho-Mori et le faama se jurent fidélité mutuelle sur la tombe d'Alfa Kaabiné, le grand ancêtre. Les conditions de leur accord sont les suivantes ; après chaque victoire, le butin reviendra à Karamogho-Mori. Et les terres ? Elles seront la propriété exclusive de Samori. Perspective intéressante. Ces conditions, honnêtement respectées, permettent de fêter en commun la joie des premières victoires.
Cependant, une note un peu grinçante apparaît dans cette harmonie. On l'a déjà signalé : Samori traitait généralement les vaincus avec clémence. Attitude d'une excellente politique : sachant qu'ils auraient la vie sauve, que dans beaucoup de cas ils retrouveraient leur commandement, les chefs ennemis pactisaient volontiers. Or, aveuglés par le bonheur de la vengeance, les Kaba décident d'exécuter les prisonniers et le font, bien que Samori ait demandé leur grâce. Ce carnage fut une maladresse grossière. En effet, les gens de l'autre bord firent rapidement la différence entre la magnanimité de Samori, le « bon vainqueur », et la brutalité des hommes de Kankan. Ils se rendirent ou s'allièrent au premier, leur haine monta contre les autres.
Pourtant, cette divergence ne paraît qu'un nuage dans l'alliance des frères musulmans. Il faut exploiter le fruit de la victoire. La coalition animiste est ébranlée mais non vaincue. Usant toujours de sa tactique personnelle où la diplomatie précède la menace et succède aux fusils, Samori s'assure de positions de plus en plus vastes dans le Haut-Niger, au point d'inquiéter non seulement Karamogho-Mori mais également les fils et successeurs d'El Hadj Omar.
En effet, ses conquêtes l'ont mené aux frontières de l'empire toucouleur, ce que les descendants du prophète apprécient peu. Il y a même déploiement d'armes. Agibou, le fils d'El Hadj Omar, qui réside à Dinguiraye, ordonne à Samori de se retirer. Il ne s'agit que de paroles : bien qu'ayant réuni son armée, il hésite à commander l'attaque. Les maîtres de Kankan, soucieux de fraternité religieuse, offrent leurs bons offices. Des négociations ont lieu entre Karamogho-Mori et Agibou. Samori, qui campe non loin de là, en est exclu.
On raconte qu'au bout d'une semaine d'attente — les pourparlers avançant lentement —, le faama s'impatienta. Déguisé en marchand, il s'introduisit dans le camp toucouleur et surgit, interrompant la conférence, dans la case d'Agibou. Impressionné par cet acte téméraire, celui-ci fit retirer ses troupes et reconnut les conquêtes du faama.
C'est vers cette époque (1878), que l'on fait pour la première fois mention de Samori dans un document français. Un informateur écrit :
« Des bruits courent qu'El Hadj Omar aurait un imitateur, un marabout malinké nommé Sanodu, venu du Fouta-Djalon avec une armée assez forte. Il aurait conquis le pays des Malinké à trois jours de Dinguiraye, dans le Fouta-Djalon, où se trouve un des frères d'Amadou nommé Agibou. Ce dernier est, paraît-il, fort inquiet de ce marabout qui a une réputation de courage porté à l'excès. »
Cependant Samori poursuit son avance avec ou malgré ses alliés. En proportion inverse de l'ampleur de ses conquêtes, l'amitié qui l'unit aux Kaba s'amenuise. Quand, au retour d'une de ses campagnes, il propose d'attaquer en commun les Sissé, Karamogho-Mori se dérobe. Samori n'a pas quitté la ville, qu'il s'emploie à la fortifier. La grande alliance musulmane paraît dès ce jour moribonde.
En fait, si Samori envisage de combattre les Sissé, c'est bien à son corps défendant. Il continuerait volontiers à mener ses conquêtes hors de leur zone d'influence si la situation n'avait pas évolué dangereusement à Madina. En effet, comme nous l'avons dit, Séré-Brèma est vieux. Il a fait preuve ces dernières années d'une prudence que certains qualifient de sénile. Tel est tout au moins l'avis de ses neveux et surtout de Morlay, le plus fougueux et le plus brave.
Celui-ci accepte mal que son oncle reçoive avec bonheur les miettes abandonnées par Samori, qu'il permette à un ancien sofa de fonder un royaume qui devient redoutable. Il intrigue. Il fait pression sur l'entourage du vieillard et, aidé de ses frères, finit par obtenir vers 1878 que Séré-Brèma lui cède le commandement des armées. Immédiatement, il se met en campagne sans attaquer directement Bissandougou. S'il traverse le territoire du faama, il se garde bien de marquer son passage par des exactions trop violentes. Par contre, il combat de façon efficace le Sankaran, qui a juré obéissance à Samori.
Pendant un premier temps, ce dernier contemple sans réagir l'avance de Morlay. Il l'observe. Il le laisse s'engager, loin de Madina, vers la mer et la Sierra Leone. Soudain vient la réplique.
Elle est d'abord diplomatique. Samori, tâtant le terrain, « s'étonne ». Il élève auprès de Séré-Brèma une protestation mesurée. Le messager qu'il envoie à Madina offre même au vieux faama un très bel étalon. Il dit, répétant les paroles de son maître :
— J'ai travaillé pour toi en te donnant des terres et voilà que tes fils m'ont attaqué et qu'ils ont chassé mes sofas . Si tu as de la considération pour moi, il faut les rappeler, sinon c'est toi qui auras provoqué la guerre.
Hélas, Séré-Brèma croit au génie de son neveu. Il rétorque :
— Tu es trop malin. Tu m'as trompé en me donnant un pays pauvre et ravagé alors que tu prenais les pays riches.
Après cette fin de non-recevoir, il suffira de quelques semaines à Samori pour venir à bout de Morlay. Le jeune fauve est trop fou pour le grand adulte. Attaquant les troupes les plus vulnérables, suscitant la révolte chez les peuples occupés, Samori capture Morlay, son armée, ainsi que tous ses frères au début de l'année 1880.
Voilà donc une grande partie de la force sissé aux mains de Samori. En effet, les ralliements ne se limitent pas à l'armée qu'il a vaincue. Beaucoup parmi les vassaux de Séré-Brèma sont las de sa politique vieillissante. Las de vivre dans le souvenir d'un passé qui n'est plus. Le nouveau chef musulman rassemble leurs espoirs. Nombreux sont ceux qui demandent à partager la gloire du faama de Bissandougou.
Cependant, la chute de Madina peut attendre. Pour Samori, la tâche la plus urgente est d'achever son ancien allié. Il peut, vis-à-vis de l'opinion, faire preuve de bonne conscience : le mansa de Kankan n'a-t-il pas lui-même rompu le pacte d'amitié ? N'a-t-il pas refusé son aide à Samori ? Contre qui les Kaba fortifient-ils leur ville ? Ils ont construit de solides remparts ? Et bien, qu'ils les utilisent ! En juillet 1880, les troupes samoriennes mettent le siège devant Kankan. Karamogho-Mori résiste jusqu'à la fin de l'hivernage 1881 mais il est forcé de se rendre. Samori ne fera aucun mal à la capitale dioula de l'islam : il se contente d'y entrer en vainqueur et d'y lever un impôt convenable en poudre d'or.
Maintenant qu'il n'a plus d'ennemi pour le prendre à revers, il va pouvoir régler son compte à Madina. Séré-Brèma semble curieusement avoir oublié sa vieillesse. Est-ce le courage du désespoir ! Il a rassemblé tous ceux qui, dans son empire démantelé, peuvent encore porter le fusil ou le sabre. On trouve, dans ce ramassis, sa garde personnelle, des hommes sans aveu qu'il paye cher, des guerriers trop jeunes ou déjà déclinants.
Une première expédition lui donne une victoire facile dont il abuse : le gros des troupes de Samori est retenu au loin. On dit que dans la cité de Worokoro qu'il avait prise, il égorgea tous les sofas . Le faama de Bissandougou, prévenu, avait surgi brusquement au milieu des festivités sanglantes d'une victoire sans lendemain. Surpris, Séré-Brèma s'enferme derrière les remparts. Les assiégés, conscients de la faute qu'ils ont commise, pensent qu'ils n'échapperont pas. Samori les encercle sans même donner l'assaut. Une fois encore, il s'efforce d'épargner le sang. Il renvoie les sofas qu'il fait prisonniers sains et saufs. Il leur ordonne de dire aux autres : « Si vous vous rendez, ne craignez rien de Samori. »
Et, une fois encore, cette propagande pacifique porte ses fruits. Beaucoup franchissent secrètement les lignes et se rendent. Les autres tentent une sortie désespérée. Ils s'efforcent au petit jour de forcer le blocus. A ceux-là, Samori ne fait aucun quartier. Séré-Brèma n'est pas au milieu d'eux.
Le vieillard a vu fuir, poussés par le désir de vivre, ses serviteurs et ses alliés. Lui est demeuré dans la ville. On raconte ceci ; Samori se présenta lui-même devant le vieux faama. Le vieil homme, égrenant son chapelet, l'attendait sans défense. Samori s'agenouilla devant lui. Considérant avec amertume le petit colporteur devenu ce qu'il n'était plus, Séré-Brèma lui dit :
« Les sofas en m'abandonnant m'ont coupé le bras jusqu'au poignet. Si tu n'y prends garde, quand ton tour viendra, ils te le couperont jusqu'à l'épaule… »
Paroles prophétiques ? Quoi qu'il en soit, Samori ne fit pas exécuter son ancien maître. Il l'installa dans le village de Karaso et lui offrit des conditions de vie très convenables. Le vieillard devait survivre plus de dix ans ; s'il connut une mort tragique, la faute n'en revient pas à Samori. En effet, celui-ci crut que le faama déchu avait trahi. Furieux, il fit porter à Séré-Brèma un appel aux Français qu'il pensait écrit par lui, en disant :
— Qu'il le lise et qu'il dise lui-même ce que mérite un musulman qui fait appel aux Infidèles.
Séré-Brèma lut la lettre mais ne protesta pas. Il sortit du village après avoir fait ses prières et s'assit sur une peau de boeuf. On l'abattit à coups de fusil. Après cette exécution, on apprit que le traître était un neveu du vieillard et que Séré-Brèma, qui connaissait son nom, était mort à sa place. Les hommes de son village d'exil lui firent des funérailles rituelles et l'honorèrent ainsi qu'un bon croyant.
Une fois vaincu Séré-Brèma, Samori ne molesta pas les vassaux des Sissé. Pourtant, il s'employa à faire oublier jusqu'au nom de cette famille dont il devenait par la puissance le successeur. Madina fut rasée ; les captifs qui alentour cultivaient les terres se virent donner des champs près de Bissandougou.
Des grandes puissances que le faama avait rencontrées jusqu'alors, il ne restait que la plus faible : Saghadyigi, le jeune chef animiste qui tentait de reconstituer autour de sa personne l'unité Kamara. Samori ne daigna pas l'affronter. Il lui envoya des présents : un savon qui enlève l'odeur de la poudre, afin de lui signifier que la guerre devait être abandonnée par lui, une daba pour qu'il se consacre à la culture, enfin un grand boubou pour lui enjoindre de se convertir. Saghadyigi ne voulut pas comprendre. Mais il était trop faible pour que Samori s'en inquiète.
Maintenant, le maître de Bissandougou possédait — nous sommes en 1882 — un territoire de 80.000 kilomètres carrés comprenant 300 000 habitants. Mais il regardait toujours vers le nord et le Niger où l'arrêtaient les fils d'El Hadj Omar.
A la même époque se levait une menace nouvelle, encore diffuse et paraissant lointaine : celle de l'envahisseur blanc.
Jusque-là Samori a eu peu de contacts avec les « oreilles rouges ». Les Blancs lui sont nécessaires puisque eux seuls peuvent lui vendre des fusils. Il juge ces étrangers des commerçants indispensables plus ou moins honnêtes. D'ailleurs, Français et Anglais ne s'éloignent guère des côtes où ils ont installé leurs comptoirs. Ce n'est pourtant pas l'envie qui leur manque. Chez les Français, Faidherbe avait conçu, dès 1864, le grand projet de joindre le Niger. Il n'avait pas été suivi. Pendant de nombreuses années, les prémices de la lourde opération coloniale se placent sous le signe de la contradiction : contradiction entre Paris, empêtré de problèmes internes, et les militaires qui au Sénégal échafaudent des projets d'épopée. Contradictions entre ces belliqueux de profession et les bourgeois de Saint-Louis-du-Sénégal, marchands blancs ou métis, uniquement désireux de s'ouvrir les nouveaux marchés de l'intérieur.
Une raison apparemment pacifique déclenche l'offensive. Il s'agit de désenclaver les grosses bourgades du Soudan toujours, c'est évident, pour les ouvrir aux bienfaits du négoce et, pour cela, de construire un chemin de fer qui irait jusqu'à Bamako. On rêve aussi d'une voie ferrée qui relierait à travers le Sahara ces centres commerciaux que l'on sait prospères avec l'Algérie.
Oui, mais comment mener le premier de ces projets à travers des terres qui, somme toute, appartiennent aux Africains ? Il y a risque de conflit. Il y a même certitude quand le maître des savanes est Amadou, fils et successeur du grand El Hadj Omar.
Imitant la politique que Samori utilise plus au sud, les Français vont user de duplicité, des dissensions de l'ennemi et de la force. Essayant de jouer contre Amadou les populations mandingues qu'il a conquises ; promettant au chef toucouleur des fusils et même des canons lorsque celui-ci se montre irréductible, conquérant de façon foudroyante, grâce à un armement moderne, des bourgades jugées inexpugnables, les militaires français avancent inexorablement. En 1880, ils occupent Kita et ne parlent plus qu'accessoirement du but premier de leur voyage : la construction du chemin de fer doit pouvoir attendre quelque temps. L'esprit d'aventure et de domination les a saisis. Ils n'ont plus besoin d'excuse commerciale : ils marchent pour la gloire de la France. Ils asservissent avec bonne conscience : ceux qui refusent de se soumettre deviennent des traîtres dans leur esprit.
Mais, comme nous l'avons dit, le principal obstacle à l'avance française demeure le bloc toucouleur. Si les Blancs s'intéressent aux activités de Samori, qui alors assiège Kankan, c'est de façon épisodique : le faama de Bissandougou n'est pas un obstacle à leur marche sur Bamako, la gare terminale du chemin de fer hypothétique. Qu'il fasse donc ce qu'il désire avec les autres « Nègres » ! Non, en vérité, en ce début des années 1880, personne dans aucun des deux camps n'envisage la lutte impitoyable qui va suivre.
Le premier affrontement provient beaucoup plus du hasard que d'un plan délibéré. L'armée française, qui progresse par saccades, se voit opposer un frein qu'elle admet mal par son propre commandement. En effet, la fièvre jaune décime le Sénégal. Ordre est donné depuis Paris de maintenir si on le peut les positions de l'intérieur. Cela et rien de plus : lorsque l'épidémie sera enrayée, lorsqu'on aura pu, sans danger, envoyer de nouveaux cadres et former de nouveaux tirailleurs, il sera temps de penser au Niger.
Cette décision, qui paraît sage — les pertes sont lourdes à Saint-Louis et dans les camps —, désole le commandant en chef Borgnis-Desbordes. Cet officier ne peut admettre qu'on l'emploie comme gestionnaire des terres soumises. Aussi, étant allé ravitailler Kita, va-t-il saisir le premier prétexte lui permettant de poursuivre la conquête sans désobéir trop ouvertement.
Or, le chef de Kényéran, ayant hébergé les Kaba lors de leur fuite, s'inquiète de l'avance de Samori. Il demande aux Français de l'aider. Immédiatement, Borgnis-Desbordes s'institue le champion d'un peuple dont il ne connaît rien : l'Est lui étant formellement interdit, il va s'imposer vers le sud. Planter le drapeau français chez des sauvages dont Paris ignore le nom !
Cependant, afin de prouver sa bonne foi, il envoie une ambassade à Samori. Il lui enjoint de ne pas attaquer Kényéran, la cité amie de la France.
Il est probable que le faama fut étonné du ton de remontrance que se permettaient ces Blancs. Il montra son mécontentement mais renvoya le messager, un lieutenant sénégalais, sans lui faire aucun mal. Le rapport de Borgnis-Desbordes sur cette ambassade est assez tendancieux et prête à Samori des réactions peu africaines, Il prétend ainsi que son envoyé, condamné à dix ans de prison ( ?), se serait échappé par miracle ; qu'en conséquence la France avait été bafouée par ce barbare « qui remplit de ses cruautés la rive droite du Niger » (sic) et conclut qu'en Afrique « une offense ne doit jamais être impunie, le pardon et l'oubli y étant considérés comme faiblesse ».
En foi de quoi il organise une expédition à la fois défensive — les droits du chef de Kényéran — et punitive — contre le faama.. Expédition assez modeste puisqu'elle comprend 221 combattants.
Ceux-ci, après un certain nombre de tribulations, arriveront trop tard. La seule réaction de Samori devant l'intervention de Borgnis-Desbordes a été de précipiter son action. Il a encerclé Kényéran bien plus tôt que prévu. Au lieu de mener patiemment le siège, d'attendre que la ville se rende avec le minimum d'effusion de sang, il a donné l'assaut. Quand les troupes françaises surgissent, l'opération est terminée : Samori a conquis la ville. Le 26 février 1882 au matin, le nouveau maître de la place apprend que cet ennemi dont il ne connaît qu'un ambassadeur noir a franchi le gué le plus proche. Comme le détachement paraît faible, il lance sa cavalerie… C'est compter sans l'artillerie française. L'accrochage se révèle meurtrier pour les sofas . Sans hésiter le réalisme faisant partie de son génie, Samori se rend à l'évidence : les Français possèdent une façon de combattre qu'il ignore. Plutôt que de se mesurer avec eux aveuglément, il doit comprendre d'où leur vient cette supériorité qui ne doit rien au nombre.
Le faama estime sage de se donner un temps d'observation, Il évacue Kényéran sans résistance — ce dont se glorifie Borgnis-Desbordes. Cependant, malgré son succès, ce dernier admet son imprudence. Renonçant à exploiter sa victoire, il se replie vers Kita à étapes forcées. Tous ses hommes n'y parviendront pas. En effet, Samori, tâtant toujours son adversaire, le talonne, lui tend des embuscades et exerce contre lui des attaques ponctuelles.
Quand Borgnis-Desbordes parvient au camp avec ceux qui survivent, il peut se vanter d'une campagne brillante… inutile pour les Français, mais riche en expériences, pour Samori.
En effet, le faama vient, à peu de frais, d'éprouver la technique européenne, si différente de celle des musulmans. D'autre part, il sait qu'il va falloir compter avec ces hommes à la peau blanche.
Mais comment les tenir à l'écart ? Il tente de précéder l'ennemi, d'agrandir et d'affermir des conquêtes que nul ne doit mettre en question. Alors qu'auparavant il faisait précéder chaque action militaire de négociations et d'intrigues, en ces années 1882-1883, il met les bouchées doubles. Par l'entremise de son frère Kémé-Brèma, il conquiert successivement le Manding et le Wasulu.
Si l'on regarde une carte, on s'aperçoit que son but est de s'assurer la maîtrise des grandes voies commerciales nord-sud. Or celles-ci, qui s'épanouissent à partir du Niger en mille routes, irriguent les villages de part et d'autre du fleuve, se rassemblent de Bamako à Koulikoro autour des gués. S'assurer de ces passages revient à contrôler le commerce de la région. Tel est l'objectif que semble poursuivre Samori. Or il est bien prêt de l'atteindre.
En effet, après leur expédition hasardeuse de Kényéran, les Français se sont repliés sur Kita qu'ils fortifient. Bien plus grave paraît la menace toucouleur. Amadou et ses hommes forment avec leurs terres une sorte de verrou. Bloquant les routes du nord, ils sont mal vus des commerçants de Bamako. Après avoir envisagé l'alliance française, ceux-ci ont décidé de s'appuyer sur Samori, ce coreligionnaire, ce confrère en négoce, ce maître des grands marchés du sud-ouest et surtout de Kankan. Malgré quelques dissensions internes, le ralliement de Bamako parait acquis.
Aussi Kémé-Brèma, commandant en chef de Samori, son frère, ne se presse-t-il pas. Il avance lentement, fignolant au mieux les traités qui l'unissent aux chefs rencontrés sur sa route. Il réduit ou séduit en chemin la plupart des derniers opposants malinké. Soudain, alors qu'il effectue au loin une tournée de recrutement, éclate un coup de tonnerre : le 1er février 1883, les Français sont entrés à Bamako.
Que s'est-il passé? Nous savons que Borgnis-Desbordes a décidé depuis longtemps de joindre le Niger et de conquérir le Soudan. Le gouverneur du Sénégal y étant hostile, il décide de passer outre et de plaider lui-même sa cause : déléguant ses pouvoirs, il s'embarque pour la France. Le 30 août 1882, assistant à une réunion présidée par le ministre de la Guerre, il arrache à Paris la décision de créer un fort à Bamako « sous réserve du vote des crédits pour la campagne ». C'est donc triomphant que Borgnis-Desbordes rejoint le Sénégal.
Le gouverneur, sentant qu'il a été joué, lui écrit :
« Vous avez reçu des instructions du ministre. Je n'ai pas été consulté dans leur préparation et je n'ai rien à y changer… »
Le 22 novembre, une colonne de près de 1 300 hommes se met en route vers l'intérieur ; elle arrive à Kita le 16 décembre, vainc rapidement les dernières résistances qui pourraient la prendre à revers — dont la forteresse toucouleur de Murgula — et aux termes d'une campagne exceptionnellement facile, parvient sans aucun mal à Bamako. Borgnis-Desbordes s'emploie immédiatement à fortifier la ville.
Il lui faut faire vite. En effet, l'ennemi est double. D'une part les Toucouleur, mécontents de la prise de Murgula — mais ceux-ci ont fort à faire avec des révoltes bambara que soutient Samori —, d'autre part, Samori lui-même.
Depuis l'expédition irréfléchie de Kényéran, Borgnis-Desbordes a compris qu'Amadou n'est pas son unique opposant. Alors que l'empire toucouleur, miné par la révolte, en est déjà à son déclin, celui de Samori s'épanouit comme un adolescent atteignant l'âge d'homme. De plus, le commandant français apprend qu'il n'a dû qu'à des circonstances fortuites d'atteindre le premier Bamako. Deux lions se disputent la même gazelle.
Tout cela donne à réfléchir. Aussi Borgnis- Desbordes va-t-il tenter de se ménager des alliances dans les terres contrôlées par Samori. Il suscite quelques soulèvements, vite matés, abandonnant sans vergogne ceux qui l'ont naïvement servi.
Sachant que la nouvelle de la prise de Bamako rendra furieux son frère, Kémé-Brèma essaie de racheter son erreur. Bien qu'il paraisse difficile d'assiéger ces Blancs à la force déroutante, le kélétigui espère encore y parvenir. D'une part, la garnison est peu nombreuse, d'autre part, le ravitaillement incertain, les conditions sanitaires désastreuses la déciment — en mars, il ne reste plus que 350 hommes en état de combattre —; enfin, Kémé-Brèma s'est ménagé de nombreuses alliances à l'intérieur et autour de Bamako.
Les premières expéditions dans la campagne proche se révèlent un succès : apprenant cette avance, les bourgeois de la ville reprennent espoir. Cependant, les troupes de Borgnis-Desbordes se répandent elles aussi dans les villages et, cherchant du ravitaillement, en détruisent plusieurs. Malgré cette présence, Kémé-Brèma parvient le 1er avril en vue de Bamako.
La garnison française est épuisée, affamée, incapable de soutenir un siège. Aussi Borgnis-Desbordes va-t-il tenter, le 2 avril, un coup d'audace. Avec les 242 combattants qui lui restent, il attaque l'ennemi au marigot Weyanko. Mais il a présumé de ses forces : débordé par Kémé-Brèma, les tirailleurs reculent en désordre, « si épuisés que les hommes n'avaient plus le courage de tirer un coup de fusil ». Après cet échec dont il comprend la leçon, le colonel s'octroie dix jours de trêve. Le 12 avril, il renouvelle sa tentative. Mais il a reçu des renforts. Surpris, attaqué à revers, c'est au tour de Kémé-Brèma de fuir. Le kélétigui erra deux jours dans les montagnes avant de pouvoir retrouver les siens.
Cette victoire française devait avoir une grande conséquence : en effet, les samoriens ayant abandonné leurs réserves, la disette cessa à Bamako. A la fin de cette année-là, la présence française ne pouvait plus être contestée sur le Niger.
Cependant, Borgnis- Desbordes, confronté avec les difficultés de la conquête, semble renoncer à pousser plus avant. Malgré son désir de démanteler l'empire toucouleur, il ne fait aucune tentative pour investir sa capitale, alors installée à Ségou. Ayant gagné un pari paraissant au départ impossible, il s'emploie à consolider ses arrières et se rend une nouvelle fois en France à la recherche de crédits. Ce second voyage ne rappellera en rien l'éclatant succès du premier.
Pour le nouveau ministre, préoccupé par l'expédition difficile qu'il a ordonnée au Tonkin, les affaires africaines paraissent nébuleuses. Paris hésite. Il diffère l'envoi de crédits. Les bourgeois sénégalais, toujours hostiles aux opérations militaires, font valoir leur modération et leur désir de paix.
Ce chaos et cette inertie marquent un arrêt dans la conquête. Samori, sans chercher à en démêler les causes, saura l'exploiter admirablement.
On peut s'étonner que le faama ait confié à son frère le soin d'investir Bamako. C'est qu'en ces années 1882-1883, d'autres problèmes le préoccupent. Nous avons dit qu'après avoir vaincu les Bérété, les Kaba et les Sissé, Samori avait neutralisé toutes les grandes puissances de son entourage immédiat. Une seule avait survécu : l'union suscitée par le jeune Saghadyigi chez les animistes Kamara. Nous avons relaté comment, après la chute des Sissé, ce mansa avait formellement refusé de se soumettre ou de se convertir.
Pendant plusieurs années, Samori, occupé plus au nord, avait paru admettre les manoeuvres et la puissance grandissante de son jeune concurrent.
Celui-ci en effet avait joué de la ferveur de ses coreligionnaires. Alors que Samori penchait de façon de plus en plus visible vers l'Islam, Saghadyigi affichait au contraire un traditionalisme vigilant. Il s'était promu champion des croyances, des rites et des cérémonies. Cette démarche n'avait pas manqué de séduire tout ce que le Konyan comptait de chefs plus ou moins hostiles aux musulmans. De plus, Saghadyigi bénéficiait de deux atouts : d'une part, il appartenait à une antique famille et il pouvait se moquer des prétentions d'un « colporteur »,
d'autre part, il possédait à Gbankundo, dans les montagnes, un refuge quasi inaccessible qu'il avait les moyens de défendre et avait fortifié avec soin.
Ainsi, tandis que Samori étendait sa puissance vers le Niger, Saghadyigi réussissait, sans trop de mal, à conquérir les terres s'étendant jusqu'à la forêt. S'il avait possédé le quart du génie politique de son rival, peut-être serait-il devenu invincible. Mais le chef animiste paraît gâté par un pouvoir exercé bien trop tôt. Il ignore la façon dont on organise les terres qu'on a conquises. Il commet des exactions. Il pille. Il fait exécuter les vaincus par vengeance et sans réflexion. En un mot, le prestige dont l'auréolent sa religion et sa famille est vite contrebalancé par son intolérance et son incapacité administrative.
Aussi la propagande insidieuse que Samori fait exercer, chez Saghadyigi comme ailleurs, trouve-t-elle des échos favorables ; les vaincus, les spoliés lui accordent une alliance indispensable. Au Konyan, plus que nulle part ailleurs, le faama en a besoin. En effet, la guerre qu'il projette est décisive. Jusqu'à présent, une partie de ses forces, les bases sur lesquelles il peut se replier, appartiennent à ses « oncles » Kamara. Or, c'est contre d'autres Kamara qu'il faut amener ses alliés à combattre. Il doit, lui le néo-musulman, le colporteur, parvenir à dresser des animistes contre des animistes, des « cousins » nobles contre d'autres « cousins ». On comprend qu'il ait dû abandonner à Kémé-Brèma le soin de vaincre sur le Niger.
Cependant, ses chances paraissent excellentes autrement il eût attendu. Il bat assez rapidement Saghadyigi dans la plaine grâce à ses cavaliers. Hélas ! le mansa, obligé d'abandonner une partie de sa poudre, se réfugie à Gbankundo, dans les montagnes, où la cavalerie devient inopérante. N'ayant pu empêcher sa retraite, le faama rassemble des forces considérables. Il construit des sanyés sur la seule grande route permettant d'investir le haut Konyan.
Et après ? La situation parait inextricable. Impossible d'envahir l'ennemi, qui connaît mieux que personne chaque passage. Impossible d'espérer l'attirer dans la plaine. Saghadyigi possède des réserves considérables. Seule lui manque la poudre, qu'il ménage. Le temps devrait causer sa perte car il est isolé. Samori pourrait, comme il le fit au siège de Kankan, obtenir sa reddition en attendant un ou deux hivernages. Mais le faama semble oublier sa patience. Il donne plusieurs assauts inutiles sur un front trop étroit où ils sont repoussés. C'est que les nouvelles venant du nord sont mauvaises , Samori souhaiterait remonter jusqu'au Niger et soutenir Kémé-Brèma.
Ces demi-échecs, mal admis par les sofas les moins fidèles, lui font comprendre que la ruse sera plus efficace. Il attend et provoque des trahisons dans le camp ennemi. Celles-ci ne tardent pas : un de ces oncles par alliance se trouve parmi les assiégés. Bien qu'animiste convaincu, il ne doute pas de l'issue de la lutte. Parvenant à communiquer avec Samori, il lui indique un passage permettant de prendre à revers Saghadyigi. La manoeuvre est bonne. Un matin, avant l'aube, une partie des troupes samoriennes avance dans un défilé si escarpé que le mansa ne l'a pas défendu. Alors que le reste de l'armée fait une diversion vers la plaine, les assiégés sont brusquement surpris. Certains se défendront avec un grand courage. D'autres encore — dont plusieurs femmes — se donneront la mort en sautant d'une falaise.
Saghadyigi parvient à fuir. Craignant l'influence qu'il exerce encore, Samori le fait poursuivre. Atteint au bord d'un gué qui porte encore son nom, « Saghadyigi-mina-Fwa » (« Place de la capture de Saghadyigi »), le mansa est ramené avec ceux qui l'accompagnent, dont son propre fils, dans Gbankundo où l'on célèbre la victoire. Les prisonniers refusent de s'humilier. Les mains liées, le fils de Saghadyigi déclare :
« Nous sommes les maîtres du pays et nous ne voulons pas que des colporteurs se placent au-dessus de nous ! »
Samori, sans broncher, écoute ces insultes. Puis il se retire, disant à ses sofas : « Réglez l'affaire. » Alors, selon les ordres, le bourreau se précipite. Il décapite les vaincus.
La mort de Saghadyigi ne devait pas être oubliée des animistes. Des légendes naquirent. On raconta que Samori lui ayant refusé la sépulture, une termitière s'éleva sur le cadavre et qu'ensuite se forma au même endroit un étang célèbre pour le nombre et la qualité des poissons.
Mais qu'importe à Samori la fantaisie de ces légendes ! Le dernier des ennemis de sa jeunesse a disparu. Comme d'habitude, il se montra tolérant envers le peuple et organisa le pays jusqu'à sa frontière naturelle, là où s'élève la grande forêt.
Le Konyan pacifié, Samori va-t-il reprendre son vieux rêve de liaison avec le nord ? La raison le lui interdit. Il ne s'agit plus de vaincre des empires déclinants mais un adversaire à la stratégie inquiétante. Aussi, avec son réalisme ordinaire, le faama va-t-il porter ses efforts à la fois vers l'ouest et vers l'est : la forêt, ses miasmes et ses pièges attirant peu le conquérant.
La campagne vers la mer s'impose. Pour maintenir sa puissance ñ ne disons pas pour l'étendre —, Samori a besoin d'armes. Ses relations avec la France étant inamicales, il ne reste pour s'approvisionner que les Anglais, en particulier les commerçants installés à Freetown. Ces derniers, voyant fondre la concurrence, se montreraient fournisseurs empressés si les liaisons n'étaient si difficiles. En effet, pour aller de la côte à Bissandougou, il faut franchir un certain nombre de chefferies qui refusent ou accordent de façon capricieuse le passage, attaquant parfois les caravanes et confisquant les précieux fusils.
En dehors même du commerce des armes, les pistes ne sont pas sûres pour les dioulas. C'est donc une fois encore dans le but tout à fait avouable et réel de protéger les routes du commerce menant à la Sierra Leone que Samori se met en campagne. Disons plus exactement qu'il ordonne une campagne confiée à Langaman-Fali, un homme de caste devenu un de ses plus fidèles lieutenants. Celui-ci mettra deux ans. En 1885, la pacification paraît acquise. A l'exception de quelques révoltes vite matées, les dioula pourront, après cette date, traverser sans inquiétude le pays.
Toute cette conquête a été menée en parfaite intelligence avec les forces anglaises. Celles-ci ont, en effet, le même intérêt que Samori à la pacification des voies de l'intérieur. Une entente a donc lieu : Samori s'engage à ne pas investir les zones sous influence britannique ; en revanche, les Anglais promettent de protéger sur leur territoire les commerçants dioula à condition qu'ils ne s'écartent pas des grandes routes. Cet accord étant scrupuleusement respecté, la « campagne vers la mer » constituera un succès complet pour le prestige de Samori.
Celui-ci, nous l'avons dit, a compris que sa place n'est plus seulement à la tête de ses troupes. Conscient des charges qu'impose un grand empire, il demeure dans sa capitale ou à Sanankoro. De là, il conçoit des plans et non plus des batailles. Il conseille ou morigène ses généraux. Dès la disparition de Saghadyigi, il a troqué son titre de faama contre celui plus religieux d'almami. La nécessité de ménager les animistes n'existant plus, il se pose en champion de l'Islam, justifiant a posteriori l'apparence de guerre sainte de sa campagne contre le haut Konyan.
Donc, l'almami, agissant non plus en tant que chef militaire mais en tant que maître spirituel de tous les chefs, a raison d'être satisfait des résultats obtenus vers la mer. En est-il de même pour la campagne ordonnée vers les savanes de l'intérieur ?
Si l'extension vers l'ouest paraît une évidence, on peut se demander pourquoi Samori jugea bon d'envoyer ses troupes à l'opposé — une explication donnée a posteriori et affirmant qu'il cherchait à se rapprocher de La Mecque, paraît plus que douteuse.
En fait, il est possible de donner deux raisons justifiant l'almami. Tout d'abord, le besoin de trouver une remonte en chevaux. Ceux-ci provenant jusqu'à présent du nord aujourd'hui bloqué par les Blancs, Samori pouvait juger indispensable de s'ouvrir un chemin jusqu'aux riches pâturages de la boucle du Niger. Autre raison de se lancer vers l'est : à la frontière de l'empire samorien s'agitaient une poussière de chefferies en majorité bambara. Inorganisées, sans moyens, se battant fréquemment les unes contre les autres, elles constituaient une proie facile pour le premier des attaquants. Samori pouvait estimer plus sage d'occuper ce pays anarchique avant que les Toucouleur ou les Français l'assaillent.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une colonne mais trois qu'il envoie à la conquête de ces Bambara dispersés. L'une d'elles sera confiée à Kémé-Brèma qui, ayant ordre de ne pas attaquer les Français, vient après quelques accrochages de fixer les frontières au bord du fleuve avec les Toucouleur.
La campagne se déroule tout d'abord de façon favorable : quelle puissance locale pourrait valablement s'opposer aux samoriens ? Une seule. Et voici l'affrontement tout proche.
En effet, de l'autre côté de la rivière Bagoé, s'étend un royaume bien structuré d'origine sénoufo. Quoique en majorité animiste, cet Etat est dirigé par un faama allié aux fils d'El Hadj Omar. Ce prince, nommé Tiéba, soucieux d'indépendance, se voit sans aucun plaisir imposer un nouveau voisin. La présence de Samori prenant la place de l'agitation inefficace des chefs bambara l'inquiète. Il interdit à ses dioula de vendre des chevaux aux gens de l'almami à qui aucune mesure ne pouvait être aussi désagréable.
Cependant, Tiéba a trop conscience de la force ennemie pour l'attaquer de front. Ses décisions hostiles se résument à ce que l'on appellerait aujourd'hui des mesures de dissuasion. La maladresse des lieutenants de Samori va provoquer son offensive.
Nous avons vu que jusqu'à cette époque le conquérant traitait avec beaucoup d'adresse et de mesure les populations vaincues, et se montrait particulièrement tolérant en matière de religion. Ce qui était possible pour le faama devient plus difficile pour l'almami. Protecteur de la foi, il ne peut officiellement admettre que les peuples conquis se perdent dans l'erreur. Aussi donne-t-il à ses kélétigui des instructions très strictes : qu'ils provoquent les conversions, qu'ils les forcent au besoin !
Comme tous les ordres, ceux-ci doivent être interprétés. A l'ouest, Langaman-Fali fait preuve d'une grande souplesse : il sait détourner les yeux quand il le faut ; les animistes ont rarement à se plaindre de son zèle. Telle n'est pas l'attitude à l'est, du principal chef militaire, Tari-Mori. Pour celui-ci, la consigne est sacrée : ancien porte-chaise de Kémé-Brèma, promu trop vite, il refuse de discuter les ordres. Aussi persécute-t-il les Bambara et détruit-il en missionnaire zélé leurs « idoles ». Il interdit de façon véhémente les sociétés d'initiation. La révolte ne peut alors être évitée : en effet les rites religieux sont liés pour les païens à la fertilité des terres ; les empêcher revient à sécher les récoltes. L'indignation mystique se confond avec la peur de la faim.
Tiéba a connaissance de cette insurrection latente. Lui, dont la réputation de tolérance n'est pas usurpée, peut s'indigner du fanatisme des samoriens, se présenter aux Bambara comme un allié providentiel.
Le soulèvement éclate à la fin de 1884. Tiéba, pour mieux le contrôler, s'est rendu sur la frontière avec son frère BaBemba.
En décembre, il franchit le Bagoé qui limite ses terres, il met toutes ses forces au secours des insurgés. Pris entre deux feux, Tari-Mori s'affole. Plusieurs fois, les garnisons samoriennes sont submergées. En quelques semaines, attaquées de partout, les troupes de l'almami reculent.
Tiéba renonce — malheureusement pour lui — à profiter de l'avantage : d'autres problèmes l'appellent ailleurs. Cette erreur lui coûtera cher : il est dangereux de permettre la contre-attaque à Samori.
Celui-ci, furieux d'un échec qu'il n'admet pas, rassemble des troupes de renfort et fait porter un arrêt de mort au trop zélé Tar-Mori. Le kélétigui , conscient de sa faute, demanda néanmoins à périr noblement pour ne pas ternir l'honneur de ses fils. On maquilla l'exécution en accident. Tar-Mori organisa lui-même une partie de chasse. Arrivé au cúur de la brousse, il descendit de cheval, fit ses prières et présenta sa nuque. On emporta sa tête et sa main droite pour les remettre à l'almami.
Cet incapable éliminé, la situation se rétablit. Dès avril 1885, les révoltés bambara seront durement châtiés. Tiéba se rend compte alors de sa folie. Il comprend que Samori ne peut pardonner une défaite, n'eût-elle duré que quelques mois. Aussi envoie-t-il une ambassade aux Français de Bamako. Les Toucouleur de Ségou lui accordent le libre passage.
Tiéba s'inquiète un peu trop tôt : Samori, qu'un nouvel accrochage avec les Français retient aux bords du Niger, a remis la vengeance à plus tard. Il se contente de consolider sa position sur les rives du Bagoé et de maîtriser les tentatives de révoltes, dont celle du Banan, exaspéré par de trop lourdes réquisitions et contraint à des conversions peu sincères.
Car le temps est passé où les conquêtes se terminaient par des alliances enthousiastes. Le mors que Samori passait dans la bouche des vaincus s'est durci et il blesse. Du haut de sa puissance, le protecteur des routes du commerce est devenu zélateur de l'Islam. Il vainc mais ne pardonne plus. A la fin de 1896, jusqu'au Bagoé, le pays est soumis. Syaka, frère de Tiéba, s'étant imprudemment aventuré de l'autre côté du fleuve, est entièrement défait.
Que Samori se réjouisse, mais qu'il regarde plus au nord : là, toujours les Français. Qu'il se garde vers l'est : Tiéba, rendu furieux par la défaite de son frère, lui non plus ne désarme pas. Au centre, en pays bambara, le territoire conquis n'est couvert que de ruines, déserté par ses hommes, abandonné par ses troupeaux.
Oui, en cette fin de 1886, qu'il se réjouisse vite ! Dans les faits un succès éclatant ! Dans l'avenir ? Un friselis de nuages, apparemment peu dangereux, surgit de tous les horizons.
Mais avant d'aborder cette nouvelle période, il nous faut, pour achever le tableau, parler de la dernière frontière de l'empire, celle du sud.
Comme il a été indiqué, l'almami se méfie des pièges que lui tendent les terres où meurent les chevaux , d'autre part, il ménage les planteurs de cola, bons pourvoyeurs d'esclaves, clients irremplaçables pour le sel et les produits du nord. Rien de déterminant ne se passera donc vers la forêt. Sans doute ne se serait-il même rien passé si les chefs locaux n'avaient eux-mêmes attiré le malheur. Les populations forestières paraissent incapables de s'entendre ; elles entravent un commerce leur rapportant autant qu'à leurs partenaires du nord. Les années qui précèdent les tragédies de la savane vont être ensanglantées de combats : luttes intestines de tribus dont certaines se réclament abusivement de Samori, expéditions de ce dernier pour briser les barrières dressées par les rebelles sur la route de Monrovia.
Quoi qu'il en soit, en fin de décennie, Samori semble avoir respecté, autant que faire se peut, la limite de la forêt. Une des preuves les plus marquantes est la libéralité religieuse dont il fait preuve envers les colatiers — à comparer avec les conversions forcées qui se multiplient dans le nord.
Pour lui, les chemins spongieux de la forêt demeurent un passage , les habitants, des partenaires. Si des exactions y ont été commises au nom de l'almami, bien souvent celui-ci ignorait l'usage abusif que des chefs en mal de fortune faisaient opportunément de la crainte qu'il inspirait.
Car le drame ne se joue pas sur les terres humides mais sous le soleil éclatant qui craquelle le sol rouge ou s'imprime le pas des troupeaux.
En fait, le drame se joue plus loin encore : les adversaires réels de Samori ne sont plus les maîtres de Ségou ou de Kénédougou mais les gouvernements de Paris et de Londres. Cette menace, comment l'almami la discernerait-il ?
Les Anglais conservent toujours sur les côtes de la Sierra Leone l'apparence de paisibles marchands. En réalité, lorsqu'ils traitent avec Samori, ils voient moins le chef africain que la barrière qu'il oppose à la pénétration française. Leurs amitiés comme leurs dérobades sont provoquées beaucoup moins par les réactions de l'almami que par les négociations qui s'effectuent en Europe. Cependant, on peut constater, là encore, une incompréhension totale entre les pionniers d'Afrique et la mère patrie. La prudence de Londres dépasse celle de la France. Alors que les tirailleurs disposent de canons, Freetown doit agir par la diplomatie.
Samori, bien qu'il ait sans doute ignoré le traité du 10 août 1888 par lequel France et Angleterre décident de leurs zones d'influence, se rendra rapidement compte des limites britanniques. La preuve la plus évidente lui sera donnée lorsqu'une délégation anglaise, l'ayant rejoint sous les murs de Sikasso, ses pourvoyeurs bien-aimés contempleront sans réagir les désastres du siège, se contentant de lui donner quelques excellents « conseils militaires ».
Les relations avec la France vont se révéler plus compliquées. Nous l'avons dit, après avoir expérimenté à Kényéran et à Bamako les effets de tactiques et d'armes nouvelles, Samori avait cru sage d'éviter tout affrontement. Après la prise de Bamako, les Français semblent de leur côté mettre un frein à la conquête et se déclarent uniquement préoccupés d'organiser leurs possessions. Telle est tout au moins la doctrine officielle. Mais il faut compter avec le désir de gloire des officiers occupant le Soudan. Ceux-ci n'ont pas fait un aussi long voyage pour convoyer des vivres et des secours. Il leur faut des conquêtes.
Tel est cas de Combes, le nouveau commandant. Bien qu'ayant des ordres précis et restrictifs, celui-ci regarde avec envie du côté du Bouré, « pays de l'or », occupé par les alliés de Samori. Partant de l'idée qu'on a toujours raison lorsque l'on est vainqueur — et se croyant en mesure de l'être —, il attaque la région' fabuleuse. Les populations étant surprises par cette intrusion imprévisible, ses premiers résultats paraissent étonnants. Il écrit en avril 1885 au gouverneur du Sénégal : « Mes moyens étaient suffisants et j'ai réussi. » Cependant, modeste, il ajoute : « Les circonstances étaient favorables. »
Il est effectivement toujours favorable d'attaquer des villages qui croyaient à la paix. Mais c'est compter sans Samori. Pour Combes, « le petit chef nègre » devrait se plier dans l'effroi. Mauvaise appréciation : la contre-attaque est foudroyante. Non seulement Samori recouvre les terres occupées, mais il pourchasse l'ennemi qui parvient difficilement à fuir.
Cependant, peut-être le maître de Bissandougou fait-il preuve d'une trop grande prudence. Arrivé devant la nouvelle citadelle de pierres que les Français ont construite à Nyagasola, il ordonne la retraite. L'attaque de Combes lui paraissant absurde, il répugne à poursuivre une guerre qu'il n'a pas décidée. Méprisant les grandes forteresses, il organise une marche vers l'ouest montrant qu'il peut, s'il le désire, isoler les possessions françaises du Niger, les couper de leur ravitaillement. Cette expédition eut des répercussions jusqu'à Paris. L'on se rendit compte que le « chef nègre » constituait un obstacle capable de défier les canons. A une première trêve, négociée à la fin de 1885, succéda, après de nouveaux accrochages, un traité qui paraissait définitif, celui de Kényéba-Koura, remis le 29 mars 1886 aux autorités françaises de Kita.
Deux questions au sujet de ce traité : tout d'abord que contenait-il ? Une limitation des frontières que les contractants s'engageaient à ne pas dépasser, ensuite des dispositions commerciales, l'almami promettant de favoriser la France.
Pourquoi Samori l'a-t-il signé ? Ici la réponse paraît simple : il avait besoin non pas de l'alliance mais au moins de la neutralité française pour ses opérations contre le Kénédougou.
En fait, il s'agit d'un marché de dupes. Pour l'almami, les engagements ont un sens totalement différent de celui auquel les Français s'attachent. Ces derniers ont conçu des articles ayant force de loi. L'Africain signe une charte morale dont il convient de respecter non la lettre mais l'esprit. Pour les uns, toute entorse est envisageable pourvu qu'on sauvegarde la forme. Pour l'autre, ce texte est la preuve matérielle d'une entente dont l'exécution dépend de la loyauté de chacun.
S'il est difficile d'affirmer la bonne foi des Français, les faits semblent prouver celle de Samori. La marque la plus évidente est l'ambassade qu'il confie à son troisième fils — sans doute le préféré —, Dyaulé-Karamogho. Celui-ci se rend à Paris. On l'éblouit. On le mène aux courses et aux spectacles. Il est reçu par des ministres et par le président de la République. Quand il rentre, il se fait l'écho de la magnificence de la France.
Sur le terrain, tandis que Samori respecte les frontières, les Français changent de commandement, Gallieni s'est vu attribuer des forces bien supérieures à celles de ses prédécesseurs. Un de ses officiers, Péroz, reçoit pour mission de faire réviser le traité de Kényéba-Koura. Il paraît en effet inadmissible aux partisans de l'hégémonie qu'on reconnaisse des droits aux indigènes, surtout lorsque ceux-ci se montrent indépendants.
La nouvelle équipe va donc s'ingénier à obtenir la modification d'articles jugés trop favorables à Samori, des droits sur la rive gauche du Niger et surtout un titre opposable aux Anglais. Péroz, escomptant beaucoup de l'influence de Karamogho, se rend à Bissandougou.
Les résultats de cette ambassade sont d'abord négatifs. Samori se méfie de l'écrit qu'on lui propose — pour la première fois, le mot « protectorat » fait son apparition — et traite sans douceur les envoyés français. Il s'enquiert auprès d'eux : agissent-ils au nom du gouvernement ou bien pour mériter des récompenses ? Cependant, il signe, se rendant mal compte, homme de tradition orale, du poids d'une feuille de papier.
Il accepte, le 16 avril 1886, de se placer « lui, ses héritiers et ses Etats présents et à venir » sous la protection de la France. Un fois encore, le malentendu est évident : ce que l'almami entend par « protection » est une neutralité bienveillante pendant sa lutte contre Tiéba. Pour les Français, le protectorat est une victoire diplomatique, une barrière formelle opposée aux Anglais : vive Péroz ! la France a un traité prouvant la légitimité de ses possessions du Niger! Ce qu'a signé l'un n'a rien à voir avec ce que l'autre a proposé.
Le seul point où se rencontrent, sans se l'avouer, les signatures, est le côté provisoire qu'ils accordent à leur pacte d'amitié. Pour Gallieni, les chefs africains doivent être annihilés les uns après les autres et Samori, cet esprit libre, tout le premier. L'almami ne songe toujours qu'aux chances de réussite de sa campagne. Tiéba disparu et sa capitale Sikasso détruite, il sera temps d'affronter les Français. Une trêve passagère mais respectée : tel est le seul point sur lequel les contractants sont réellement d'accord. Mais sur ce point encore, les Français vont trahir. En effet, avant de s'embarquer, Gallieni signera avec Tiéba, assiégé dans Sikasso, un traité lui assurant la neutralité de la France.
Le commandant explique précisément dans un rapport :
« Je pense qu'il sera possible sans augmentation de dépenses d'étendre très loin notre influence dans la boucle du Niger. Il est nécessaire de persister dans notre mouvement d'extension et d'encourager Tiéba de manière à ruiner ou à faire disparaître ce souverain détesté. » (Le souverain détesté étant évidemment l'almami.)
Cependant, celui-ci, malgré la fausseté d'un compromis sans doute inévitable, concentrait toutes ses forces sur la perte de Tiéba.
Tiéba ! Par sa valeur humaine et militaire, il est certainement l'adversaire le plus remarquable qu'ait jamais affronté Samori. Rejeté par ses parents, combattu par des populations rebelles, ce faama — puisque tel est le titre qu'il a choisi — a réussi en quelques années à forger un empire où plus personne ne le conteste.
Le Kénédougou, « pays de la clarté », région aux horizons immenses inondés de soleil, est riche et fidèle au chef qui a su l'unifier. Bien qu'officiellement musulman, Tiéba règne sur des animistes.
Il refuse d'imposer sa foi ; il protège le commerce ; lie d'importantes alliances avec les Toucouleur comme avec les producteurs de cola. En fait son royaume et celui de Samori auraient bien pu coexister, l'un et l'autre ne cherchant qu'à s'assurer le núud de grands axes commerciaux parallèles. Mais, ils se trouvèrent jetés l'un contre l'autre par l'avance des Français.
Qu'il soit permis de rêver. D'imaginer les deux grands Africains unissant leurs forces, se coalisant contre l'envahisseur… Hélas ! ils ne le font pas. Etant voisins, l'un ne voit plus en l'autre qu'un adversaire. Chacun requiert contre son frère l'alliance des Européens.
C'est ainsi que Samori, s'étant assuré — tout au moins le croit-il — de la neutralité française, se lance contre Tiéba. Il réussit à franchir le Bagoé. Il investit le plat pays et parvient en vue de la capitale, disons de la citadelle.
En effet, jamais peut-être aucune ville africaine n'a été aussi bien défendue que Sikasso. Les murs qui s'élèvent à quatre mètres paraissent, avec leur banco mêlé de cailloux, aussi infranchissables que du ciment. Binger, quand il en approchera, parlera de « donjon » en voulant décrire l'ouvrage dominant les remparts aux nombreuses chicanes, imprenables avec l'armement assez limité du temps.
Mais Samori a déjà connu d'autres défenses. Les forteresses les plus inexpugnables peuvent être domptées par la faim… Tel n'est pas le cas de la capitale du Kénédougou. Vu sa position, à moitié protégée par les marécages, à moitié défendue par les sanyé redoutables qui l'entourent, Sikasso est approvisionnée de façon régulière. Bientôt, ce ne sont pas les assiégés mais les assiégeants qui souffrent de la faim et doivent faire transiter leurs céréales à travers des régions à demi désertées.
Il faut tout le génie et l'organisation de Samori, sa façon de ménager les relais, son autorité obligeant les femmes et les jeunes à porter, dans des conditions où ils trouvent fréquemment la mort, le ravitaillement des troupes, pour que les dizaines de milliers d'hommes qui entourent Sikasso ne meurent pas de faim. Ce sont les assiégeants qui s'inquiètent pour leur survie. Les assiégés reçoivent l'essentiel : s'ils ont moins d'armes et d'hommes que les troupes qui les encerclent, ils utilisent des boucliers à l'épreuve des balles et se servent au mieux des alliances qui se multiplient contre l'almami.
Samori doit faire appel à Langaman-Fali qui garde les grandes rivières et les frontières de l'ouest. Hélas Langaman se fait tuer. Les meilleurs parmi les frères de Samori dont Kémé-Brèma, l'adversaire redoutable des Blancs disparaissent à leur tour sous les murs de la ville. Les sofas se font massacrer en menant de vaines attaques contre la citadelle ou les sanyé.
Cela ne serait que mauvaise fortune passagère sans l'attitude des Européens. Nous l'avons dit, les Anglais dépêchent, « pour savoir », un des leurs, le major Festing, sous les murs de Sikasso. Pour bien prouver sa neutralité, le détachement ne comprend que onze hommes, nombre ridicule dont on ne peut attendre aucun secours. Samori sera difficilement crédible lorsqu'il affirmera, se basant sur cette mission d'enquête, que l'Angleterre prend position en sa faveur.
Passe encore : il n'y a aucun traité militaire entre la Grande-Bretagne et l'almami. L'attitude de la France est beaucoup plus perfide. Si l'on se fie aux traités de Kényéba-Koura et de Bissandougou, les envahisseurs sont des alliés de Samori. En fait, ils escomptent sa chute. Lorsque Binger, envoyé par ses chefs, se rend à Sikasso, il soupèse bien moins les chances de vaincre de Samori que les marques de sa déconfiture. Tous les rapports qu'il fait à Gallieni sont en faveur de la victoire de Tiéba.
Cette réaction est dans la logique de la puissance coloniale : Samori paraissant le plus fort, il importe de soutenir les chefs moins puissants, quitte à combattre ces derniers lorsqu'ils auront, avec leur sang, déblayé le terrain.
Samori n'est pas dupe. Il ne s'indignera qu'à moitié lorsqu'il apprendra que Tiéba a conclu un traité secret avec la France. Dès cette époque, il est persuadé que l'amie officielle attend son premier signe de faiblesse pour lui porter un dernier coup.
Cependant, la situation se révèle sans issue : pendant quinze mois, l'almami refuse d'admettre son impuissance — il a espéré vaincre en plusieurs occasions. Pendant quinze mois, les caravanes de porteurs, jeunes et femmes, sillonnent les pistes dénudées et meurent. Pendant quinze mois, Samori commande périodiquement des attaques où les pertes subies le rapprochent de la défaite chaque jour.
Mais, tandis que les agents de Gallieni occupent Siguiri, la révolte gronde dans les provinces. Les paysans sont las de réquisitions ne leur laissant plus de quoi vivre. Les pères dont la fille ou le fils est mort en portant les dernières récoltes vers le Kénédougou se révoltent. Sentant le maître absent, les populations nouvellement conquises pensent à l'indépendance. La menace de la France se fait encore plus lourde. Pour la première fois, le conquérant se sent acculé dans le piège. La subversion du Wasulu l'ayant isolé de sa capitale, il abandonne le siège et décide de rouvrir la route. Dans les derniers jours d'août 1888, profitant d'une nuit noire et pluvieuse, il se retire avec une faible escorte.
La défaite est bien plus grave qu'il n'y paraît. En fait, il ne s'agit pas d'un échec militaire : les hommes qui redoutaient Samori viennent soudain de perdre la foi. Le vainqueur n'est plus invincible. Celui qui se voulait le père de la paix et du commerce a montré qu'il pouvait, sous la nécessité, se conduire en tyran. Samori cesse d'être celui qui rassemble les hommes et qui fait naître l'abondance. Son nom se mêle à celui d'effort de guerre, de disette et de réquisition. Ce qu'il vient de perdre, ce n'est pas Sikasso, mais le respect d'une partie de son peuple. Car :
« J'ai lancé la poignée de cauris, hélas ! le vent les a mêlés au sable. Qui lirait l'avenir dans la poussière ? L'ennemi a craché dans le sable. Rien de bon n'en saurait résulter… »
Mais avant d'aborder la période difficile, peut-être serait-il juste de jeter un regard sur celui qui vient de forger un empire se trouvant encore à l'apogée de sa splendeur.
Le dernier portrait que nous avons tracé de Samori était celui du jeune colporteur inquiétant et prêt à se battre. Les années ont passé et l'on peut s'étonner du chemin qu'il a parcouru.
Son ascension est d'autant plus extraordinaire, qu'au départ, il possède un nombre très limité d'atouts. Né dans le Konyan, où le pouvoir se transmet dans les mêmes familles selon des règles strictes, il ne peut se prétendre héritier d'aucune grande lignée mandingue. Se voulant dans un premier temps champion des animistes, sa conversion à l'Islam le rend éminemment suspect. Optant pour l'Islam, il n'en possède que les rites extérieurs. Dans une société où la science et la connaissance des livres saints paraissent indispensables, le nouveau converti fait figure d'ignorant.
Non, aucun passe-droit, aucun privilège, aucune chance arbitraire ne peuvent expliquer l'ascension de Samori. Il occupe dans l'histoire le rang exceptionnel de l'homme qui ne doit rien qu'à son génie.
Génie militaire s'il en fut — mais d'autres l'ont domestiqué et d'autres le posséderont encore — mais surtout connaissance des hommes, prescience de la manière de les assujettir. La lucidité de son jugement peut frapper par son cynisme, mais l'on est encore plus étonné de la mesure qu'il sut garder dans ses moindres décisions. Nul ne peut, de bonne foi, soutenir que Samori ait été un tyran aveugle.
Que ne reste-t-il attaché aux valeurs pragmatiques qui l'ont soutenu ! Sa première et plus grande erreur est d'accepter les arguties des autres. Agissant en homme, vertueux, soucieux de propager les versets du Prophète, les conseillers dont Samori s'entoure après la prise de Kankan le subjuguent. Mais s'ils connaissent le Livre Saint, ils comprennent mal que la vérité possède mille facettes ; que Dieu convertit l'homme lorsqu'il le juge bon. Ils entraînent vers une inutile rigueur leur néophyte et maître. Celui-ci va gouverner pendant plus de deux ans en fonction de leur enseignement. Pour la première fois, il néglige les faits.
Nous avons déjà parlé de cette métamorphose, mais il est bon d'y revenir. Donc, jusque vers 1883-1884, Samori réagit en bon joueur d'échecs, considérant non seulement la disposition des pions mais les réactions de l'adversaire. Pourtant, depuis longtemps, l'Islam le fascine. S'agit-il de conviction intime, d'admiration pour un ordre transcendant le chaos animiste ou bien de la recherche d'un facteur d'unité ? Nous ne répondrons pas au nom de celui qui n'est plus.
Il faut le constater : après la prise de Kankan, Samori s'entoure de lettrés et de « sages ». L'illettré apprend à déchiffrer les caractères arabes grâce à un des plus éminents savants de la ville, Karamogho-Sidiki. C'est alors qu'il ordonne qu'on le nomme almami. Ce titre qu'il allait rendre prestigieux provient en fait d'un parti-pris modeste : « l'almami », dans son sens premier, est l'homme qui dirige, jusque dans les hameaux, la grande prière du vendredi. Cela et rien de plus. Il faut dire que d'autres chefs, comme les souverains du Fouta, s'étaient déjà emparés du terme, voulant marquer par là le côté spirituel de leur pouvoir. Le maître d'un empire se déclarant iman ! En fait, cet humble titre peut paraître usurpé, car mener la prière sous-entend une connaissance satisfaisante du Coran, le Livre Saint. Samori la possède-t-il ?
Il y travaille. Mais même en terre d'Islam, mêler le temporel au spirituel est, selon les moments, bénéfique ou dangereux. Samori rencontre ses premiers — et très virulents — opposants, au sein même de sa famille. En effet le droit islamique prévoit que les fils héritent de leur père. Or les frères de l'almami, malgré ou à cause de leur dévouement, espèrent bien lui succéder selon les lois païennes. Samori leur retire cet espoir. Il place auprès de chacun d'eux un de ses fils afin qu'il apprenne les mystères du commandement. Le mécontentement grandit : l'almami n'exige-t-il pas que sa propre famille l'appelle « N'Fa », c'est-à-dire « Père », et renonce aux prérogatives qu'elle pouvait espérer de leurs liens ?
Pourtant, ses frères, comprenant de qui vient leur puissance, admettront sans trop de peine qu'il vaut mieux obéir. Samori ne leur a-t-il pas dit :
« Vous n'avez pas à vous plaindre : rien ne m'est venu de notre père. Tout ce que j'ai, c'est moi qui l'ai conquis et c'est à mes enfants que je le laisserai. Telle est la loi de Dieu. »
Non, l'adversaire le plus redoutable que Samori ait à convaincre est le vieux Laafiya Touré, son propre père. Celui-ci reste, en dépit des objurgations , un animiste irréductible. Lorsqu'en novembre 1886, son fils coiffe de façon solennelle le turban de mousseline blanche consacrant sa nouvelle qualité d'érudit ; lorsqu'il ordonne aux Kamara de se convertir et de cesser de boire le dolo, le vieillard devient un ferment de révolte. Alors que l'almami édicte ses nouvelles lois, il sort bruyamment de l'assemblée : beaucoup d'autres le suivent, comme le suivra une grande foule lorsqu'il organise le lendemain une scandaleuse procession à la cascade Dyigbé, principal esprit du territoire de Sanankoro.
Cette réaction paraît d'autant plus exécrable au nouveau défenseur de la Foi que les fils de Laafiya, mécontents comme on l'a vu plus haut, prennent sournoisement le parti de leur père dont ils excitent la fureur.
Malgré les menaces — il fait mettre Laafiya en résidence surveillée et jure de massacrer tous les rebelles —, Samori devra se résoudre à un compromis. A condition d'observer une discrétion minimum, les animistes auront droit de suivre leurs coutumes, leur seule obligation étant de respecter la prière du vendredi. Compromis apprécié des païens qui fêtèrent leur victoire en buvant le dolo de façon, il faut le dire, de moins en moins discrète. Laafiya lui-même ne se pliera que de façon intermittente à ses obligations. Bien qu'aucune brouille officielle ne sépare le père du fils, la méfiance présidera à leurs rapports, d'autant plus qu'un autre drame va assombrir la décision de l'almami.
Deux de ses filles, confiées à l'une de leurs belles-mères, furent accusées à cette époque d'avoir accordé leurs faveurs à des bilakoro — jeunes captifs élevés par l'almami dans le métier des armes. Ne pouvant admettre que sa propre famille bafoue la virginité prescrite par le Coran, Samori condamna à mort les coupables. Or, il apprit trop tard que la marâtre, femme vieillie et jalouse, les avait accusées faussement.
Cette « erreur », ressentie douloureusement par Samori, lui fut très longtemps reprochée. Ses ennemis, dont les Français, étaient heureux de dénoncer la « cruauté » de l'almami. En fait, sans vouloir minimiser l'horreur de ces morts innocentes, il faut comprendre que Samori sentant la révolte gronder ait cru devoir, même un peu trop vite, faire un exemple.
Nous dirons plus tard comment, après l'échec de Sikasso, l'almami comprit que l'orthodoxie religieuse s'accommode mal de la réalité. Il renonça à mettre ses principes en pratique de façon virulente, car les oppositions dépassaient depuis longtemps le cadre de sa famille. Nous avons mentionné la révolte bambara ; elle fut suivie par beaucoup d'autres. Aussi, sans renoncer aux lois qu'il avait dictées, Samori les fit appliquer avec modération : s'il favorisa l'Islam, ce fut en prenant garde de ne plus molester les païens. Seule la cour demeura astreinte aux pratiques religieuses, et les courtisans, on s'en doute, rivalisèrent de zèle sans jamais tenter de s'y opposer.
Mais puisque nous avons abordé, dans un moment de crise, les problèmes familiaux de l'almami, peut-être serait-il bon d'analyser plus avant sa vie privée. Comment se présente l'homme qui, malgré sa verdeur, voit se profiler la vieillesse ? Sans doute n'est-il pas très différent du portrait que, dix ans plus tard, Gouraud, qui l'avait capturé, fera de lui :
« Physiquement, c'est un homme robuste, grand ; les yeux, enfoncés sous l'arcade sourcilière, sont vifs et rusés, le nez gros, la bouche grande, les dents éclatantes. Je vois ce grand corps de vieillard solide, couvert de blessures : dans ses débuts de soldat, il avait reçu des balles, des flèches, des coups de sagaie, de sabre… »
Et au moral ? Binger ñ qu'on ne peut soupçonner de tendresse — évoque « sa voix chaude et persuasive ». Gouraud, de son côté, lui reconnaît « une certaine bonhomie railleuse ». Chacun s'accorde pour vanter la maîtrise qu'il possédait de lui.
En fait, ces jugements, dont la principale valeur est de nous être parvenus, ne peuvent rendre compte du rayonnement dont semblait doté Samori. Les dévouements qu'il a suscités, le ralliement sincère et parfois inattendu de ses ennemis, ne peuvent s'expliquer que par la magie d'une personnalité très au-dessus de l'ordinaire.
Plusieurs fois, les Français, essayant de circonvenir des peuples nouvellement alliés, se heurtèrent à un refus qui les étonna. Comment auraient-ils pu comprendre que ce « barbare » était un chef vénéré autant qu'il était craint ?
Certains ont voulu appeler son empire, qui jamais ne porta de nom, le « Samoridougou » : en fait, aucun terme ne pouvait cerner mieux la réalité d'un Etat fondé sur la volonté et la personnalité d'un seul homme.
Mais en ces années 1880, comment vit le monarque ? Comme tout souverain malinké, il possède un grand nombre de femmes — le maximum de quatre prescrit par le Coran étant rarement respecté dans ces régions où mariage signifie alliance de peuple à peuple.
Cependant, deux statuts différents régissent ses épouses. Les unes, de moindre importance, vivent en des sortes de communautés placées sous l'autorité d'une matrone. Samori subvient à leurs besoins. Les autres, dont le nombre ne paraît pas avoir excédé la vingtaine, jouissent d'une autre condition. Elles possèdent une fortune personnelle ; leur maître les comble de cadeaux. Ce traitement privilégié provient de la faveur de l'almami, du rang social de la femme ou du nombre d'enfants qu'elle a donnés au souverain. Certaines se distinguent encore parmi leurs súurs, telle cette Sarankényi Konate qui parvint, bien que son fils soit encore en bas âge, à le faire reconnaître comme successeur de l'almami et qui, selon le témoignage des Français, possédait des troupeaux en nombre considérable. Il faut dire que cette même Sarankényi eut une influence bénéfique et exerça pendant le siège de Sikasso une régence qu'elle sut mener à bien.
On comprend qu'avec un aussi grand nombre de compagnes, Samori ait engendré un nombre respectable d'enfants. Le chiffre exact ne nous est pas connu. Les témoignages les plus dignes de foi parlent de 53 filles et de plus de 100 fils.
Si l'on ignore quelle éducation fut donnée aux plus âgés de ces derniers, l'on est beaucoup mieux informé sur la discipline que Samori imposa à ses garçons à partir de 1885. Dès que les adolescents étaient circoncis, il les groupait dans un village où, avec les fils de grandes familles, ils recevaient une rude formation. Celle-ci développait leurs aptitudes militaires, mais était également religieuse et confiée aux plus grands marabouts.
Le seul qui eut droit à un traitement spécial fut Sarankényi-Mori, fils de la favorite. Héritier officiel, il reçut une garde personnelle et fut envoyé à Kankan pour étudier le Livre saint.
Certains ont voulu faire de Samori, à la suite du meurtre de ses deux filles évoqué plus haut et de celui de Karamogho-Mori dont nous parlerons plus tard, une sorte de tyran paternel. En fait, il semble avoir agi, en dehors de ces cas extrêmes, en « bon père de famille » selon la définition du temps où il n'était évidemment pas question d'avoir des liens suivis et chaleureux avec des descendants se comptant par dizaines.
En dehors de sa famille, Samori vit au centre d'une véritable cour : marabouts et griots se disputent les places. Sa garde, souvent d'origine servile, est redoutable et bien armée. Mais l'institution la plus originale est sans conteste celle des bilakoro. Ce nom signifie « porteur de cache-sexe », c'est-à-dire « enfant », par opposition aux circoncis ayant seuls droit de revêtir le large pantalon soudanais. Samori avait exigé que le butin lui revenant en tant que chef soit composé en priorité de jeunes garçons razziés chez l'ennemi. A ces enfants, il fit donner une formation qu'il surveillait lui-même et qui, en moins poussée, rappelait celle qu'il donnait à ses propres descendants. Vivant en groupes, en dehors de tout lien familial, ces jeunes gens se voyaient inculquer non seulement des principes religieux et militaires mais encore un culte et un dévouement inconditionnels pour Samori. Recevant un fusil dès leur circoncision, ils allaient devenir les éléments les plus sûrs et les plus fidèles de l'armée samorienne ; ils fournirent également une grande partie des chefs qui devaient s'illustrer pendant les dernières années de l'empire.
Celui-ci, au sommet de sa puissance, était, nous l'avons dit, aussi vaste que divers par les peuples qui le composaient. Cette mosaïque était-elle gouvernable ?
Les Français expliquent la cohésion de l'empire par la tyrannie personnelle qu'aurait fait régner Samori. Gallieni écrit :
« Cet homme, qui a certainement de grandes qualités et une énergie extraordinaire, finira par tomber sous peu. Il fait tout par lui-même et n'a personne en qui il ait une confiance absolue. S'il est tué ou blessé, si quelque revers survient, tout se désagrégera immédiatement. »
En fait, ce jugement est erroné, et l'almami s'appuie, — comment pourrait-il faire autrement ? — sur toute une série de rouages dont le plus important est son propre conseil.
Cette instance, on le sait, existe avec une influence plus ou moins étendue auprès de la majorité des chefs soudanais. L'originalité de l'institution samorienne provient de sa composition. En effet, pour la nomination de ses notables, le fils de colporteurs n'a pas à respecter le protocole. Il est maître absolu de son choix. Si, au début, il s'entoure principalement d'hommes de caste dont il connaît la fidélité, une mutation profonde intervient après la chute de Kankan. A cette époque, les musulmans intransigeants deviennent majoritaires ; exégètes du Coran et légistes prennent le pas sur les premiers fidèles dont Samori apprécie encore le jugement. Le conseil se réunit tous les jours et il suit son maître à la guerre. Samori, le plus souvent, respecte ses avis.
Mais comment les décisions, prises dans la cour souvent mouvante de l'almami, sont-elles connues et appliquées sur l'ensemble de l'empire ? Nous avons dit que la diversité de religions, des múurs, la permanence des vieilles querelles rendent l'unité fragile. Il importe que l'autorité centrale soit souple mais présente, inébranlable sans contraindre trop manifestement. Samori essaie de créer cet équilibre difficile.
Les provinces dépendent officiellement de chefs militaires qui les occupent, en vivent, y maintiennent la paix. Cependant, les cellules traditionnelles demeurent. Si les chefs, en buvant le « dégé » — sorte de bouillie délayée dans du lait aigre —, ont fait allégeance à l'almami, ils n'en gardent pas moins leurs prérogatives. A condition de fournir régulièrement des redevances en hommes et en nature, ils administrent — en principe librement — leurs terres et leurs sujets, conservant le droit de rendre justice. (Samori a vite abandonné l'idée d'imposer la loi des marabouts.)
Dans les faits, cette liberté presque absolue se révèle très conditionnelle : l'almami a installé, auprès de la plupart des chefs, de vieux kélétigui ou même des sofas . Ceux-ci contrôlent discrètement. Ils informent régulièrement leur maître. S'ils ne disposent d'aucune force militaire, ils ont la possibilité de faire appel, en cas de révolte, au chef de la région.
Par grâce samorienne, les chefs traditionnels sont donc entièrement libres… à condition qu'ils obéissent. Tel est le cas des responsables régionaux. Ceux-ci continuent à porter le titre militaire de kélétigui . Ce sont avant tout des guerriers, forces toujours présentes, propres à dissuader les rebelles. Samori confie ces postes soit à ses frères, soit à d'anciens compagnons d'armes dont il connaît la fidélité. Sa confiance est évidente ; les kélétigui se voient affecter une armée, ils peuvent s'entourer d'un conseil. Cependant, là encore, la limite apparaît. Les chefs de région ne sont jamais que les représentants du maître.
Tout pouvoir émane de Samori et lui revient. La liberté laissée à ces mandataires pourrait se comparer à celle de nos préfets modernes : leur justice ne s'étend ni sur les marabouts ni sur les personnalités ; ils ne peuvent percevoir d'amendes ; toute initiative, excepté en cas extrême, leur est interdite ; enfin, ils doivent, pour la perception des impôts, obéir à des règles édictées par Bissandougou.
En effet l'Etat survit — quel contribuable s'en étonnerait — grâce aux redevances. La plus importante est celle touchant la production. Samori s'en réserve la dîme et perçoit également des péages et des droits de marché. Une autre source de revenus provient des frais de justice ; enfin le « moudé » permet d'entretenir un iman dans chaque village. Cependant, vu les nombreuses exemptions, ces ressources seraient insuffisantes sans le butin de guerre. Samori prélève un tiers de celui-ci.
Or la guerre, qui ne cesse d'apparaître en filigrane derrière toutes les institutions, se montre généreuse.
Créatrice, pourvoyeuse, chien de garde, l'armée, silencieuse et omniprésente, demeure la clef de voûte de l'empire. On a beaucoup parlé de sa puissance, tour à tour minimisée ou grossie. Péroz — le négociateur du traité de Bissandougou — l'estime, en 1886, à 50.000 fantassins et à 4.000 cavaliers. Cette comptabilité suscite une certaine méfiance, l'auteur avouant qu'il s'agit de « on-dit ».
Donc, aucun chiffre précis. Par contre, il est possible d'affirmer qu'il s'agissait, pour l'époque, d'un déploiement considérable. Mais plus que par ses effectifs, cette armée paraît redoutable grâce à son entraînement et à l'efficacité de ses armes.
En effet, l'almami a très vite compris la raison de ses premiers échecs devant les Blancs. L'attitude ambiguë des Anglais, la Grande Révolte, qui le sépare momentanément de Freetown, l'amènent à tenter de se dégager de sa dépendance vis-à-vis de l'industrie européenne. Pari difficile à tenir. En effet, alors que les forgerons de Samori accomplissent des prodiges, parvenant à réparer puis à fabriquer des fusils, de la poudre, des cartouches, la production de guerre, s'appuyant sur les moyens redoutables de l'industrie et de la technique fait, à partir de 1860, en Europe, des progrès effrayants. L'ingéniosité des artisans se heurte à des inventions qui, pour tuer de façon plus certaine, se compliquent. Mais lorsqu'on pense que les « armes modernes » utilisées au moment de l'accession de Samori n'étaient que des fusils d'importation à pierre, on se doit d'admirer, autant que l'habileté des forgerons, la ténacité de leur maître.
Hélas, la compétition est inégale. La pauvreté relative de ces armes — devenues cependant les plus efficaces que l'on ait forgées sur le continent — allait être une des causes de la défaite de l'almami.
Pourtant, cette course aux fusils eut au Soudan des répercussions positives. Sans parler de l'esprit d'invention, elle favorisa indirectement la production et le commerce : pour acheter les armes indispensables, Samori orienta l'activité nationale vers l'exportation, qu'il s'agisse de denrées agricoles (comme le cola), de produits de chasse (ivoire), de la mine (or) ou de la cueillette (caoutchouc). De même, il intensifia sa vigilance sur les grandes routes commerciales. Il les rendit praticables et sûres afin de faciliter le transit des armements et des chevaux.
Il est malheureusement impossible, en si peu de pages, de donner une idée exacte des conséquences qu'eurent les guerres et la gestion de Samori. Il faudrait parler de ses innovations militaires, des constructions de forteresses, de la hiérarchie, de la discipline qu'il fit régner dans ses armées, tout comme de la façon dont il résolut les problèmes d'intendance jugés par d'autres secondaires.
Hélas ! il nous faut, après cette halte artificielle, quitter la description sereine pour replonger dans la guerre qui éclate et tourbillonne jusqu'au cúur de l'empire.
En cette fin d'hivernage 1888, le conflit s'étend partout. Nous l'avons indiqué : las des réquisitions imposées par l'almami, las de l'intransigeance religieuse dont font preuve ses lieutenants, les peuples soumis ou même librement alliés se soulèvent. La révolte qui se propage en quelques semaines sera appelée GBan-Kélé ou « Guerre du refus ». Le mouvement est accentué par les faux bruits que colportent les griots et les marchands : beaucoup affirment que Samori est mort, ce qui délie tous ceux qui ont bu le dégé et ont juré obéissance ; d'autres, faisant assaut de mauvaises nouvelles, prétendent que, furieux contre sa famille, l'almami a nommé comme successeur Moryfindian, son griot inconditionnel. Cette invention provoque le résultat que l'on attend : elle choque tous les chefs dans leur mépris des hommes de caste et plus particulièrement les animistes qui détestent pêle-mêle tout ce qui s'avoue musulman.
L'insurrection éclate partout à la fois, apparemment sans liens. Le mouvement paraît spontané ; les insurgés n'essaient pas de s'unir. Moins que des chefs vénérables, ce sont de jeunes hommes, des guerriers encore inconnus qui mènent le soulèvement. Il naît de toutes parts des champions tribalistes, des défenseurs de religions contradictoires. Tous invoquent la liberté et lancent des coups de boutoir contre l'unité qui s'effondre.
Les premiers craquements ont lieu sur les frontières, parmi des peuples imparfaitement acquis. Dans la vallée du Niger, les Français, qui croient, ou feignent de croire, à la disparition de l'almami, soutiennent la révolte. Les troupes bambara, menées contre leur volonté vers l'ouest, se mutinent. Malgré le dévouement de fidèles, les sofas attaqués, trahis de toutes parts, s'enfuient. Ils refluent tandis que l'ennemi étend sa puissance sur les routes de Freetown, l'indispensable pourvoyeuse de fusils.
En quelques semaines, il ne s'agit plus de maintenir l'intégralité du territoire mais de sauver la capitale, d'interdire les accès menant à Bissandougou.
Là, aucune trahison ne semble à craindre. La favorite et régente, Sarankényi, fait preuve d'énergie et d'intelligence. Elle sait jouer des fidélités et remplace, aussi bien qu'un homme, l'almami.
Cependant, les gens du Wasulu, à leur tour, se mettent dans la danse. Ils coupent Sikasso et ses assiégeants exsangues du reste de l'empire. Cette révolte, arrêtant les colonnes de ravitaillement, devrait faire comprendre aux samoriens qu'il n'est plus temps de s'obstiner. Pourtant, devant l'évidence, l'almami se cabre. Il minimise le soulèvement, surestimant ses ultimes chances.
C'est alors que le centre même de l'empire, le Konyan, vacille. Persuadés de la mort de Samori, refusant de se soumettre à son successeur présumé, une large partie des clans Kamara se révolte. Seules quelques chefferies demeureront fidèles. Fidélité inestimable : elle empêchera les insurgés du haut Konyan de rejoindre les révoltés de l'ouest.
Malgré ces noyaux de résistance, les insoumis estiment avoir secoué le joug. Partout, ils se réjouissent quand parvient une terrible nouvelle : Samori n'est pas mort. Il pénètre dans ses terres et surgit brutalement en ces derniers jours d'août 1888, après avoir quitté secrètement Sikasso. Alors, les légendes basculent.
Les mêmes qui répandaient le bruit de son décès, affabulent et décuplent sa force. Les révoltés invincibles d'hier craignent de l'affronter. A l'euphorie succède la panique. Dans un empire qui n'est plus qu'étoffe déchirée, le seul nom de l'almami suffit à semer la terreur. S'ils étaient capables de conserver la tête froide, les insurgés sauraient qu'ils demeurent sans conteste les plus forts. Mais retrouvant le vieux respect du maître, la plupart sont déjà fascinés. On dit que l'almami affronta les premiers villages dissidents à peu près seul et que ses adversaires demeurèrent pétrifiés devant lui.
La vérité semble tout autre. Samori, loin de se livrer à une tentative aussi désespérée que romantique, se renseigne ; il médite sur la tactique à suivre, il met de son côté tous les atouts. Le plus important paraît être de reconstituer un semblant de force. L'opération n'est pas facile. Beaucoup des sofas que n'a pas décimés le siège ont trahi ; d'autres demeurent suspects. La première armée qu'il rassemble paraît le fantôme branlant d'une puissance abolie. Mais Samori a retrouvé ses vieilles méthodes : séduction, division, intimidation mêlée de promesses. En quelques semaines, il parvient à saper le moral de ses ennemis.
Quand il donne l'assaut, les révoltés s'estiment, sans raison profonde, aux abois. Là se place l'épisode le plus sanglant de son histoire, à Samamouroula, qui lui ferme la route de Bissandougou et du Milo. Pour ne pas s'en indigner, il faut se rappeler combien la situation était désespérée. Pour l'almami, une seule alternative : retrouver immédiatement sa pleine autorité ou disparaître. Rouvrir les chemins de sa capitale ou demeurer dans l'isolement.
Les assiégés tentent de négocier ? Il fait décapiter leurs parlementaires. Il investit la place, les rebelles, au nombre de plusieurs milliers, sont mis à mort. La légende affirme que les bourreaux décapitèrent pendant de longues heures sans prendre un instant de repos. On montre encore aujourd'hui, au nord de ce village, un ravin qui, selon plusieurs témoignages, aurait été creusé par des ruisseaux de sang.
Cette cruauté délibérée fut évidemment mise à profit par les adversaires du conquérant. Mais combien, après avoir frôlé l'abîme de façon aussi proche, se seraient relevés ? Car que lui reste-t-il comme alliés ? Presque personne, et les derniers fidèles paraissent hésitants. Qui a-t-il comme ennemis ? Le Kénédougou, la France, les Toucouleur d'Amadou qui estiment que l'occasion est bonne… sans compter à l'intérieur la multitude des soulèvements. Il aurait été suicidaire, en de telles circonstances, de ne pas frapper un grand coup.
Ayant rétabli une partie de son autorité — pour la première fois sans économiser le sang —, Samori prend l'initiative. Il importe tout d'abord de dissuader les Français de poursuivre leurs intrigues. Aussi n'essaie-t-il pas de retourner à Bissandougou. Il s'installe à Ngako dans le Wasulu et dégage les places les plus menacées. Il reconstitue une armée qui mérite à nouveau ce nom : tout ce qui demeure de généraux fidèles reçoit un commandement. Tandis que lui-même surveille les positions de l'est — il faut protéger les rives du Niger et prévoir les attaques de Tiéba encore hésitant —, Dyaulé-Karamogho est envoyé vers l'ouest. Le pays, tout au moins dans la pensée du maître, est déjà à moitié reconquis.
Mais que font les Français ? On l'a vu, leur dynamisme et leur ingérence varient selon leur commandement. Or, en septembre 1888, Gallieni étant rentré en France, Paris désigne un nouveau chef. Il se nomme Archinard. De grade assez modeste, il a ordre de mettre en valeur le territoire consolidé par son prédécesseur. Cela et rien de plus. On oublie un peu vite qu'il s'agit d'un protégé de Borgnis-Desbordes qui l'a en grande estime, sachant que cet officier, irrité par les lenteurs de sa promotion, possède les dents longues, et va profiter de l'occasion.
Excellente analyse. Mais si Archinard se montre un émule fidèle de Borgnis-Desbordes, c'est moins en respectant ses ordres qu'en préservant sa propre indépendance vis-à-vis du Sénégal et de Paris. Pour Archinard, la conquête ne peut s'arrêter au Niger. Il rêve déjà du lac Tchad, ce qui implique l'élimination d'un nombre considérable d'obstacles. Parmi eux, Amadou, bien sûr, et les dernières velléités de l'empire toucouleur , mais aussi l'almami, bien qu'il croit le conquérant sur son déclin.
L'estimant faible, c'est vers lui qu'il compte diriger ses attaques. Une fois encore, voici un officier français ayant reçu des consignes restrictives et décidé à les outrepasser. Cependant, ses forces sont médiocres — rien à voir avec l'effectif confié à Gallieni. A la fin du mois d'octobre, le nouveau commandant s'installe dans la forteresse de Kayes. Dès le début de décembre, il prépare le terrain en écrivant au gouverneur du Sénégal : « Il se passe un fait bizarre : malgré le traité de Bissandougou, tous les pays entre Niger et Tinkisso agissent comme s'ils étaient à nous. Les fuyards s'y réfugient et s'y croient chez nous, Je verrai s'il y a lieu d'en profiter. La politique de Gallieni porte ses fruits. »
Parallèlement, il encourage les insurgés et fait traverser par ses troupes le territoire qu'il compte annexer. Samori est trop occupé à mater la rébellion pour s'opposer ouvertement aux manoeuvres de la France. Il temporise, il offre même au début de janvier 1889 de céder aux Blancs la région située à l'ouest du Niger jusqu'aux sources du fleuve.
Ce succès inattendu de sa diplomatie comble de joie le commandant français : en fait Samori a cédé, de façon qu'il pense provisoire, des pays en révolte qu'il ne contrôle plus. Une fois encore va être signé, le 21 février à Nyaro, un traité auquel aucun des deux intéressés n'accorde le même sens. Archinard estime faire coup double : il officialise la dépendance de Samori et oppose un document authentique aux prétentions britanniques de la Sierra Leone. Pour Samori, il s'agit de gagner du temps ; cependant, les réserves qu'il émet à la lecture du texte qu'on lui propose devraient faire comprendre que la partie n'est pas gagnée. Même en sachant le peu de crédit qu'il doit accorder à de tels accords, Samori repousse les clauses de monopole commercial qu'on veut lui imposer ; il détaille minutieusement les limites des territoires qu'il cède et propose plusieurs formules pour régler les conflits le long du fleuve.
Un autre point est laissé très volontairement dans le vague : Archinard voudrait que l'almami, allié fidèle, scelle l'amitié sincère qui lie les deux pays. On l'attend à Siguiri, en territoire français. Qu'il vienne : il y sera reçu avec les honneurs dus à son rang. Samori s'y engage, mais avec réticence: qu'on l'attende… il viendra, c'est certain… Lui-même va fixer prochainement le jour…
Quoi qu'il en soit, Archinard rêve. Il voit déjà un résident français installé à Bissandougou. Estimant possible de neutraliser ses deux ennemis, il a d'autre part, de façon assez imprévisible, provoqué les Toucouleur. Cette initiative malheureuse n'aura d'autre effet que de rejeter provisoirement Agibou, frère d'Amadou, du côté de l'almami.
Ce dernier, cependant, fait le mort. Près de deux mois ont passé : il semble avoir oublié la visite de courtoisie promise. Cette attitude exaspère Archinard. Il pense qu'en montrant sa force il terrifiera le récalcitrant. Prenant lui-même la tête de sa petite armée, il la dirige vers le Haut-Niger. Sur la frontière, il favorise les razzias qu'exercent les réfugiés dans les possessions samoriennes. Il outrepasse ses prérogatives, envahit des villes contrôlées par l'almami, moleste et fusille certains de ses alliés.
Samori essaie une fois encore de temporiser. Il envoie une ambassade relativement courtoise à Archinard. Mais ce déploiement d'activités menées en dépit des promesses dépasse la limite acceptable. Le 23 mai 1889, Archinard apprendra que l'almami vient de lui renvoyer le traité de Nyaro.
Ce rejet, à la fois digne et méprisant, indigne le commandant français . Il écrit : « Est-ce l'acte d'un fou, une simple fanfaronnade ou le coup de tête d'un homme réduit au désespoir qui sent son empire crouler ? »
Rien de tout ça. Samori a simplement perdu la dernière illusion qu'il conservait encore. Il a compris que les traités sont le plus souvent des pièges dans lesquels on s'englue. La diplomatie se révélant truquée, que reste-t-il ? La force. Il y perd ? Il le sait. Mais Archinard y perd aussi. Toute la savante stratégie grâce à laquelle il espérait, avec un minimum de pression militaire, obtenir la « pacification », s'écroule. Il essaie de renouer avec l'almami ; n'ayant pu circonvenir son envoyé, il dépêche un ambassadeur à Bissandougou. Il vante les bienfaits de l'amitié française. Samori renvoie l'ambassade. La guerre va-t-elle éclater ? Pas encore : Archinard sait qu'avec un empire en miettes, Samori ne peut rien risquer. Lui-même admet que son effectif est trop faible. Aussi, malgré le désir commun d'affrontement, s'établit-il une sorte d'armistice. Bien que fréquemment au bord de la rupture, il va, grâce aux précautions prises par l'almami, durer près de deux ans.
Mais il est un personnage essentiel que nous avons négligé depuis que Samori a quitté le Kénédougou. Qu'est devenu Tiéba, faama de Sikasso ?
Au moment de la retraite précipitée de l'almami, une question pouvait se poser : pourquoi Tiéba, ayant des troupes relativement intactes, n'avait-il pas poursuivi Samori ? Pourquoi n'avait-il pas profité de son avantage ? En fait, lui aussi a souffert. Et puis, ce chef prestigieux possède une dangereuse tare dont nous avons déjà constaté les effets : il est prudent et ne s'aventure pas. Il lui paraît plus important de consolider son pouvoir à Sikasso que de courir l'aventure derrière un ennemi qu'il estime avoir fui.
Alors qu'il pourrait prendre l'offensive, c'est Samori qui, avec des troupes divisées, à bout de force, fait preuve une fois encore d'audace. Dès qu'il peut distraire une colonne, il l'envoie contre le Kénédougou. Bien sûr, l'attaque est limitée, pourtant elle efface l'idée laissée par la retraite. « Attaque défensive » serait le terme la qualifiant le mieux. Tiéba ne peut évidemment admettre ce nouveau viol de ses terres. Il riposte. Non seulement il repousse les sofas , mais il envahit à son tour leur domaine. Les tronçons de l'armée samorienne multiplient leurs actions, pour colmater les brèches tandis que la guerre fait toujours rage à l'intérieur. Plusieurs percées ne peuvent être évitées.
La voie paraît ouverte jusqu'au cúur de l'empire… ou tout au moins le paraîtrait pour un faama plus imprudent. Faut-il poursuivre ? Attaquer et attaquer encore ? Tiéba ne le fait pas. L'analyse prouve qu'il eut sans doute raison, mais qui peut l'affirmer ? Quoi qu'il en soit, affaibli par la maladie, il se retire.
Une autre interprétation, peut-être un peu prématurée, voudrait que Tiéba ait pris conscience, dès l'hivernage 1889, du jeu auquel on le forçait. N'était-il pas, tout comme son ennemi, un pion que les Français tentaient de manoeuvrer ? La guerre entre Soudanais ne constituait-elle pas un suicide ? Cette hypothèse s'accorde mal avec l'attitude ambiguë de Tiéba. Cependant un fait peut être constaté ; malgré la méfiance qui les oppose, les deux rivaux essayèrent à partir de cette époque d'éviter les grands affrontements.
Voici donc, vers la fin de 1889, les deux principaux adversaires de Samori devenus, tout au moins provisoirement, passifs. Reste encore le troisième : l'empire toucouleur. Au cours des derniers mois, plusieurs engagements ont eu lieu à proximité du Niger ; cependant, nous l'avons vu, le frère d'Amadou, excédé par les attaques françaises, a fait un premier pas vers l'almami.
Encerclé par Archinard qui lui promettait une alliance inégale, Agibou avait réfléchi. Il semble avoir compris le premier ce que peu de ses voisins pressentent : une seule chance de survie existe encore pour les peuples du Soudan, s'unir contre l'envahisseur. Agibou envoie une lettre en ce sens à son frère Amadou. On ne sait s'il transmet le même message à Samori. Ce dernier écrit à son tour au maître de Ségou et Ségou lui envoie à quelque temps de là une ambassade. S'agit-il d'union sacrée ? Pas encore, mais sans doute d'une sorte de pacte, d'un compromis dont on peut attendre beaucoup.
Hélas ! Archinard l'apprend. Cette « collusion », qu'il révèle à ses chefs, lui parait un excellent prétexte. Il entre à Ségou, dont il préparait la prise depuis plus d'un an, le 6 avril 1890, et coupe tout contact direct entre ses adversaires. Isolés l'un de l'autre, Amadou et Samori ne parviendront jamais à concrétiser leur union.
Cependant, libéré pour un temps des menaces étrangères, Samori peut se consacrer à l'ennemi de l'intérieur. Bien qu'il ait déjà réduit les oppositions les plus dures, c'est seulement à la fin de l'hivernage 1889 qu'il lance toutes ses forces pour réduire de façon définitive les derniers rebelles. L'écrasement des tribus, que la peur de se rendre plus que le courage oblige à demeurer hostiles, sera relativement rapide — tout est pratiquement terminé en avril 1890 —, mais les pertes humaines et matérielles sont lourdes.
Si les frontières de 1888 ont été à peu près recouvrées, l'ensemble du pays a souffert : les terres sont en friche ; beaucoup d'hommes ont fui, beaucoup d'autres sont morts. Il faut tout reconstruire. Parallèlement, Samori a dû affronter une nouvelle crise familiale. Bien que paraissant après coup dérisoire, elle semble l'avoir affecté profondément.
En effet, le désastre de 1888 a rendu Samori conscient de deux choses : diffuser l'Islam par la force est dangereux. D'autre part, tout ce qu'il a construit peut disparaître : la nouvelle de son décès n'a-t-elle pas été le ferment de la Grande Révolte ?
Nous avons vu comment il résolut le premier problème en gommant tout fanatisme de ses instructions. Il s'attaque sans tarder au second. L'important lui paraît de désigner de son vivant un héritier. Le préféré, nous l'avons dit, a été pendant longtemps Dyaulé-Karamogho. Mais depuis son retour de France, celui-ci a déçu son père. Samori décèle en lui une admiration peu orthodoxe pour les moeurs et la puissance de l'étranger. Aussi, après le siège de Sikasso, se tourne-t-il vers l'aîné de ses enfants, Managbé-Mamadi, qui a su se montrer un excellent second et a réussi, après la retraite, à contenir les hommes de Tiéba. Il exécute convenablement les ordres qu'on lui donne.
Vu son rang et ses récents exploits, Managbé-Mamadi croit sa fortune faite. Pourtant Samori hésite. En fait, ses premiers enfants n'ont pas été formés selon son coeur. Il est plus sûr de la fidélité de ses bilakoro que de celle de ses fils élevés en petits dioula. Il hésite, il soupèse. Enfin, il se décide : le trône ne reviendra à aucun d'eux. Celui qu'il choisit n'est pas encore un adolescent, mais Sarankényi-Mori est le fils de la bien-aimée, de l'intelligente, de la favorite… Quelle mère pourrait transmettre plus de valeur à un fils ? Sa jeunesse paraît encore un argument supplémentaire: Samori espère le modeler, lui inculquer des qualités de chef, de militaire et de savant. Aussi choisit-il ce petit garçon : lui seul est jugé digne de poursuivre l'action de son père.
On comprend la fureur des frères aînés. Si Dyaulé-Karamogho parvient à cacher sa rancoeur — il connaît depuis trop longtemps la défiance où le tient Samori —, Managbé-Mamadi ne se montre pas aussi sage. Kélétigui de la région de l'est, il croit tenir entre ses mains l'essentiel des forces de son père. La décision de l'almami lui paraît une faiblesse d'homme âgé, victoire d'une intrigante sur un trop vieux mari. Comment peut-on préférer à un guerrier couvert de gloire un enfant qui perd encore ses dents ? Managbé-Mamadi proclame son indépendance. Prenant le titre de faama, il se laisse griser par ses courtisans enthousiastes et par le chant de ses griots. Ceux-ci appellent Samori « le semeur au mains blanches ». Ils inventent des airs séditieux ; l'un d'entre eux s'intitule « Frappe-le fort » (celui qu'il faut frapper est évidemment Samori). Ils prédisent le jour où Sarankényi-Konate, l'orgueilleuse, deviendra la captive obéissante de Mamadi.
Malheureusement pour lui, le lionceau n'a pas assez de griffes. Ses alliés potentiels prennent peur et se rétractent. Un matin, il se réveille abandonné de tous, excepté de quelques captifs et de sa garde. Il devra aller mendier le pardon de son père jusqu'à Bissandougou.
Samori se laisse longuement supplier. Pourtant, il accorde au rebelle la vie sauve. Managbé-Mamadi sera condamné à dix ans de fer, que d'ailleurs il n'effectuera pas. Mais cette alerte a été salutaire pour l'almami. A partir de cette date, il s'emploiera à faire de Sarankényi-Mori son héritier incontesté.
En fait, dès 1890, Samori peut estimer que les convulsions de 1888 ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Non seulement l'empire est de nouveau soumis, mais il vient de pallier son ultime faiblesse, le défaut d'armements modernes. C'est en effet à cette époque que les manufactures d'armes du village forgeron de Téré commencent à produire leurs premiers fusils. Maintenant ce ne sont plus des armes pesantes et sans portée que ses artisans fabriquent, mais des armes à répétition bien plus légères, copiées sur les modèles européens.
Même si l'alliance des Britanniques demeure toujours aussi tiède, Samori, de sa capitale de Bissandougou, peut sans angoisse attendre l'agression très prévisible des Français.
Dès cette époque le conquérant paraît entrevoir les luttes d'influence auxquelles se livrent les Européens. Bien qu'il pense qu'ayant rompu le traité de Nyaro avec la France, celui de Bissandougou demeure valable, il tente de resserrer les liens qui l'attachent aux Anglais. Un de ses premiers objectifs après la Grande Révolte a été de rouvrir les routes de la Sierra Leone. Il a confié la tâche à un kélétigui jugé fidèle et efficace, Bilali, qui accomplit admirablement sa mission. Il pacifie une fois encore les terres séparant Bissandougou de la côte. Son succès est assez rapide pour que les Britanniques de Freetown s'en inquiètent.
Le gouverneur envoie un commissaire, Garrett, dans le dessein de sonder les intentions de l'almami. La mission de Garrett se déroule en milieu favorable ; non seulement elle reçoit l'assurance que Samori ne fera rien contre les Anglais, mais l'accueil est fraternel. Que l'Angleterre se rassure : Samori lui réserve l'intégralité de son commerce. De plus, il accepte volontiers, tout au moins dans le principe, la protection offerte par la reine. Garrett, accompagné d'une importante délégation de sofas , revient en triomphateur à Freetown.
Le gouverneur, ravi des points qu'il a marqués contre la France, s'empresse de transmettre à Londres d'aussi beaux résultats : sans verser une goutte de sang et grâce à sa diplomatie, ne vient-il pas de retourner la situation des Européens au Soudan ?
Cette satisfaction dure peu. En effet, tout là-bas, dans la froide Europe, se tient en juillet 1890 la conférence de Bruxelles. Celle-ci ne cache pas ses buts : il en fut rarement d'aussi humanitaires. Que désire-t-on ? Dénoncer et supprimer les dernières séquelles de l'esclavage, proclamer la paix universelle. Oui, mais voilà, pour ce faire, il convient de réprimer non seulement la traite des hommes mais aussi la traite des fusils. Des commentateurs « malveillants » ont voulu voir dans ces décisions altruistes une manière de favoriser avec bonne conscience la colonisation. Car, il faut bien l'admettre, ces armes dont on refuse vertueusement la vente, à qui les vend-on ? A l'Afrique. Et contre qui le plus souvent les vend-on ?
Quoi qu'il en soit, l'acte signé le 7 juillet à Bruxelles pèse lourd dans la réponse reçue de Londres. De plus, les traités précédents, conclus avec la France, ne doivent-ils pas être respectés ? Si l'Angleterre se montre agressive en Afrique de l'Ouest, ne va-t-elle pas sentir à son tour l'agressivité française dans d'autres régions où il importe qu'elle demeure implantée ?
Ainsi planent, au-delà de l'immédiat, les décisions diplomatiques. Aussi n'est-ce pas une vibrante approbation mais au contraire des conseils de saine prudence que reçoit le gouverneur. Ses ambitions douloureusement déçues, il perçoit un autre problème difficile : la suite de ses relations avec Samori. Comment lui expliquer qu'il ne doit plus compter sur les fusils anglais ?
En fait, les pressions commerciales vont suspendre l'exécution des accords de Bruxelles. Ce n'est que le 3 mai 1892 qu'il faudra renoncer à tergiverser. Mais les décevantes instructions de Londres ferment bien avant tout espoir d'exploiter les résultats obtenus par Garrett.
Samori peut compter pour quelque temps sur l'armement anglais. Il ne peut rien espérer de plus alors que la pression française s'exerce non seulement le long du Niger, mais également à partir d'une nouvelle colonie rentable et prospère que la métropole a créée sur le littoral de Guinée.
Non, au moment du grand affrontement, Samori ne pourra compter que sur lui-même.
Or l'affrontement approche. En effet, la conjoncture politique vient de changer en France. Alors que jusqu'à présent les conquérants du Soudan devaient maquiller leur action, la justifier vis-à-vis de ministres méfiants, l'idée d'impérialisme colonial fait son chemin. Ce n'est pas seulement en Afrique mais à Paris que l'on rêve de vastes possessions françaises unissant les colonies du golfe de Guinée au lac Tchad, voire au très lointain Congo. Les querelles ne portent plus sur la nécessité de cet empire mais sur les moyens de réussir à le créer (il faut évidemment négliger les oppositions pacifistes que l'on ignore soigneusement). Pour les uns, la persuasion et la pénétration économique paraissent le chemin le plus sûr ; pour les autres le seul langage que comprennent les sauvages d'Afrique est celui de la poudre.
C'est en tenant compte de ce contexte dynamique, qu'Archinard, ayant réussi à faire tripler ses effectifs, a osé investir Ségou. Bien sûr, cette initiative provoque des réactions — elle suscite même une grève, la première en Afrique, des musulmans employés à la construction du chemin de fer Océan-Niger. Mais lorsqu'en juillet 1890, Archinard, miné par les fièvres, regagne la France où il compte se reposer un an ou deux, les résultats peuvent le satisfaire : l'empire toucouleur paraît démantelé, les Bambara définitivement ralliés.
Dès que le lieutenant-colonel (il vient enfin de recevoir ce grade) aura recouvré la santé, il ne lui restera qu'à cisailler les dernières broussailles, démettre ou soumettre les derniers opposants et en particulier ce trublion de Samori. La subtile diplomatie française, une aide militaire largement distribuée, permettent de parler d'alliance fraternelle avec Tiéba. Tout est donc pour le mieux.
Effectivement, les semaines qui précèdent et suivent le départ d'Archinard confirment cet optimisme : sur la frontière qui sépare les possessions françaises et samoriennes, on n'enregistre que quelques incidents déplorables mais bénins ; Tiéba se montre disposé à poursuivre une idylle malgré tout assez suspecte : la France ne vient-elle pas de lui permettre d'assurer puis d'agrandir son empire vers le nord ? On peut évidemment regretter que les Toucouleur, refusant de disparaître, s'arment fébrilement et se regroupent au Massina, que les Bambara ne se montrent pas totalement fidèles. Mais à côté de ces bavures, il faut mentionner une excellente nouvelle : Paris dégage en partie le Soudan de la tutelle sénégalaise.
Tout cela semble positif à Archinard. Aussi, renonçant à ses idées de repos, accepte-t-il, moins d'un mois après son retour en France, une nouvelle mission. Mission en principe de courte durée : il s'agit de nettoyer le terrain conquis, d'en finir avec les Toucouleur, en un mot d'aplanir les obstacles pour que son successeur puisse ouvrir vers le Tchad la campagne projetée. Le lieutenant-colonel Humbert, qui déjà assurait l'intérim, poursuivra les opérations.
Une fois de plus, il semble que les idées d'Archinard divergent notablement des instructions qu'il a reçues. L'écrasement définitif des Toucouleur lui paraît une opération routinière et sans gloire. Ce qu'il souhaite, c'est attacher son nom à la perte de Samori.
Une déception l'attend. Amadou, malgré sa défaite, semble déterminé à résister jusqu'à la mort. Les Bambara, dont l'alliance devenait ambiguë, ont pris parti : eux aussi sont entrés en révolte. Tous ces ennuyeux problèmes font perdre à Archinard beaucoup de temps. S'il prend Nioro, dernier haut lieu des Toucouleur, il n'a pas le loisir de préparer de façon diplomatique l'attaque qu'il projette contre l'almami. En effet, malgré le nouvel impérialisme de la France, il pourrait être difficile de faire admettre que, pour ouvrir la voie du lac Tchad, donc de l'est, il importe d'attaquer en priorité au sud-ouest. Il faut trouver des raisons. L'argument, un peu spécieux, d'Archinard repose sur trois points :
Cette dernière raison est sans conteste la plus valable. Il semble néanmoins qu'Archinard ait sous-estimé l'adversaire. Il refuse de croire que Samori soit venu, en si peu de temps, à bout de la Grande Révolte. Il estime qu'il n'a pu en pallier les effets. Pour les Français, l'almami est encore aux abois. Les tribus matées, de façon provisoire, attendent l'occasion de se soulever de nouveau. Il suffit d'attaquer pour que l'empire, colmaté en façade, s'effondre au bout de quelques jours.
Mais tous ces raisonnements ne seront développés qu'a posteriori. Archinard craint trop un veto définitif pour solliciter une autorisation préalable. En mars 1891, venant de Nioro, il remonte la rive gauche du Niger. Le 2 avril, il pénètre dans la zone contrôlée par Samori. Celui-ci, vu la proximité de l'hivernage, n'attendait pas cette agression à laquelle, conscient de la suprématie française, il n'oppose pas de résistance. Il se contente de faire le vide devant l'envahisseur que ses cavaliers surveillent. Quand il comprend quel est son but, il ordonne l'évacuation et la destruction de Kankan.
La ville sainte est en effet la première étape que s'est désignée Archinard. Mais puisque l'adversaire refuse la bataille, pourquoi ne pas pousser plus loin ? Bissandougou, la capitale de Samori, n'est-elle pas toute proche ? Terrassé par la maladie, il y envoie un détachement. Cette fois, l'almami ne peut admettre cette audace. Des accrochages ont lieu. Hélas, malgré leur courage, les sofas doivent s'avouer vaincus. Le 9 avril, les Français pénètrent dans Bissandougou. Ils n'y resteront que le temps de brûler le village, s'acharnant sur la résidence que vient de quitter Samori. Le 11, heureux d'avoir montré leur force, ils sont de retour à Kankan.
Archinard a décidé d'établir, tout au moins pour l'hivernage, des troupes dans la ville, symbole de sa victoire et base de futures et prestigieuses campagnes. Aussi y laisse-t-il un résident et s'emploie-t-il — ce qui se révèle difficile — à organiser des colonnes de ravitaillement. Car Samori entoure la cité des dioula. Il la cerne. Il harcèle les colonnes qui font le lien entre elle et les places fortes françaises du Niger.
Bientôt, le ravitaillement de la ville, à demi-assiégée, devient d'autant plus insuffisant que les Européens, refusant de régner sur une cité morte, favorisent le retour de la population. Quand en mai Archinard quittera Kankan, elle abritera 4 000 personnes, bivouaquant parmi les ruines. Comment nourrir cette foule attirée par les promesses qu'il faudra bien tenir, du moins partiellement ?
L'imprudente incursion française pourrait paraître un des aléas de la guerre, infiniment moins grave que ne l'a été la levée du siège de Sikasso et surtout la « Guerre du refus ». Pourtant, l'almami semble comprendre que l'irréversible vient d'être accompli. Ce que nul n'avait osé depuis près de vingt ans, l'incursion dans le cúur de ses terres, vient d'avoir lieu. Qu'il s'agisse d'une expédition de quelques heures, que l'ennemi ait admis de lui-même qu'il ne pouvait se maintenir, importe peu. Le fait existe: les Français sont entrés dans Bissandougou. Ils ont violé le sol inviolable, les flammes ont consumé les poutres et la paille d'une demeure où l'on n'entrait qu'en frémissant.
Et voilà qu'est prise une série de mesures extrêmes :
Le 16 août 1891 — le nouvel an des musulmans — Samori rassemble tous les notables. Kélétigui et chefs traditionnels se voient invités à renouveler leur serment — ces derniers ont bu le dégé mais cela ne suffit plus. Il faut qu'ils jurent de demeurer fidèles. Il n'y a pas de désertion. Chacun ressent l'agression française dans son cúur.
Mais il ne s'agit pas seulement de promesses. Samori exige des actes. L'obéissance est douloureuse : toutes les récoltes sont saisies et groupées dans des greniers gardés par les sofas : aucun de nos grains ne sera dilapidé, aucune de nos richesses ne tombera par négligence dans les mains de l'envahisseur. L'or est réquisitionné, le cuivre collecté et fondu pour fabriquer des douilles.
Pourtant, cela n'est que contrainte assez normale en temps de guerre. Le dernier ordre, qui pourrait l'accepter ? Les terres que les Français risquent d'occuper seront brûlées. Les habitants déportés. Leurs villages, parce qu'il le faut, seront livrés aux flammes.
Telle est la décision. Et il ne s'agit pas d'une zone sacrifiée comme celles que l'on recouvre de barbelés à notre époque. Non, la zone morte doit former une étendue infranchissable : elle atteindra jusqu'à 100 kilomètres. Le but ? Que les tirailleurs meurent de faim et de soif. Ce n'est pas dans une forteresse aux murs de pierres mais dans la cendre que décide de s'enclore Samori.
Pour qui connaît l'attachement quasi religieux que le paysan porte à sa terre, peut-il y avoir de sacrifice plus déchirant ? Chaque jour se renouvellent les mêmes scènes d'hommes et de femmes s'accrochant à leurs maisons, refusant d'abandonner leurs cimetières. Les sofas ont des ordres. Ils les exécutent. Ils pourchassent les récalcitrants, empoisonnent les puits ; ils éventrent les derniers greniers.
Les déportés — on les compte par dizaines de mille se retrouvèrent sans ressources, campant comme ils pouvaient, s'organisant entre eux. Il était souvent difficile, voire impossible, de les nourrir. En quelques semaines, la fièvre en tua beaucoup.
Inhumaine, une telle décision ? Certes. Mais qui pourrait admettre qu'elle ait été prise de gaieté de cúur ? Au-delà de la souffrance, impossible à mésestimer, elle est symbole d'un autre drame : Samori vient d'admettre que la faim, la fatigue et la soif sont des barrières plus efficaces que son armée. Pour la première fois, il fait moins confiance au courage de ses hommes qu'à la nature qui s'impose aux hommes
La tactique semble réussir. Du moins provisoirement. Les Français, ne pouvant comprendre une décision si radicale, hésitent devant ces étendues où tout, jusqu'au sol, est devenu noir.
Pendant l'hivernage 1891, les adversaires demeurent sur le qui-vive, préparant dans l'inquiétude la campagne qui va s'ouvrir. Ils testent leur résistance au cours de brefs accrochages. Chacun tente de consolider des positions qu'il sait fragiles.
Le bilan, lorsque revient la saison sèche ? Les Français se maintiennent dans Kankan mais ils en ont payé le prix. Bilali a su conserver toutes ses positions de l'ouest : la route de Freetown demeure encore ouverte et n'est pas menacée. Partout, le long des frontières, après quelques révoltes désespérées, s'étendent les zones mortes, l'amoncellement informe de villages dont les murs se sont effondrés dans la boue.
Cependant, les acquis français paraissent bien décevants à Archinard. Lui qui escomptait retourner à Paris et déclarer que « Samori n'est plus » vient d'allumer le foyer de guerre le plus vaste et le plus sanglant qu'ait connu dans l'ouest la colonisation. Lui qui prétendait qu'il était moins coûteux d'attaquer, malgré les ordres, vient de lancer son pays dans une aventure dont la charge devient de plus en plus lourde. Il aura beau proclamer avec assurance « qu'il laisse un pays calme en dehors de quelques difficultés avec Samori », c'est en fait un très difficile héritage qu'il abandonne à son successeur. Il en est bien conscient. Aussi essaie-t-il, avant son départ, d'opposer un deuxième front à l'almami. Le Kénédougou panse encore ses blessures, il doit être très facile d'exciter son ardeur. Nous l'avons dit, Tiéba paraît alors un bon interlocuteur pour la France : n'a-t-il pas plusieurs fois accepté son alliance et sollicité son appui ? Il doit être possible de transformer ces Sénoufo en champions de la juste cause !
Mais, l'homme choisi pour réveiller l'esprit combatif du Kénédougou, le lieutenant Marchand, qui plus tard deviendra célèbre, se montre dans les circonstances actuelles d'une maladresse de jeune chien. Alors que le dernier messager français avait su par son habileté courtoise conquérir les bonnes grâces du faama, Marchand croit évoluer en pays conquis : il tranche, il ordonne, il se fâche ! N'osant montrer trop ouvertement son courroux, Tiéba l'amuse par des promesses vagues. En fait, il se moque de lui.
Marchand écrit-il qu'une colonne va marcher contre l'almami ? Voici que curieusement la colonne se disperse. Elle se trompe d'objectif, elle attaque les Sénoufo du sud, non pas les samoriens. Quand elle revient de son erreur et s'en excuse, voilà que des difficultés inattendues se multiplient : il parait soudain impossible de franchir les marécages, l'armée est prise de langueur ; elle éprouve un besoin si aigu de repos qu'elle rentre dans la capitale…
Tiéba semble jouer des Français comme les Français ont voulu jouer de lui. S'il conserve la plus exquise politesse, se montre désolé des retards et des imprévus, réprime ceux qui ont désobéi de façon si regrettable, au bout de quelques mois, il faut bien que Marchand l'admette : jamais il n'obtiendra du faama son engagement contre Samori.
Quand Péroz, négociateur beaucoup plus subtil, viendra à la rescousse, il ne pourra que constater une vérité qu'on ne conteste plus :
« On ne peut compter sur lui [Tiéba] pour étendre notre influence. Il nous créera plutôt des embarras et nous forcera à le supprimer. Il le pressent et se fortifie dans Sikasso contre nous. Il nous hait, nous supporte mais ne veut pas nous aider, même contre ses ennemis. »
Tels sont les résultats décevants des efforts de séduction française sur le Kénédougou. La tentative de faire ouvrir un nouveau front sur le flanc est de l'almami se soldait par un échec d'autant plus irritant que plusieurs mois avaient été perdus.
Et voilà qu'avec la saison sèche s'ouvre une nouvelle campagne. Archinard étant rentré en France sans espoir de retour, son successeur, Humbert, analyse la situation : il dénonce l'attaque prématurée de Kankan : à quoi a-t-elle servi ? A rien sinon à « éveiller le fauve » (il semble que Humbert, en escomptant beaucoup de gloire, projetait d'attaquer le premier Samori). Pour lui, un seul avantage : il n'a plus à se justifier. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne sous-estime pas l'adversaire mais parait décidé à tout mettre en oeuvre pour en finir.
Malgré les épidémies de fièvre jaune qui déciment les troupeaux, il entre en campagne. Le 6 janvier, il parvient à Kankan ; le 12, il pénètre dans Bissandougou. En dépit de leur courage, les sofas n'ont pu empêcher cette seconde intrusion dans les ruines de leur capitale. Humbert est vainqueur. Cependant il s'étonne: moins de l'héroïsme de l'adversaire que du nombre d'armes automatiques qu'on lui oppose. Il s'inquiète : les régions dans lesquelles il pénètre paraissent dépourvues de vivres. Il attend vainement les ralliements prédits par ses espions. Tout cela vaut qu'on s'y arrête. Aussi Humbert établit-il, pour faire le point, son camp à Bissandougou.
Samori, non loin de là, l'observe. Il espère que l'ennemi n'osera pas poursuivre. Effectivement, Humbert semble hésiter ; pourtant, le 22 janvier, avec une formation légère, il se lance sur les pistes du haut Konyan où l'attend une heureuse surprise : dans cette région qui est viscéralement la sienne, Samori a trop tardé à appliquer sa politique de la terre brûlée : les villages sont détruits mais trop tard. Les Français y trouvent en nombre suffisant des greniers bien garnis.
Ils avancent malgré les troupes qui les harcèlent. Ils parviennent à Kerwané que Samori espérait fortifier dans l'hypothèse d'un repli. Vont-ils aller plus loin ? L'almami ne le pense pas. Il campe avec ses provisions et ses réserves non loin de là, à Tininkourou. Ce lieu, isolé au sommet des montagnes, étant difficilement accessible, Samori y a entreposé des munitions. Hélas ! Humbert l'apprend. Kerwané conquise, il se lance à l'attaque. Il investit la forteresse et conquiert un butin que les sofas n'ont eu le temps ni d'emporter ni de détruire.
Voilà donc les Français au cúur de l'empire. Cependant Humbert n'est pas satisfait. Les terres qu'il a conquises sont exsangues, encombrées de réfugiés qu'il est dans l'impossibilité de nourrir. Pour la première fois, un empire africain ne s'est pas effondré lorsque l'a décidé l'Europe. Pessimiste par nature, Humbert estime avoir échoué. Il l'écrit, rejetant la faute sur les imprudences de son prédécesseur.
En fait, le coup qu'il vient de porter à Samori n'est pas uniquement militaire. L'almami en est maintenant persuadé : malgré son génie et le courage de ses hommes, il lui est impossible de résister de front. La terre brûlée n'a fait que retarder l'avance des « oreilles rouges ». A quoi bon martyriser le peuple ! La lutte menée dans le haut Konyan n'est qu'un combat désespéré. Les régions que l'on ensanglante aujourd'hui seront demain occupées par la France : aucun kélétigui n'y pourra rien.
Un autre essaierait peut-être de se leurrer. Samori accepte l'évidence : le courage et la valeur humaine sont insuffisants contre une technique qu'il ne maîtrise pas. Alors, il décide de partir. Ne s'est-il pas replié bien des fois ? Il faut découvrir un endroit où les Blancs cesseront de le poursuivre. Ce faisant, il renouvelle la tactique qu'il employa naguère devant les Sissé envahissant le bas Konyan : laisser à l'ennemi le terrain qu'il convoite, lui donner le temps de s'endormir ; reconstituer ses propres forces ; l'attaquer de nouveau. Comment admettrait-il que l'ambition de ces colonisateurs n'a pas de frein ? Où aller ? Il choisit la direction de l'orient, celle de La Mecque comme il le précisera plus tard. En fait, choisit-il vraiment ? Le nord est barré par l'avance française ; l'ouest, à l'accès devenu difficile, est borné par les possessions anglaises et libériennes. Quant au sud, on connaît les préventions de Samori contre les régions de forêt. L'est demeure la seule voie encore ouverte. Nous verrons, par les difficultés de l'exode, qu'il s'agit bien d'un pis-aller.
Sa décision n'empêchera pas l'almami de harceler les Français pendant une grande partie de 1892. Les garnisons du haut Milo essuyèrent de sanglantes défaites. Kankan et Bissandougou furent sur le point d'être encerclées et les routes de Freetown demeurèrent ouvertes. Cependant, ces victoires ponctuelles s'apparentent davantage à la guérilla qu'à la guerre. Pour la première fois depuis la reprise en main de 1888, on constate de notables désertions.
En effet, ce ne sont pas seulement les guerriers mais les artisans, surtout ceux qui forgent les armes, les cultivateurs, sans lesquels on ne mange plus, et l'immense troupe des enfants et des femmes que Samori a décidé d'emmener avec lui. Or, ces populations répugnent à quitter leurs terres. Leur méfiance se justifie d'autant mieux que les contrées où on les déporte leur sont étrangères. C'est un blanc-seing pour l'inconnu qu'après tant de souffrances déjà accumulées vient d'exiger le chef. Aussi, quand ils ne peuvent convaincre, les kélétigui doivent-ils contraindre. Il leur faut plusieurs fois combattre… Certains préfèrent la présence française à l'exil.
Un seul point paraît alors positif : Tiéba, ayant connaissance de l'exode, refuse de prendre part à la curée. Il serait le seul à pouvoir valablement le faire : les Toucouleur, réfugiés avec Amadou au Massina, parviennent difficilement à sauvegarder les débris de l'empire. Les Bambara, qui avaient tenté de secouer le joug de la France, ont été matés autour de Ségou.
Paris, lorsque Humbert y revient dépité, est peut-être seul à ne pas concevoir qu'il vient d'obtenir une victoire considérable.
Humbert, déçu, étant décidé à ne plus retourner au Soudan, la France désigne un nouveau responsable. Les coteries s'affrontent. Ce n'est pas le secrétaire d'Etat aux Colonies mais le chef de l'Etat lui-même qui découvre l'homme providentiel. De qui s'agit-il ? D'une vieille connaissance : Archinard devenu colonel. On peut s'étonner qu'après les protestations réitérées — et légitimes — de Humbert sur l'imprudence de son prédécesseur, qu'après les multiples désobéissances dont Archinard ne se cache plus, le choix se soit porté sur lui.
Mais il faut bien l'admettre : le colonel quitte la France avec des pouvoirs étendus (le Soudan étant détaché du Sénégal de façon définitive) et, une fois de plus, des consignes précises de modération qu'il ne suivra pas : s'il a mission d'éteindre les foyers de guerre — que lui-même a jadis allumés —, par contre, il doit renoncer à toute nouvelle conquête, la France étant alors préoccupée par sa campagne contre Béhanzin. Donc, une fois encore, Archinard écoute avec beaucoup de politesse les injonctions parisiennes et les oublie. Sur le plan militaire, il dispose d'un nouvel atout : pour la première fois, la légion étrangère, cette formation de mercenaires dont on peut attendre beaucoup, est lancée contre le Soudan. Un point noir cependant : un commandement militaire séparé du commandement suprême ayant été créé, c'est par officiers interposés qu'Archinard devra mener les campagnes qu'il projette. Celles-ci ont un double but : en finir avec Samori — on connaît l'antienne —, supprimer les dernières velléités de résistance des fils d'El Hadj Omar — Amadou réfugié au Massina refusant encore la défaite.
Seule la seconde de ces actions sera menée à bien. Si les troupes d'Archinard ne peuvent monter jusqu'à Tombouctou, elles auront en avril 1893 démantelé les restes de l'empire toucouleur. La flotte française basée à Mopti patrouille loin sur le Niger. Amadou, malgré son courage, n'est plus qu'un souverain errant.
La lutte contre Samori est beaucoup plus difficile. Le but d'Archinard, en frappant vite et fort, est d'empêcher l'exode vers l'est qu'en cette saison sèche 1892-1893 l'almami précipite, et de lui couper définitivement la route de Freetown. Pour ce faire, le gouverneur dispose d'environ 2.200 hommes, dont la fameuse légion étrangère ; le commandement en est confié à Combes, que ses campagnes en Indochine ont aguerri.
Malheureusement, pour remporter de brillantes victoires, il faut rencontrer l'ennemi. Or celui-ci est insaisissable. Les renseignements que les Français recueillent se révèlent inexacts. Où trouver Samori au milieu des 700 kilomètres de zones mortes qui forment la frontière ? Il n'est jamais là où on le cherche. Quand sa présence se révèle par des attaques inattendues, il disparaît immédiatement, bien conscient que ce harcèlement est moins vital que la préparation de son départ.
Bilali, qui défend la route de la Sierra Leone, disparaît également quand on croit le cerner, pour reparaître ailleurs. Cette lutte contre l'invisible exaspère le commandement français. Il faudra attendre le 12 avril 1893 pour qu'ait lieu une bataille véritable. Encore l'initiative en est-elle prise par Samori.
A l'entrée de l'hivernage 1893, les résultats consignés par Archinard et Combes se rapprochent étrangement de ceux que déplorait Humbert : les Français ont sans conteste étendu leur hégémonie. Ils se trouvent sur la frontière de la Sierra Leone où ils s'opposent accidentellement aux Anglais — sans avoir réussi le blocus. Le Kissi, le haut Milo et bien d'autres provinces sont occupés ; pourtant, si l'on excepte le Kissi, il s'agit le plus souvent d'immensités désertes. Le peu de récoltes engrangées ne peut nourrir les paysans, encore moins l'armée française et les innombrables réfugiés. BaBemba, qui règne — Tiéba vient de mourir — sur le Kénédougou, refuse de la même façon courtoise de participer à la guerre. Et surtout, de quelque façon qu'on rédige le rapport, il est impossible de prétendre que Samori a disparu.
Cependant, bien que le secret aire d'Etat aux Colonies s'élève contre « sa méconnaissance complète de l'autorité nationale » et lui enjoigne de se consacrer « à l'organisation économique et politique du Soudan », Archinard estime pouvoir compter sur l'avenir. Quand il rentre en France en juin 1893, épuisé par une fièvre bilieuse, il s'agit pour lui d'une pause inévitable dans son destin de conquérant. Que les Samori et autres Ba-Bemba indociles essaient de jouer leurs derniers atouts ! Pour le commandant en chef, le grand Soudan français allant de la mer jusqu'au Tchad est une réalité qui n'attend que sa guérison.
En fait, les choses vont se passer de façon différente. Le secrétaire d'Etat aux Colonies, Delcassé, un homme énergique, est las d'être bafoué, il refuse de supporter plus longtemps l'indépendance des militaires et leur indiscipline. Le 21 novembre 1893, un gouverneur civil, Grodet, dont on connaît l'obéissance, est nommé par Paris. Son but : organiser les terres conquises et faire régner la paix.
Il ne va pas avoir la partie facile. Tout d'abord, il se heurte à un fait accompli : le commandant de la flottille du Niger a, malgré les ordres, décidé imprudemment d'atteindre Tombouctou —, sur tous les fronts, les officiers rivalisent d'ardeur pour traquer Samori. Au nord, où les Bambara de Baulé refusant la déportation font appel au résident de Bamako, les tirailleurs surprennent les sofas qu'ils contraignent à la fuite. A l'ouest, où après de longs et difficiles combats, les Français ont coupé la route de la côte, non seulement celle de Freetown mais, plus au sud, celle de Monrovia, il faudra plusieurs mois à Grodet, contre qui s'agite la faction militaire, pour imposer ses ordres. Il fixe alors une frontière qu'il enjoint de ne pas dépasser. Les officiers sont contraints d'obéir.
La nomination de ce civil procure une chance inespérée à Samori. La trêve, dont l'espoir paraissait insensé sous l'hégémonie militaire, devient, en 1894, réalité.
Mais où en est l'almami à cette époque ? Il paraît avoir abandonné l'espoir de recouvrer dans l'immédiat ses anciennes frontières ou même de conserver ses liaisons avec la côte — celles-ci ont d'ailleurs moins d'importance, l'interdiction du commerce des armes étant provisoirement suivie d'effets. Par contre, il commence à restructurer un empire ayant d'abord pour centre la région d'Odienné.
Cet exode est une fois encore à la mesure de Samori. Car est-il commun qu'un monarque dépossédé de ses terres refuse de s'estimer vaincu ? Qu'il parte, en y contraignant son peuple, fonder un nouvel empire dans un pays dont il ne connaît presque rien ?
Mais pour ce faire, il a besoin de paix. Il envisage même d'officialiser la trêve avec la France. Il envoie un émissaire à Grodet. Il s'humilie, tout au moins en paroles, affirmant alors qu'il accepte de commander les Noirs sous les ordres du gouverneur, d'être « captif » de celui-ci.
En fait, les deux parties éprouvent l'une envers l'autre beaucoup trop de méfiance pour que ces pourparlers puissent aboutir. Après avoir sollicité la protection de Grodet, Samori exige qu'il lui rende le Konyan et d'autres territoires qu'il a perdus. Les Français subordonnent toute négociation à la venue de l'almami à Bamako. Toutes conditions qui, chacun en est conscient, sont irrecevables par l'autre. Il semble que Samori essaie de faire durer les négociations aussi longtemps qu'il peut, cette période privilégiée lui permettant de se reprendre. Aussi, à côté de décevantes tractations officielles, observe-ton une activité parallèle où des intermédiaires se montrent beaucoup plus conciliants. Quand il sent les Français au bord de la rupture, l'almami leur prouve son bon vouloir : ainsi, sans discussion, à la fin de 1894, il fait, devant Sikasso, reculer ses troupes sur la simple injonction de Grodet.
C'est qu'à cette époque l'almami doit faire face sur tous les fronts ; envahisseur et pourchassé, il doit en outre évaluer la confiance qu'il petit accorder aux siens. L'effort qu'il demande depuis des années à son peuple semble à certains insupportable. Bien des fidélités ont déjà succombé, nous l'avons vu, devant le spectre de l'exode. Mais peut-il compter inconditionnellement sur sa famille et sur ses proches ? Pas même. Nous savons que d'innombrables coteries opposent ses fils de mères différentes. Certains estiment qu'il est temps de jouer leur carte personnelle. Ils désapprouvent le rêve insensé de ce vieillard refusant la défaite contre ce qu'ils jugent être l'évidence. C'est alors que se situe la mort de Dyaulé-Karamogho.
Nous avons déjà parlé de ce fils, longtemps le préféré de Samori, relaté comment il fut choisi pour mener l'ambassade que l'almami envoya en France et comment il revint de Paris, ébloui par la magnificence déployée en son honneur.
Cette admiration, jugée trop inconditionnelle, empêcha sans doute Samori de faire de Karamogho son successeur, cependant elle ne lui fit pas retirer sa confiance : en 1888, le prince se voit chargé de la protection difficile de la vallée du Milo. En 1893-1894, c'est encore lui qui mène vigoureusement la résistance dans les territoires du sud-ouest et défend la route de la Sierra Leone.
Pourtant, malgré ces hauts faits d'armes, la France n'a pas perdu espoir de se le concilier. Elle semble avoir appris que, malgré sa loyauté et son courage, Karamogho estime la défaite inévitable. En juin 1894, le commandement français prend contact avec lui. Il lui propose de se soumettre dans des conditions très honorables. Prudent, Karamogho envoie la lettre à Samori. Toutefois, il omet de communiquer sa réponse, Celle-ci ne reflète aucune trahison mais parle d'amitié et laisse les portes ouvertes pour la poursuite de ce dialogue intéressant. Les Français saisissent l'occasion : ils envoient au jeune chef une nouvelle missive. L'attitude de Karamogho paraît les satisfaire beaucoup. L'un d'eux écrit :
« Je ne crois pas que Dyaulé-Karamogho vienne faire sa soumission pendant l'hivernage, mais je ne serais pas étonné de le voir trahir la cause de son père. »
Cependant, les combats se poursuivent. A la suite d'une cuisante défaite, Karamogho écrit une nouvelle fois aux Français. Qu'écrit-il ? La lettre s'est perdue. Par contre, Samori apprend cette correspondance. Il convoque son fils. Les amis de Karamogho, lui conseillent de fuir. Il refuse. Il se rend à la convocation de Samori. A Nyodyi, capitale provisoire, le kélétigui est reçu de façon courtoise. Ses préventions s'estompent. En fait, on termine l'enquête qu'on a entamée contre lui. Et soudain, ordre lui est donné de se présenter devant le conseil présidé par son père. L'almami, parlant de la seconde correspondance, lui demande:
— Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé cette lettre des Français ? Où est cette lettre ?
— Je l'ai détruite.
— Leur as-tu répondu ?
— Oui.
— Quoi donc ?
— Je l'ai oublié.
— Tu n'es plus un enfant. Tu as commandé à la guerre et tu ne sais pas ce que tu as répondu ? Pourquoi ne m'as tu pas averti ?
Alors Karamogho se tait. Il s'enferme dans le silence. Samori se tourne vers un de ses conseillers. Il murmure :
— Tu as dit vrai. Mon captif est mon ami et mon fils est mon ennemi.
Ensuite, s'adressant à Karamogho, il insiste :
— Réfléchis. Si tu ne me dis pas ce que tu as lu et répondu, je te châtierai…
Comme le jeune homme se tait toujours, il ordonne qu'on l'enferme dans une case dont les portes sont maçonnées.
Au vieillard qui l'accompagne et qui, plein de pitié, lui conseille d'inventer n'importe quelle excuse, Karamogho répond :
— Je ne mentirai pas à mon père. Je ne lui dirai rien. »
Le soir, Samori demande :
— A-t-il parlé ?
Le gardien de Karamogho secoue la tête. Samori répétera cette question pendant plusieurs jours. Enfin, il se rend lui-même à la prison. Il parle à son fils à travers l'ouverture juste assez large pour y glisser les aliments. Karamogho n'ouvre pas la bouche. Après cette visite, on ne lui fournit plus aucune nourriture et, selon la tradition, au bout de trois jours, il mourut. Samori dit seulement :
— Enterrez-le. C'était un mauvais fils.
Telle fut la fin de Dyaulé-Karamogho. Peut-être moins que sa trahison, Samori craignit son silence. Quelles complicités cachait-il ? Qui d'autre, parmi les proches de l'almami, parmi ses fils, parmi ses frères, partageait l'avis du kélétigui ? Qui d'autre était prêt à s'opposer à l'aventure, à clore la série de défaites qui pour beaucoup ne pouvait avoir de fin ?
Cependant, pour l'instant, c'est la trêve. Peut-être faut-il profiter de la fragilité de cette paix pour parler de la conquête de l'est.
En effet, nous l'avons dit, si Samori mène d'ultimes combats pour décrocher le plus lentement possible, s'il rassemble et déporte les hommes et les récoltes, il doit parallèlement ménager un nouveau terrain. Or l'est, on s'en doute, n'est pas vide, et ce n'est pas avec sympathie que les populations voient déferler sur elles non seulement une armée mais tout le peuple de cultivateurs et d'artisans qui la suit.
La conquête est donc délicate. S'il n'est pas de notre propos de relater l'ensemble des opérations militaires qui se déroulèrent à partir de 1892, il peut être intéressant de rechercher quelle fut, dans ses grandes lignes, la stratégie de Samori.
Jusqu'à la trêve, consécutive à l'éviction des militaires français, il semble que l'almami conserve pendant la saison sèche les meilleurs des sofas pour contenir son adversaire. C'est donc principalement pendant l'hivernage, qui retient les Blancs dans leurs forts, que les kélétigui accentuent leur poussée vers l'est.
A partir du moment où Grodet prend les commandes, la tactique de Samori se modifie : désormais, il paraît soucieux d'éviter tout contact. Il s'éloigne des zones contrôlées par la France et ses alliés. Cela n'est pas toujours facile. En effet, le grand obstacle sur la route de l'est demeure toujours le Kénédougou dont le nouveau faama, Ba-Bemba, s'est, du moins de façon formelle, allié avec l'envahisseur. Pas question de l'attaquer de front ; l'échec devant Sikasso demeure encore trop proche, mais il est inévitable que des conflits surgissent dans les zones frontalières plus ou moins inféodées à Sikasso.
Ces risques d'affrontement sont encore amplifiés par la situation personnelle de Ba-Bemba. En effet, ce n'est pas dans l'acquiescement général qu'il a succédé à son frère. Fils d'une captive, sa légitimité est contestée, de plus, les peuples récemment soumis ont profité du changement de règne pour s'émanciper. Aussi faut-il que le nouveau faama affirme son autorité, qu'il détourne le mécontentement interne et regagne les territoires perdus.
Les premiers affrontements auront lieu en 1893 et se poursuivront pendant l'année suivante. Presque partout vainqueur, Samori fait preuve d'une très grande prudence : il ordonne à ses troupes de ne pas franchir le Bagoé qu'elles atteignent une fois encore ; lui-même abandonne sans y être contraint les terres directement liées au Kénédougou. S'élevant contre les rumeurs prétendant « qu'il veut aller à Sikasso se recueillir sur la tombe de ses fils et de ses frères », il calme l'inquiétude des Français prêts à s'opposer à une hypothétique conquête.
Au début de 1895, le conflit sera terminé. Bien qu'aucune paix solennelle ne le conclue. Samori peut s'estimer vainqueur : en effet, une partie des tribus vassales ou proches du Kénédougou — parmi elles la majorité des Sénoufo du sud — lui a fait allégeance.
Cependant, l'almami tient à rendre incontestable son désir de paix. Il crée entre les deux empires une nouvelle zone morte ; Ba-Bemba paraissant admettre son impuissance, les sofas progressent vers l'est où leur implantation sera facilitée par Mori-Touré, un conquérant zarma qui, ayant subi des revers en milieu animiste, accepte sans trop de mal l'alliance de musulmans.
Mais la conquête de l'est ne présente pas seulement des aspects militaires : l'almami, on s'en souvient, se déplace avec tout un peuple. Une partie de la stratégie samorienne va donc être conçue en fonction des récoltes : ne décrocher des terres que l'on abandonne qu'après avoir moissonné les épis ; trouver des régions riches, les conquérir, réquisitionner le maximum sans pourtant réduire les producteurs à la révolte. Les réfugiés se chiffrent par centaines de mille et il faut tenir compte de la politique des zones mortes.
Toutes ces difficultés paraissent néanmoins surmontées à la fin de 1894. A cette époque, Samori a pris Kong pour objectif. Ses kélétigui en approchent. C'est alors que parvient une nouvelle si surprenante qu'elle provoque un arrêt: les Français, que l'on avait fuis en leur abandonnant le berceau de l'empire, les voici qui surgissent de nouveau. Ils remontent, venant du sud ; les tirailleurs seraient dans Kong, les populations rebelles affirment attendre leur appui.
Quelles sont donc les forces de ces troupes ? Les cisailles se referment-elles ? C'est à cette époque que l'almami cessa de lutter pour conserver ses positions de l'ouest et renonça de façon définitive à maintenir ses liens avec les comptoirs de l'océan.
Mais qui sont ces Français ou, plutôt, que veulent-ils ?
Jusqu'à présent, l'almami ne s'est guère intéressé aux lointains Européens installés sur le golfe de Guinée. Anglais ou Français, ils ne sont pour lui que des commerçants inoffensifs, bien différents des redoutables envahisseurs du Soudan.
En ce qui concerne la Côte-d'Ivoire — alors appelée Côte-d'Or —, cet avis n'est pas faux. Malgré la richesse potentielle du pays, les deux petits comptoirs d'Assinie et de Bassam, au climat jugé redoutable, sont les mal aimés de la colonisation. Plusieurs fois on a même souhaité les échanger contre l'enclave britannique de Gambie.
Sur la côte, pendant longtemps, les marchands se maintiennent comme ils peuvent. Reconnaître l'intérieur des terres ? Il n'en est pas question. Les miasmes de la forêt primaire comme l'hostilité des populations — tels les Baoulé — rendent aléatoire tout espoir de conquête.
Cependant, la conjoncture a changé. A la fin de 1884, le congrès de Berlin, limitant le partage de l'Afrique entre Européens, a stimulé les appétits. Chacun essaie de jouer ses atouts. La France se souvient qu'en dehors du Dahomey elle possède sur la côte deux bases utilisables pour accomplir son grand dessein : la jonction du Soudan avec le golfe de Guinée. Des premiers essais de liaison ont lieu dès 1887 en tentant de remonter le Comoé. En décembre 1888, un détachement commandé par Treich-Laplène parvient à gagner Kong, rejoint par Binger dans une mission qui n'aura pas de lendemain.
En réalité, c'est à partir de 1891 que seront décidées les grandes opérations vers l'intérieur. Celles-ci, échappant aux autorités locales, sont commandées directement depuis Paris. Elles sont difficiles : seul Binger parviendra à joindre Kong de nouveau.
Cette mission est la dernière effectuée à titre militaire par cet officier. En 1892, Binger démissionne. Non qu'il disparaisse de la scène : il est nommé gouverneur de la Côte-d'Or à laquelle la France paraît enfin accorder de l'importance et des crédits. Le premier acte du nouveau gouverneur sera de changer, pour le nom plus exact de Côte-d'Ivoire, l'appellation de la colonie.
Cependant, ce n'est pas avec des perspectives belliqueuses que cet ancien soldat débarque pendant l'été 1893. Il souhaite organiser et administrer les possessions du bord de mer. Se désintéressant des projets impérialistes de liaison avec le nord, il le proclame. Aussi est-ce sous les auspices directs de Paris qu'est décidée l'opération Marchand.
Ce dernier, qui, on s'en souvient, avait conduit de façon contestable sa mission au Kénédougou, a sans doute beaucoup appris. Montrant sa force mais aussi son désir de concorde, il parvient à se frayer un chemin. Il dépasse Bouaké dont il se concilie le chef, progresse encore atteint le pays sénoufo. Soudain, le 11 décembre 1893, il se heurte sur le Bandama à l'avant-garde de l'almami. Cette présence de l'ennemi devenu légendaire dans une région d'où on le croyait éloigné, inquiète le commandant français qui écrit :
« Si j'avais 400 tirailleurs, j'irais régler une fois pour toutes la question de Samori, mais je ne les ai pas et l'action néfaste du Soudan français, refoulant les bandes de Samori sur la riche Côte-d'Ivoire, va continuer. »
Quatre cents tirailleurs ? Il n'est pas question de lui accorder un supplément de forces. Marchand continue donc avec de faibles effectifs sa marche à travers le pays sénoufo qu'il décrit :
« Champs ravagés, villages détruits et encore fumants d'où s'élève une épouvantable odeur de charnier. Sous les rares arbres, quelques varioleux achevant de mourir et geignant leur dernière plainte. Les huit porteurs qui me suivaient restèrent tous sur la route, tués par la variole et par la faim. »
A la frontière du Kénédougou, où ils espèrent rencontrer Ba-Bemba, la vision d'armées désorganisées et en fuite lui fait vite comprendre qu'il n'a rien à attendre de l'alliance du faama. Il décide de se replier.
Pourtant, avant de regagner la côte, il souhaite, lui aussi, parvenir jusqu'à Kong, la vieille métropole dioula, point de jonction du sud et du nord. C'est au cours de cette opération que sa présence sera signalée à Sarankényi-Mori, qui commande une partie des armées de son père.
Marchand restera deux mois à Kong malgré une atmosphère hostile. Il y établira même un petit marché de produits manufacturés afin d'ouvrir ces régions lointaines au commerce.
Mais plus importantes paraissent les informations qu'il recueille sur les objectifs ennemis. Si Samori poursuit sa marche vers le Comoé, ne va-t-il pas couper définitivement la route du Soudan ? Ne va-t-il pas se lier avec les Anglais de la Gold Coast comme jadis avec ceux de la Sierra Leone ? Ne va-t-on pas, une fois encore, le ravitailler en fusils et munitions ?
Il importe d'arrêter au plus vite la progression de l'Africain. Marchand en est incapable et il le sait. Aussi regagne-t-il la côte après avoir laissé à Kong une petite garnison.
Son cri d'alarme rencontre un écho favorable. En effet, Monteil, considéré alors comme un des plus grands militaires coloniaux, se trouve brusquement sans emploi, un traité passé avec la Belgique rendant inutile la colonne qu'il devait mener sur le Haut-Oubangui. Il importe de ne pas laisser inutilisée une compétence aussi précieuse. On envoie les forces ainsi disponibles en Côte-d'Ivoire. La lutte contre Samori, la protection des chefferies ralliées et surtout le maintien des Anglais dans les limites de la Gold Coast vont permettre à Monteil d'exercer ses talents.
Binger apprécie peu le principe de cette expédition. Il écrit : « Marchand se trompe. Samori n'a guère progressé. La Côte-d'Ivoire n'a pas à s'inquiéter. Il ne faut pas se lancer dans une guerre problématique. »
Cet avis n'est pas écouté, la mission étant une fois encore dirigée de Paris. Et Paris ordonne à Monteil d'établir une série de forts entre la côte et Kong où se maintient toujours la modeste garnison. Ordre bien imprudent. Pour y obéir, Monteil doit abandonner au fur et à mesure qu'il progresse une partie de ses troupes dans les postes qu'il crée.
C'est donc avec des effectifs insuffisants qu'il aborde le Djimini où Samori vient d'établir, à Dabakala, sa nouvelle capitale. Sur les quelque 1.200 hommes ayant quitté Bassam, il n'en reste plus que 600, effectif dérisoire devant les troupes de l'almami. Monteil parlera de 15 000 sofas . Si l'estimation paraît exagérée, on peut avancer le nombre de 10 000.
Pourtant Monteil attaque : chasser les samoriens du Djimini est indispensable s'il veut se frayer un chemin jusqu'à Kong. Comprenant qu'il ne peut attaquer de face, il tente de contourner l'ennemi et s'aperçoit trop tard de l'imprudence. Les sofas , qui semblaient fuir devant lui, le contournent à leur tour. Monteil étant parti avec peu de vivres se voit coupé de ses arrières. Il doit lutter non seulement contre les sofas qui le harcèlent mais aussi contre la faim. Nourrir les tirailleurs devient aussi important que de vaincre l'almami. Or les troupes de celui-ci paraissent se multiplier.
La situation est-elle désespérée ? Il ne le semble pas. Une fois encore les Français parviennent à compenser par la technique l'infériorité de leur nombre. Peut-être Monteil et sa colonne pourraient-ils arriver jusqu'à Kong. Mais n'est-ce pas une opération suicidaire ? La petite garnison ne pourrait leur être d'aucun secours. Ne risque-t-on pas de l'entraîner dans un désastre ? Ne risque-t-on pas surtout de se trouver bloqué parmi des Africains qui, amis ou ennemis entre eux, sont également hostiles aux Blancs ?
Monteil essaie de négocier. Il saisit le premier prétexte pour faire connaître à l'almami quelles seraient les conditions de paix. Mais sa situation est beaucoup trop précaire. Non seulement Samori refuse quand on lui demande de se replier vers l'ouest, mais il lancera dans les jours qui suivent Sarankényi-Mori et toute sa famille vers le Comoé.
Le commandant français prend alors la seule décision qui paraisse lucide : il ordonne la retraite. Celle-ci sera particulièrement douloureuse. Monteil, la jambe brisée, doit se déplacer en hamac, cible d'autant plus facile que la colonne est alourdie par les populations, hommes, femmes et enfants, ayant à craindre les représailles de Samori. C'est avec des troupes épuisées que le commandant atteint Satama, le dernier poste qu'il a créé. Une nouvelle, peut-être encore plus pénible que la défaite, l'y attend : le nouveau ministre français des Colonies, désavouant son prédécesseur, a donné l'ordre depuis près d'un mois de dissoudre la colonne Monteil, celle qu'on appelait la « colonne de Kong », du nom de la ville qu'elle n'atteindra pas.
Satama fut évacuée le 24 mars 1895, mais ce n'est qu'après plusieurs jours, pendant lesquels les sofas enlevèrent et massacrèrent les tirailleurs, que les survivants s'échappèrent. Jamais armée française n'avait subi un tel désastre en Afrique de l'Ouest.
Quand Binger apprend ce désastre, il rappelle avec un certain plaisir qu'il avait désavoué la mission. Il obtient que Paris renonce à prendre la Côte-d'Ivoire pour base militaire. Il ne restera dans la colonie que quelques garnisons, placées sous les ordres du gouverneur et chargées de maintenir la paix. Le rêve de la liaison Soudan-océan vient-il d'être abandonné ? Les Français acceptent-ils enfin l'existence de Samori ?
Ils s'en accommodent, du moins provisoirement. D'une part leurs objectifs ne considèrent pas comme prioritaires les régions où s'est réfugié l'almami, d'autre part, la présence de celui-ci constitue une barrière contre la pénétration anglaise. Pour ces raisons, autant lui accorder une trêve. Les Français envisagent même de passer des accords et révisent l'opinion qu'ils se faisaient de lui. L'auteur d'un rapport officiel écrit à cette époque :
« Quelque pénible que soit cet aveu, ce n'est pas Samori qui a failli aux traités que de bonne foi il nous a consentis mais nous qui [ … ] n'avons point exécuté à la lettre les conventions acceptées et provoqué des rébellions qui ont amené en fin de compte le désastre de la colonne Monteil. »
Honorable examen de conscience. Même transitoire, la position française valut à Samori ce qui lui était indispensable : deux années de répit.
Ces années, Samori va les mettre à profit. Dès 1896, il aura établi un nouvel empire allant du Sassandra à la Volta Blanche. La ville la plus extrême au nord : Sankana, dans le Gonja ; la ville la plus extrême au sud : Anybilékrou, dans un territoire disputé côtoyant l'empire ashanti. Il est évident que ces terres, éloignées du berceau malinké, n'ont pas été de conquête facile. Il y eut le ralliement de Kong sur laquelle misaient les Français : sa renommée était si grande que l'almami dut traiter avec elle ; non seulement la ville n'eut pas à payer tribut, mais ce fut Samori qui s'engagea à lui fournir chaque année, à l'époque de la Tabaski, des captifs et du bétail.
Il y eut le royaume vénérable des Abrons. Celui-ci, malgré sa remarquable organisation militaire et l'espoir qu'il mettait dans l'alliance de la Gold Coast, dut capituler à son tour.
Il y eut le royaume de Bouna, chanté dans les traditions anciennes, et qui, miné par les difficultés internes et l'invasion lobi, ne put s'opposer à Samori.
Celui-ci ne s'arrêta qu'au Gourounsi, qu'il rallia pendant quelques semaines. Oui, c'est bien un nouvel empire qui se dresse devant l'hégémonie européenne.
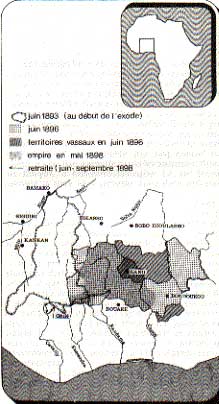
Mais quel est cet empire ? Si l'on considère uniquement ses frontières, on doit admettre qu'il a peu à envier à celui de Bissandougou. Peut-être même est-il moins vulnérable, vu l'éloignement des Français et la paix régnant avec Sikasso. En août 1896, une réconciliation officielle est intervenue entre Samori et Ba-Bemba, ce dernier ayant rompu avec la France.
En fait, les partenaires de l'almami sont moins les peuples du Soudan que ceux de la forêt. Fournisseurs d'ignames, vendeurs de colas, transitaires pour le commerce des armes qui a repris, ces peuples devront être flattés ou soumis sans mettre en danger leur existence indispensable.
Samori a-t-il reconstitué en quelques années un Etat comparable à l'ancien ? Un observateur superficiel pourrait le croire. En réalité tout est différent. Nous avons parlé de l'organisation harmonieuse du premier empire de l'almami. A cette époque, inconscient de la menace blanche, il construisait pour l'éternité au milieu de ses frères soit par la religion soit par le sang.
Maintenant la terre a tremblé. Le pasteur n'accouple plus ses génisses pour que dans quelques siècles ses arrière-petits-fils puissent connaître le goût du lait. Le marchand n'accumule pas les cauris et la poudre d'or pour créer des réseaux d'échanges qui serviront à ses enfants. L'Afrique vient d'entrer dans l'ère du transitoire. L'on vit — et Samori lui-même — au jour le jour. On survit serait un terme plus exact. On s'étonne presque de survivre encore :
« Nous vivions dans l'éternité. Et voilà que le provisoire nous a roulés dans la boue de son fleuve. Il nous a rempli la bouche de sa tourbe à la mauvaise odeur. Nos pieds sont prisonniers de la glue de son sable. Nous ne pouvons plus rien. »
Le nouvel empire est partagé entre des gouverneurs militaires qui ne jouent plus aux administrateurs. A l'ouest, Bilali, qui a si longtemps défendu la route de Freetown, à l'est, une armée encore plus puissante qui contrôle les centres d'orpaillage ; le centre, autour de Dabakala, coeur du royaume, dépend directement de Samori. Cette région peut paraître exiguë et pauvre. En fait, elle est vraiment le noyau de ce fruit. Là se trouvent en effet les villages des forgerons qui fabriquent les armes indispensables, en particulier les fusils à répétition. Là se trouve également la majorité des réfugiés, rendant vulnérable ce nouveau centre impérial, Pour les nourrir, il faut rançonner les tribus les plus proches, en particulier les riches Sénoufo, dépendance fâcheuse pour les liens de bon voisinage.
Pourtant, l'almami reste soucieux de ménager les susceptibilités locales. Alors que les structures du premier empire visaient à unifier les peuples conquis et à centraliser le pouvoir, les nouvelles acceptent les différences religieuses ou politiques. Les marabouts s'effacent. On cherche à soumettre, non plus à convertir. Samori a-t-il conscience de la fragilité de son nouveau domaine ? Dans les faits, il le semble : on ne trouve aucun essai d'assimilation. Si les animistes vaincus baissent la tête, leurs religions et leurs coutumes importent peu. L'almami colonise ou pactise, mais il n'intègre plus.
A aucun moment il ne tente de recréer l'organisation qui fit, peu d'années auparavant, de son domaine un des Etats les plus puissants et les mieux organisés de l'Afrique. Escompte-t-il encore, malgré l'évidence, revenir de son exil ? Certains faits donnent à le penser : dans ses tractations avec la France, il réclame en priorité son retour. Pourtant, il sait qu'il n'est pas encore temps. Qu'il importe avant tout que les Français l'oublient ou mieux encore qu'ils acceptent d'établir de pacifiques relations.
Sur ce plan, l'attitude de la Côte-d'Ivoire paraît très positive. En effet, sous l'impulsion de Binger, prépondérance absolue est donnée aux commerçants et ceux-ci vont jusqu'à vendre des armes à leur dangereux ennemis.
Mais tous les Français ne voient pas Samori sous l'aspect d'un client fidèle. Une mission menée par le capitaine Braulot — dont la mort à Bouna devait plus tard influer sur le destin de l'almami — essaie de lui faire accepter la présence d'un résident. Poliment éconduite, elle rentrera inquiète : Samori lui a fait visiter ses ateliers de forgerons.
Mais en cas de conflit, les armes fabriquées localement seraient-elles suffisantes ? A la fin de 1896, surgissent de nouvelles menaces contre la paix. Les Français du nord semblent considérer l'échec de la mission saint-louisienne comme une rupture définitive ; les Français du sud, craignant de heurter leurs compatriotes, évitent les contacts commerciaux trop fréquents. Kong, la grande citadelle, par où transitent les chevaux, vient d'entrer en révolte. Les Britanniques de la Gold Coast se montrent à leur tour désireux d'étendre leurs possessions. Alors qu'ils voudraient précéder les Français dans le Mossi, la présence de Samori leur ferme la route. Ils voient sans plaisir Sarankényi-Mori occuper le 15 avril 1897 la forteresse de Bouna.
En fait, l'expansion du nouvel empire paraît porter en lui les ferments de sa chute : les peuples que contrôle l'almami ne sont plus les siens ; ses alliés l'abandonnent ou se méfient ; ses ennemis paraissent attendre une occasion :
« Car ce pays n'est pas le mien. Qu'y ferais-je ? Sa langue n'est pas la mienne : ses coutumes diffèrent de celles que j'ai connues. Tout m'est hostile dans ce pays : je n'y ai pas grandi ; je n'y ai enterré aucun de mes ancêtres et quand je marche dans la campagne, les gens demandent qui je suis. »
Les Européens, accélérant ce qu'ils appellent « la course au clocher » et qu'il est plus simple de nommer dépeçage de l'Afrique, mènent désormais leur jeu en dehors des Africains. Il s'agit d'une bataille entre impérialismes dans laquelle les chefferies traditionnelles ne sont plus que des pions que l'on tente de préserver, de s'annexer ou, de détruire. Travail facilité par la méconnaissance qu'ont les autochtones de cette emprise froidement décidée d'un continent sur un autre continent.
Depuis le traité de Berlin, Anglais, Français, Allemands se disputent la dépouille, n'ont plus d'autre but que de s'agrandir aux dépens des autres. Les Britanniques ayant, du moins jusqu'aux dernières années, misé beaucoup plus sur l'est et la route des Indes, les Français conservent les meilleures chances en Afrique de l'Ouest malgré le dynamisme des Allemands.
Cependant, la politique des Anglais évolue. S'il leur paraît encore possible de s'entendre avec l'Allemagne qui explore l'arrière-Togo, parvenant jusqu'en pays mossi, l'expansionnisme français présente une menace. Partant à la fois du sud et du nord, des missions encerclent les possessions anglaises. La Sierra Leone, adossée au Libéria, est isolée. La Gold Coast à son tour se voit prise en tenailles. A partir de 1895, les Britanniques comprennent que la mise en valeur des comptoirs de la côte est fragile, qu'il est indispensable de conquérir l'arrière-pays.
Hélas — du moins pour les Anglais — cet éveil est tardif. Après une brève expédition qui conduira leurs constables jusqu'au Gonja d'où ils écartent les samoriens, ils devront se rendre à l'évidence : moins brimés par leur capitale, moins tournée vers l'océan Indien, les Français ont pris dans l'ouest de l'Afrique une position qu'on ne peut — sauf diplomatie habile — leur disputer.
Les années 1896-1897 vont donc être, pour les envahisseurs, une sorte de valse-hésitation où l'on avance aussi loin que possible sans choquer l'adversaire pour reculer quand celui-ci montre les dents.
Et les Africains ? Nous l'avons dit : même s'ils sont d'une manipulation difficile, rien que des pions. La destinée du continent vient d'être arrachée à l'Afrique.
Faut-il s'étonner de l'aveuglement dont font preuve les chefs ? Samori lui-même soupèse mal l'énorme coalition sous laquelle il étouffe. S'il sait que les Français du Soudan sont hostiles, il module son jugement envers ceux de Côte-d'Ivoire. Il admet mal que les Anglais, commerçants loyaux de la Sierra Leone, puissent se transformer en agresseurs venus d'Accra.
Lorsqu'il joue telle nation — ou même telle fraction de nation européenne — contre telle autre, il ignore le marchandage politique, ne pouvant imaginer que Français et Anglais tiennent ou relâchent la bride en fonction de données qu'il ne contrôle pas. Pourtant, après la rémission de 1896, il doit jouer plus que jamais serré.
En effet, son exode vers l'est l'a placé au milieu d'axes stratégiques. Si l'on considère la carte, on s'aperçoit que pour aller de Bamako jusqu'à Bassam, il faut traverser ou tout au moins longer les possessions qu'il vient de conquérir. La mission Blondieux, descendant du Soudan jusqu'à la forêt, lui rappellera, en 1897, que les Français rôdent autour de ses domaines. A l'est, il doit contenir les rivalités qui se déchaînent autour du Mossi.
Qui peut résister à l'emprise de l'Europe ? La région comprend pourtant, outre celui de Samori, trois grands empires : l'Ashanti, dont le nouveau roi, Prempeh, bien que nommé avec l'assentiment britannique, semble vouloir raffermir son autorité ; le Mossi à la tradition plusieurs fois centenaire ; le Kénédougou, que nous connaissons bien. Cela sans compter d'autres royaumes qui, bien que décadents comme l'antique empire dioula du Gwiriko, issu de la grandeur de Kong, possèdent encore un rayonnement certain.
La résistance, les victoires, qui pendant plusieurs années obligèrent l'envahisseur à piétiner, l'habileté de certaines actions diplomatiques, amènent à s'interroger : ayant formé bloc contre l'Europe, ces Etats n'auraient-ils pu survivre ?
Leur prise de conscience — quand elle eut lieu — survint, hélas ! beaucoup trop tard. C'est après de longues années de guerre, où l'un et l'autre avaient fait appel à l'alliance intéressée des Blancs, qu'un Ba-Bemba ou qu'un Samori découvrirent qui était l'ennemi de l'Afrique.
La même erreur fut renouvelée par bien d'autres s'hypnotisant sur le danger immédiat pour ignorer la mort qui leur venait d'ailleurs.
Quoi qu'il en soit, bien que les Français sollicitent encore officiellement les bonnes grâces de Samori, bien que les Anglais lui ouvrent les marchés d'Accra — recherchant en contrepartie la cession de Bouna et de Boundougou —, l'almami est plus que jamais isolé. La marée blanche, il le sent bien, l'encercle. L'exode imposé à son peuple lui paraît soudain futile : il n'est plus un village d'Afrique à l'abri de l'Europe.
Un an, il n'y a plus qu'un an avant la tempête finale. Pourtant, une période faste paraît s'ouvrir pour Samori.
Le problème de l'armement étant partiellement réglé, un des objectifs vitaux demeure à cette époque la liaison avec la boucle du Niger dont les éleveurs le fournissent en chevaux. Or, les maîtres de Kong et de Bobo-Dioulasso semblent trahir. Ils bernent l'almami. Ils poussent l'audace jusqu'à faire prisonniers ses caravanes et ses marchands. Samori décide une opération punitive. Il envoie ses armées vers Kong. Le 18 mai 1897, la ville est prise ; les responsables décapités. Des cases, il ne reste plus que les murs qui fondront aux prochaines pluies. Après la prise de Noumoudagha, dont la résistance a été héroïque — Samori en a mené le siège —, Bobo ne saurait résister. Voulant éviter le sort de Kong, elle se rallie. En quelques semaines, l'almami a conquis tout le Gwiriko. Pourtant, il refuse de profiter de ses victoires.
En effet, la campagne a été menée par lui avec prudence. Prudence ne visant plus, hélas ! à se ménager les vaincus — les massacres de Kong et surtout de Noumoudagha resteront tristement célèbres dans l'histoire —, mais cherchant à éviter les réactions hostiles des Européens, plus particulièrement de la France. Alors que l'almami est pour la dernière fois partout vainqueur, il envoie des protestations de paix aux Français , il promet d'accepter auprès de lui un résident si on l'autorise à regagner Sanankoro. Il renonce à occuper les terres qu'il a conquises. Il propose même de livrer Bouna.
Evidemment, cette allégeance est stratégique. Il s'agit une fois encore d'éviter tout affrontement, de gagner quelques mois de paix. En ce qui concerne Bouna, l'offre est encore plus subtile. En effet l'almami n'ignore pas l'intérêt que l'Angleterre porte à la ville, étape indispensable vers le Mossi. L'annonce de l'arrivée des Français à Ouagadougou, la destruction puis l'occupation par Sarankényi-Mori de la citadelle en 1896, n'ont fait que retarder ces projets. Si les Britanniques semblent avoir renoncé à attaquer Bouna, ils rôdent dans les zones toutes proches. Henderson, avec une colonne de constables venant de la Gold Coast, n'a-t-il pas rejeté les sofas à l'ouest de la Volta Noire ? N'a-t-il pas établi une garnison à Wa ?
Après les Français de Monteil, les Anglais d'Henderson doivent admettre qu'il n'est pas bon de provoquer Samori. Dès le début d'avril 1897, Sarankényi-Mori avec 7 000 hommes les a forcés à fuir le village de Dokita qu'ils tentent de défendre ; il les a poursuivis puis délogés de Wa. Il a fait prisonnier Henderson venu négocier sur des bases jugées humiliantes pour l'almami. Il a décimé les constables fuyant dans le plus grand désordre en abandonnant leurs blessés.
Cependant Samori a refusé une fois encore d'exploiter trop loin cette victoire indéniable. S'il a contemplé à Dabakala Henderson contraint de défiler à la tête du butin, il a accepté que l'officier ne s'agenouille pas pour lui rendre hommage, il l'a traité moins en prisonnier qu'en hôte et l'a renvoyé avec une escorte, affirmant que le conflit de Dokita n'était que fatalité malheureuse « venue de Dieu ». Modération compréhensible: même si les Anglais ne sont pas dupes, Samori essaie de ne pas s'aliéner de façon définitive les commerçants d'Accra dont il a grand besoin.
Ayant fait, après avoir montré sa force, un acte de bonne volonté vis-à-vis des Britanniques, il lui parait souhaitable d'équilibrer la balance et de satisfaire les Français, tout au moins sur le plan diplomatique.
Le raisonnement paraît irréprochable : accepter la cession de Bouna, passer avec l'almami un traité officiel, semble une victoire pour la France. Vu la difficulté d'obtenir l'accord rapide de Paris, le commandant de la région Niger-Volta envoie une mission de reconnaissance placée sous les ordres du capitaine Braulot, un soldat éprouvé. Si tout évolue comme on prévoit, des mois, peut-être des années, de trêve peuvent être escomptés par Samori.
Malheureusement, avec la pacifique mission Braulot, c'est la perte de l'almami qui s'amorce.
Alors ? S'agit-il d'un piège dans lequel Samori aurait fait tomber Braulot ? L'hypothèse paraît absurde. Même en admettant que la traîtrise soit habituelle à l'almami — ce qui n'est pas le cas —, pourquoi, travaillant depuis des années à se ménager la France, l'aurait-il provoquée de façon si stupide ? Pourquoi aurait-il ruiné lui-même sa patiente diplomatie ?
A posteriori, les Français repoussèrent cette éventualité. Delafosse écrit :
— Dans mon for intérieur, je reste persuadé qu'il n'y a pas eu de guet-apens : la trahison à notre égard n'était pas habituelle à Samori. »
Mais qu'est-il arrivé ? Les relations écrites divergent. Le guide de Braulot, qui réussit à s'échapper, prétend que le massacre se déclencha à partir d'une banale querelle : une dispute à propos de femmes. La dispute aurait dégé néré en rixe et la rixe en bataille. Braulot serait mort d'une balle perdue.
Qu'en dit la tradition orale ? Selon Dème le Tailleur, un des hommes les plus proches de Samori, un faux bruit se serait répandu parmi les sofas . On aurait affirmé que les Français avaient tendu une embuscade. Sarankényi-Mori lui-même y aurait cru. Se pensant trahi, il aurait trahi lui-même.
Cette explication paraît la plus convaincante sur un drame que personne n'élucida. Elle est corroborée par l'hostilité que le fils de Samori manifesta toujours contre la remise de la forteresse — comme contre tout accord avec les Français. Il était donc, mieux que tout autre, prêt à croire les calomnies visant des hommes dont il se méfiait.
Autre argument : Sarankényi n'alla pas lui-même relater le massacre à son père mais y envoya un de ses lieutenants. On sait que Samori, apprenant la mort de Braulot, entra dans une grande colère et fit tout pour que les Français comprennent qu'il s'agissait d'un accident.
Mais, accident ou pas, l'histoire est maintenant irréversible. Samori confie à ses familiers :
— Que je le veuille ou non, c'est la guerre. Elle durera jusqu'à ma mort. »
Pourtant, il fait une dernière tentative : en novembre 1897, une ambassade est envoyée en Côte-d'Ivoire. Celle-ci, comme il était prévu, sera sans résultat.
Cependant, si les tirailleurs sont décidés à venger la mort de Braulot, la riposte n'est pas immédiate. En effet, l'épisode de Bouna, dramatique pour Samori, contrarie la stratégie de la France. Il survient au moment où celle-ci, désireuse d'éliminer l'Angleterre, était prête à faire, provisoirement, alliance avec l'almami.
Les troupes venant de la Gold Coast continuent à progresser vers le nord : il faut y mettre un frein. Cette avance paraît aux Français menaçante. Le châtiment du chef africain peut attendre quelque temps.
Aussi le ministre des Colonies calme-t-il ses capitaines. Que la disparition de Samori, « ce barbare sanglant, capable de toutes les traîtrises », soit décidée c'est évident. Cependant, il importe de ne pas agir sur un coup de colère. Ordre est donné de surveiller prioritairement les manoeuvres des Anglais. Ceux-ci ne viennent-ils pas de s'emparer de Bouna, en éloignant les tirailleurs ?
Les derniers mois de 1897 et la plus grande partie du premier semestre de 1898 seront donc employés par les coloniaux en lutte déguisée. Sans s'affronter ouvertement, chacun essaie de mettre en échec l'adversaire. Il en résultera dans toute la zone des Volta un imbroglio invraisemblable où postes français et anglais s'imbriquent et se côtoient. En effet, un traité de délimitation des frontières est en train de se négocier. Il semble un peu naïvement aux militaires des deux camps que leurs exploits permettront d'en infléchir les clauses. Lorsque l'accord sera conclu, en juin 1898, les diplomates partiront d'autres bases. Ainsi, les Anglais, la mort dans l'âme, se verront dans l'obligation de rendre Bouna à la France.
Quoi qu'il en soit, cette petite guerre détourne provisoirement les Français de Samori. Lui-même l'escomptait bien. N'a-t-il pas ordonné à Sarankényi-Mori d'évacuer Bouna afin que cette ville cristallise les convoitises ? L'opération semble avoir réussi.
Une autre diversion réjouit infiniment moins Samori.
Depuis des années, il est, au milieu du glorieux Soudan français, une tache, un territoire dont la liberté scandalise. Le Kénédougou maintient son indépendance envers et contre tous. S'acceptant, tout au moins dans les mots, vassal de la France, il se contente de livrer chaque année 80 boeufs — encore a-t-il suspendu ce tribut. Pour le reste, Ba-Bemba agit à sa convenance. Or, non seulement le principe de cette indépendance est insupportable à l'envahisseur, mais elle entrave ses projets. Le Kénédougou ne se trouve-t-il pas sur la droite ligne permettant de relier la Côte-d'Ivoire à Bamako ? Ne remonte-t-il pas Samori en chevaux ? Ne constitue-t-il pas pour celui-ci une sorte de muraille contre laquelle il trouve appui ?
En effet, l'almami et le faama vont volontairement oublier leurs dernières querelles. Plus rien ne les sépare. Cette connivence, bien que secrète, est connue des Français.
Aussi décident-ils, avant d'attaquer Samori, d'abattre leur allié peu fidèle.
L'indignation du faama est si grande qu'il fait poursuivre l'ambassade. Ses hommes la rattrapent. Ils dépouillent sans leur faire aucun mal Morisson et ses tirailleurs. C'est une délégation à moitié nue et désarmée qui regagne le poste.
Sans doute l'événement est-il moins sanglant que le massacre de Bouna, mais l'humiliation est la même. Cette fois, la rupture est définitive entre la France et Sikasso. La guerre devient inévitable.
Le gouverneur décrète la mobilisation générale : il ne convient pas de renouveler l'échec subi en 1888 contre Samori. Mille tirailleurs auxiliaires affluent sur Bamako. On dégarnit le front saharien. On met en route l'artillerie. Tout est en place pour détruire la citadelle légendaire.
Le 15 avril 1898, les Français parviennent devant les murs de Sikasso. Ils s'installent, face à la ville, sur une crête dénudée. Ba-Bemba, par ses multiples sorties, les harcèle. Hélas ! il ne s'agit plus d'une bataille d'hommes luttant contre des hommes mais d'hommes opposés aux canons. Ceux-ci sont mis en batterie ; les obus se moquent des remparts jugés infranchissables.
Le 1er mai, l'assaut est donné. Les troupes du Kénédougou se défendent avec une énergie à laquelle l'ennemi rend hommage. Mais que peut l'héroïsme ? L'après-midi même, tout est consommé. La ville est prise et Ba-Bemba est mort : plutôt que de se rendre, il a ordonné à un de ses captifs de le tuer.
Ainsi finit une des places fortes les plus prestigieuses de l'Afrique. Ainsi finit un roi que son courage nous oblige à saluer. Il a fallu quinze jours seulement. Une fois encore, les engins de mort de la technique européenne ont supplanté la valeur humaine. Là où Samori a reculé après seize mois, les Français sont entrés au bout de deux semaines.
Mais, pendant ce temps, que devient Samori ?
Une fois encore, il a fait l'analyse lucide des événements se déroulant autour de son empire. Nous avons vu comment il a dressé la France et l'Angleterre l'une contre l'autre. S'il n'a pu déclencher la guerre, cela ne dépend pas de lui mais des problèmes politiques se réglant là-bas, en Europe, ou même dans les contrées lointaines de l'Afrique : Fachoda se prépare.
Cependant, même si les Européens s'étaient battus, l'almami en est bien conscient, il n'aurait pu s'agir pour lui que d'une trêve : l'offensive est pour demain.
Aussi essaie-t-il d'organiser sa résistance. Fuir encore ? Peut-être, mais existe-t-il un asile? Pour la première fois, Samori paraît admettre qu'il lui faut résister sur place.
Pour concevoir ses nouvelles défenses, il semble avoir médité l'exemple du Kénédougou alors encore intact. Que peut-il constater ? Que lui-même, malgré l'importance de ses forces, a dû abandonner Bissandougou. A l'inverse, Sikasso se maintient.
A ces faits, il cherche une raison et croit la découvrir : les murs de Sikasso sont imprenables pour les Français comme il le furent pour lui. Une forteresse bien construite est la plus sûre des sauvegardes.
En ces dernières semaines de 1897, le raisonnement paraît inattaquable. L'almami s'appuie sur des faits qui se vérifient. Immédiatement, il applique son idée et choisit le site où s'élèvera la citadelle. Il l'arrête aussi loin qu'il est possible des Français, dans une région déserte, donc difficilement approchable, mais voisine de terres riches où l'on peut se ravitailler. Ce site encore inhabité, il le nomme Bori-Bana, ce qui veut dire « Fini de courir ». Est-il besoin d'expliquer pourquoi ? Situé au sud du nouvel empire, c'est-à-dire très loin du Soudan, il est proche de l'Etat tampon que constituent les Baoulé.
Immédiatement, Samori réquisitionne les travailleurs et organise leur ravitaillement. Une énorme forteresse de 500 mètres de diamètre, entourée de murs de 5 mètres d'épaisseur commence à sortir de terre — à notre époque, on en discerne encore les ruines. Combien de temps faut-il pour achever cette oeuvre qui doit rendre Samori aussi invulnérable que ses nouveaux amis du Kénédougou ? Quelques mois. Or, si les renseignements de l'almami sont justes, la petite guerre franco-anglaise doit se poursuivre jusqu'à la fin de la saison des pluies 1898. Tout sera prêt à ce moment. Donc, les ouvriers s'affairent. On amène des captifs , on les oblige à cultiver les terres alentour. Toutes précautions sont étudiées pour que Bori-Bana, comme Sikasso, ne puisse être vaincue ni par la peur, ni par surprise.
Mais le Ciel semble abandonner Samori. Alors qu'il temporise et s'efforce de gagner quelques mois de paix, les militaires français, malgré les ordres, se lancent une fois de plus dans la guerre. Cela se passe à Kong.
On se rappelle que la ville, soupçonnée de traîtrise, avait été conquise avec une cruauté qu'il est difficile de pardonner à Samori. L'almami, après avoir fait exécuter de nombreux hommes, avait ordonné d'arracher à chaque maison son armature de bois afin que le banco s'effondre aux premières grandes pluies.
Les pluies étaient venues. Les murs retournés à la terre. Il ne restait de l'orgueilleuse Kong que des ruines où l'herbe poussait déjà. Pourtant cet amas désolé suscitait encore les convoitises. Les Anglais y songeaient comme à une conquête difficile. Les Français craignaient d'y voir installés les Anglais. Les samoriens tenaient les ruines afin d'éviter le retour des envahisseurs.
Telle est la situation en janvier 1898. Si l'on en croit la version des Français, ces derniers auraient appris qu'une colonne anglaise se dirigeait vers Kong et auraient décidé de prendre les devants. Cela semble un prétexte, une habile utilisation des instructions données: « Il ne faut pas vous laisser devancer. Soyez prudents, mais n'hésitez pas. » Le 24 janvier 1898, le kélétigui responsable de la place subit un assaut qu'il n'avait pas prévu. Incapable de résister aux tirailleurs, il s'enfuit vers le sud laissant à l'ennemi un important stock de grains. Immédiatement, Samori l'apprend. Kong est peu éloigné de Dabakala où il réside jusqu'à ce que Bori-Bana soit construite… Impossible de laisser les Français aussi proches. L'almami fait appel à Sarankényi-Mori dont les troupes ont évacué Bouna. Sarankényi parvient le 11 février devant Kong. Sa situation est bonne, la ville
morte étant environnée de hauteurs. De plus, la source est éloignée de la cité. Sarankényi s'empare de cette source. Les tirailleurs, enfermés dans un camp de fortune avec leurs familles, connaissent la soif, s'ils mangent à leur faim. Que faire ? Creuser un puits ? Le commandant
français l'ordonne : il ne trouve qu'un peu d'eau putride, vite épuisée. La langue gonflée, les enfants commencent à mourir. Le fils de l'almami va-t-il remporter la victoire ? Non.
Alors que la garnison pense à la reddition, des troupes fraîches volent au secours des assiégés. Il était temps. Les accès de Kong se dégagent. Dès la fin de février, Sarankényi est obligé de fuir. La France vient de faire une victoire de cette presque défaite.
Cependant, Sarankényi refuse de renoncer. Il coupe, aidé de son frère Mouktar, les colonnes ravitaillant la ville, y met le siège une seconde fois.
Mais à quoi bon ? Tout effort parait désormais inutile: une nouvelle terrible, venant de l'est, éclate : Sikasso est prise. Pour cela, il n'a pas été nécessaire d'un déploiement de forces étonnant : les Français se sont contentés de camper pendant deux semaines devant la ville.
Cette invraisemblable défaite, Samori l'apprend à Bori-Bana, la forteresse dont il accélère les travaux. Moryfindian, le griot fidèle, reçoit les messagers. Craignant les réactions de l'almami, il n'ose annoncer publiquement la nouvelle. Il fait signe à son maître et l'entraîne à l'écart.
Au bord du fleuve, il est une barque, loin des oreilles indiscrètes. Moryfindian et Samori y montent. Là, dans les remous de l'eau et le sifflement du vent, l'almami prend connaissance du message.
— Quinze jours ? Quinze jours seulement ?
— Pas un de plus.
Devant les deux hommes, les murs inachevés de Bori-Bana se découpent sur le ciel.
— Et les remparts de Sikasso ?
— Ils n'ont rien empêché. Que faire contre les canons ?
Soudain Samori comprend l'inanité de son dernier grand oeuvre. Il faudrait des mois pour construire une citadelle non pas supérieure mais égale à la perle du Kénédougou… des mois et tout ce poids inutile de travail pour une citadelle qui peut être détruite en un seul jour…
Alors Samori abandonne ses murailles. Non, il n'a pas « fini de courir ». La fuite, qui lui a été salutaire tellement de fois, il faut encore qu'il s'y résigne.
— Et où crois-tu pouvoir aller ? Vers l'est ? Tu sais bien ce qui t'attend vers l'est : le piège français et anglais. Le sud ? Comment se heurter aux Baoulé ? Le nord ? Les Français y sont maintenant à demeure, n'y pensons plus. Alors, que reste-t-il ?
En fait, ce sont des discussions passionnées dans lesquelles s'affrontent les partisans d'une marche forcée vers l'est, coûte que coûte — ne peut-on rejoindre les Zarma, nos frères ? —, et ceux qui, comme le vieux griot Moryfindian, conseillent de retourner vers l'ouest.
Samori écoutera finalement ce dernier. L'ouest, c'est-à-dire l'arrière-pays du Libéria, un Etat neutre de la Sierra Leone :
« N'a-t-on pas dit trop de mal des Anglais ? Ne sont-ils pas capables de nous protéger contre la France ? Les Toma, qui sont fidèles, nous recevront dans leur pays. »
Mais derrière ces raisons logiques, une autre :
« L'ouest, n'est-ce pas la terre que l'on m'a arrachée, la terre où je suis né et dont on m'a dépossédé ? O pays qui me sont chers et proches… Bissandougou…. Sanankoro…. terres que j'ai ensemencées et où j'aurais voulu mourir. »
« Voici peut-être le moment de ma mort. Tout ce qui me rapproche de l'ouest est dans mon coeur. Le Konyan m'est fermé, je le sais. Pourtant, je préfère encore les forêts, refuge du temps de ma jeunesse à l'inconnu de l'est où je suis étranger. »
Telles furent peut-être les réactions de ce vieil homme — il a près de soixante-dix ans.
Quoi qu'il en soit, il ordonne un nouvel exode. A celui-ci ne participeront que ceux qui partagent avec lui l'honneur — et la douleur — d'être nés dans son ancien royaume. « Les sofas appartenant aux populations nouvellement conquises sont démobilisés. Qu'ils se débrouillent et retournent à leurs champs ! Pour les autres, ceux que je peux appeler frères, qu'ils m'accompagnent. »
Cependant, il ne faut pas croire que c'est un petit groupe en désordre qui reflue. Certains Français parleront de 120 000 personnes (y compris les femmes et les enfants). Le chiffre paraît un peu exagéré : 100 000 serait plus admissible.
Affamés ? Loin de là : 6 000 búufs les accompagnent. D'innombrables esclaves ploient sous le poids d'énormes charges de grains.
Désarmés ? Les sofas portent en bandoulière pour le moins 12 000 fusils dont 4 000 à tir rapide. Les cartouches ne font pas défaut. C'est une armée plus forte que celle assiégeant Sikasso qui se décide à la retraite.
Mais cette importance peut constituer une faiblesse. Partout se répand dans les populations naguère soumises cette rumeur : « Samori est en fuite, Samori abandonne. »
Fatalistes, les petits chefs s'interrogent, ils considèrent leur intérêt :
« Si Samori lui-même n'a pu résister aux Français, moi qui suis faible et connais ma faiblesse, comment ne me soumettrais-je pas ? »
Les tribus que traverse l'exode s'affolent à juste titre : « Comment nourrir cette foule immense qui possède juste assez de grains ? »
Les populations fuient, emportant leurs récoltes.
Puis survient l'hivernage : les chemins rendus impraticables par la boue où l'on entre jusqu'à mi-mollet ; les pluies ne cessant de détremper les hommes et les choses. Cependant, Samori avance. Il pourvoit au ravitaillement. Il razzie, parce qu'il le faut.
Pour lui, un seul espoir : les Français, plus que les Africains, ont toujours eu peur de la terrible saison des pluies. Hélas ! l'exode des samoriens semble agir comme un exorcisme.
Ils ne se contentent pas d'organiser le territoire que l'almami leur abandonne, d'effectuer la liaison Soudan-golfe de Guinée à laquelle ils rêvaient depuis près de dix ans, Ils s'acharnent sur leur vieil ennemi.
Comme toujours, les décisions vont moins dépendre des faits que contrôle Samori que de données qui lui échappent.
Qui a-t-il comme adversaire ? Le gouverneur militaire de la région, Audéoud : les jours de celui-ci sont comptés car il n'est qu'un intermédiaire. Quelle gloire si Samori pouvait être capturé sous son administration. Ensuite, le commandant de Lartigue, responsable militaire de tout le sud du Soudan. Ce dernier déborde d'activité. Tous ceux qui n'agissent pas — même trop vite — sont taxés par lui de mollesse. Lui aussi rêve de gloire, et qu'est-ce que la gloire, sinon le règlement de l'affaire Samori ?
La retraite de l'almami vers l'ouest ravive l'espoir de ces deux hommes. En effet, en se dirigeant vers l'hinterland du Libéria, Samori leur rend, sans le vouloir, un généreux service : d'une part, il s'éloigne de la zone où les intérêts français et britanniques s'affrontent, d'autre part, il semble renoncer à tout débordement sur la Côte-d'Ivoire : on sait que les Français de Bassam freinent depuis plusieurs années le zèle de leurs compatriotes. Enfin, comme nous l'avons dit, ce que le commandement ennemi baptise « fuite » paraît le signe de la défaite inévitable de l'almami. Audéoud annonce à Paris l'excellente nouvelle, insistant sur la « terreur » que doivent éprouver les sofas . Pourquoi ne pas profiter de circonstances si favorables ?
En fait, le commandant n'espère pas vaincre, dans une région particulièrement hostile au moment de l'hivernage. Mais ne peut-on démoraliser ce trublion insupportable ? L'empêcher de reconstituer ses forces ?
Inutile de le préciser, Lartigue approuve sans réticence les projets de son supérieur. Pris d'enthousiasme, il réclame des renforts. Ceux-ci lui seront dans un premier temps refusés, les troupes dont il dispose paraissant suffisantes. Lartigue proteste vigoureusement ; en allant vers l'ouest, Samori ne va-t-il pas rejoindre ses derniers amis, les Toma ? Ceux-ci ne sont-ils pas des opposants dangereux pour la France ? Les militaires l'ont signalé maintes fois. Qu'adviendra-t-il si, à leurs forces, s'ajoutent celles de l'almami ?
Argument recevable. Le 10 août, le commandant obtient une réponse plus favorable du gouverneur. Elle l'autorise à empêcher Samori d'entrer au Libéria et prescrit « d'en finir avec lui et de l'arrêter avant qu'il ne puisse arriver chez ses amis toma. »
Que demander de plus ? D'ailleurs Lartigue n'a pas la patience d'attendre. Malgré les pluies qui sont cette année-là d'une rare violence et transforment en fondrières la région, il a déjà préparé l'attaque. Le 19 août au soir, il parvient en vue des sofas qui campent avec leur suite immense de femmes, d'enfants et de troupeaux, près d'un village du nom de Dwé.
Les samoriens semblent d'abord se débander. Les Français, vainqueurs après avoir tiré quelques salves, s'emparent de la place. Joie de courte durée. Ils n'ont fait que saisir l'appât : les sofas les encerclent. Dans la soirée du 20, un quart des tirailleurs sera mort ou blessé, les autres, affamés, démoralisés, à bout de force. Lartigue doit ordonner une retraite humiliante. Il parvient néanmoins à s'enfuir. Le lendemain, Sarankényi-Mori donnera l'assaut à un camp déserté et ne pourra, malgré son ardeur, rattraper les Français refluant sur Touba.
En dépit de cette perte de contact, l'almami vient d'emporter une incontestable victoire. Lartigue est décontenancé. Croyant partir à la curée, il vient de découvrir son maître. Déjà les samoriens submergent la région. La chance va-t-elle changer de camp ?
Comment le pourrait-elle ? Elle le peut : le 23 août, Sarankényi-Mori parvient sans résistance à huit kilomètres des positions françaises. Résister sera difficile. Dans ce climat humide, les chevaux meurent par dizaines, les hommes souffrent de la malaria.
Et soudain, une nouvelle étonnante. Les sofas se sont retirés. Alors que le matin ils harcelaient les environs du fort, les voilà qui refluent vers le sud. Que s'est-il passé ? Pourquoi Samori a-t-il renoncé à exploiter sa position ?
Il semble que l'accrochage de Dwé n'ait été pour lui qu'accident de parcours. S'il est heureux d'avoir montré sa force, il ne veut rien de plus. L'important est que les Français comprennent. Il estime, en se retirant, avoir montré une fois de plus que, malgré sa puissance, il désire uniquement la paix… La paix ! Qu'on lui laisse la paix ! Mais lorsqu'on l'attaque, il mord !
Samori vient de commettre l'ultime erreur de sa carrière. S'il recherche la paix, la France ne la veut pas. Les chiens s'acharnent. Ils reniflent la piste. Ils débusquent le grand éléphant. Pourtant, ce ne sont pas les armes qui auront finalement raison de lui.
Pour ceux qui ignorent ces régions de forêt au temps de l'hivernage, il faut rappeler combien les sentiers deviennent impraticables, le moindre ruisseau se transforme en rivière ; la moindre rivière en étendue infranchissable d'eau fangeuse aux multiples tourbillons. Tout le pays n'est plus que marécage où le pied des vaches s'enlise. La pluie tombe comme si l'on répandait des torrents d'eau. La moiteur, l'attaque des insectes… La vie devient insupportable pour qui ne peut se réfugier bien au sec dans sa case et compter les grains de son grenier.
Voilà le déchaînement redoutable que Samori affronte à présent. Passe encore pour les guerriers, mais il y a des femmes, toute leur richesse empilée sur la tête, leurs petits enfants dans le dos… Il y a l'ennemi.
Pour une raison qu'il nous est aujourd'hui difficile de comprendre, Samori victorieux semble renoncer à la route directe menant au pays des Toma. Il s'enfonce dans les forêts inhospitalières du sud-ouest. Peut-être veut-il éviter la proximité des Français de Beyla ? Il plonge à travers la forêt redoutable. Là demeurent des peuples à la réputation farouche, comme les Dan que nul ne peut approcher et qui, la légende l'affirme, se nourrissent de chair humaine.
Antropophages, peut-être pas, mais décidés à se défendre. D'ailleurs, point ne leur est besoin de dévorer ou même de combattre leurs ennemis. Le climat se révèle beaucoup plus efficace. Le climat, mais aussi la famine.
En effet, les vivres se font rares. Alors que plus au nord le riz se récolte en septembre, les nourritures bizarres des gens de la forêt sont bien plus tardives : il faut attendre octobre pour cueillir le taro ; le manioc se récolte en novembre. Alors que reste-t-il ? Abattre les búufs de l'important troupeau ? La mouche tsé-tsé les décime. Ils agonisent, squelettiques, sur le bord du chemin. On dévore la chair dure et filandreuse. Les chevaux eux-mêmes disparaissent mystérieusement pendant la nuit.
Rien ne peut retenir ces hommes qui tentent de survivre. Les masses, jadis disciplinées, s'égaillent. Elles déterrent les herbes sans goût. Elles arrachent les racines plus minces que le petit doigt.
Prises de fureur, elles mettent le feu aux récoltes en pousses : « Si je meurs, qu'au moins les Dan ne mangent pas ! ». On dit même que certains morts n'eurent pas besoin de sépulture.
On le dit, car la faim est atroce. Derrière la horde samorienne — peut-on encore parler de peuple ou bien d'armée ? — s'élève une écúurante odeur de cadavres qui se décomposent. Les sources sont polluées. Les rivières transportent des débris d'êtres humains. Dans le ciel tournoient les vautours.
Il n'a fallu que quelques semaines. De l'armée victorieuse et repue de Dwé, les éléments ont fait ce peuple réduit à la folie. Dieu a retiré sa main de l'homme qu'il a fait naître. Dieu a voulu être lui-même l'instrument de la perte de Samori. Peut-être, toute créature devant mourir, lui a-t-il accordé une grâce dernière : le
dernier des grands fils de l'Afrique traditionnelle ne devait pas être vaincu par les Blancs mais par Dieu. S'il est touché à mort, ce n'est pas la volonté d'une puissance étrangère mais la colère du Ciel qui se déchaîne.
Touché à mort, il l'est. Frappé comme ces arbres solides que seul le feu divin peut un jour renverser. Depuis le 28 juillet au moins, il le sait. Nous en avons la certitude par la mission qu'il envoya ce jour-là aux Français. Que demande-t-il ? La paix, une fois encore. Il se dit fatigué de cette vie errante.
Que souhaite-t-il ? Finir ses jours à Sanankoro, sa patrie. En cette fin de juillet, il abandonne tout artifice. Il avoue que son armée est en train de mourir de faim. Il demande qu'on lui donne « une paire de souliers pour qu'il ne marche pas les pieds nus dans la boue. »
Que va répondre Lartigue ? La proposition l'intéresse. Sa défaite de Dwé est encore trop fraîche pour qu'il n'essaie pas d'éviter un nouveau soubresaut. Pourtant, il exige que deux chefs de guerre, Sarankényi-Mori et Mouktar, les propres fils de l'almami, soient remis en otage. Il pose comme condition préalable la remise des munitions et de toutes les armes. Après cela, que Samori se rende, sa proposition sera considérée !
Quand il donne cette réponse, une fois de plus inacceptable, le commandant français est bien conscient qu'il risque peu. Il sait que les désertions se sont multipliées chez l'ennemi. Il peut donc parler fort. En fait, il lui semble que l'almami ne désire qu'une chose : retourner à Sanankoro. C'est pourquoi il câble au ministre de vouloir bien autoriser ce retour. Pour Audéoud comme pour Lartigue, il importe de régler le problème rapidement.
Malgré l'horreur dans laquelle il se trouve, Samori repousse ces propositions. Il ne peut accepter de livrer ses fils, de livrer ses armes. Même lorsqu'on lui assure le refuge à Sanankoro, il pose encore des exigences, réclamant le châtiment d'un sofa déserteur réfugié auprès des Français.
Est-ce un sursaut d'orgueil désespéré ou bien conserve-t-il en cette fin du mois d'août une lueur d'espoir ? Espère-t-il pouvoir gagner les régions neutres ?
Pour qui considère le chemin à parcourir, cette espérance paraît assez aléatoire. Entouré d'ennemis, Français comme Africains, comment aurait-il pu franchir quatre grandes rivières en période de haute crue ? S'il était parvenu à le faire, ses pertes auraient été si fortes qu'il serait arrivé en réfugié chez les Toma.
Pourtant l'almami bande ses dernières forces. Qui dira les miracles accomplis ? Comme ce 8 septembre où toute une armée parvint à franchir les eaux tourbillonnantes du Kounadi-Kélébagha sur un simple tronc d'arbre abattu entre les deux rives. Comme cette lutte perpétuelle contre la pluie, contre la faim.
Cependant, il ignore ce que trame l'adversaire. Pour Lartigue, le plan est simple : couper la route de l'ouest, obliger l'almami à s'enfoncer dans la forêt, et alors, pourquoi pas, l'idée commence à poindre, réussir à le faire prisonnier. Tous les espions sont maintenant formels : les sofas sont plus préoccupés de survie que de combats. Ils traquent davantage le riz encore vert qu'ils n'arment leurs fusils.
Le but paraît tellement proche que les Français n'hésitent pas à s'approcher de territoires jugés inabordables. Ils affrontent le pays des anthropophages. Ils passent un pacte avec des gens qu'ils mettaient hier au dernier rang des sauvages les plus redoutables.
Le 8 septembre, ils se trouvent à quelque 15 kilomètres des samoriens. Le 9, ils les surprennent en train de traverser le haut Cavally. Ils s'emparent du camp de Sarankényi-Mori qui doit fuir : des milliers de sofas se trouvent acculés. Sensibles à la promesse qu'ils auraient la vie sauve, ils se rendent. Une énorme masse d'hommes, de femmes, d'enfants, mendiant un peu de nourriture, s'agglutine autour des Français. Les vainqueurs, encombrés par 30 000 vaincus, doivent renoncer à la poursuite.
Un dernier répit, mais de courte durée, est accordé à l'almami. En effet, Lartigue n'a pas dirigé en personne l'attaque que nous venons de relater. Apprenant la fuite de Sarankényi et les redditions innombrables, il pressent pouvoir réussir là où Archinard, Combes et Monteil ont échoué. Il veut être, pour l'histoire, celui qui a capturé Samori. Pas question d'en déléguer la gloire à quelqu'un d'autre. Aussi le commandant accourt. Il amène avec lui un nouveau contingent.
Pourtant, la défaite du 9 septembre n'a pas modifié considérablement l'équilibre des forces. Parmi les 30 000 transfuges se trouvaient avant tout des bouches inutiles, une charge beaucoup plus qu'un appoint.
Non, la défaite est avant tout morale. Les effectifs les plus brillants de Samori, ceux qui lui avaient permis de gagner ses plus grandes batailles, ont fui. Ils se sont dissous en une seule journée. Sur personne, il ne peut s'appuyer sur personne. Moins de deux mois après la victoire de Dwé, il se rend compte que les hommes refusent de mourir quand il l'ordonne. L'aura dont il jouissait n'existe plus. Inutile d'espérer combattre. Seule sa fuite dans les régions les plus désolées peut encore lui conserver la vie.
En est-il encore temps? Les Dan, témoins de sa déconfiture, multiplient les attaques. Ils harcèlent les samoriens. Ils poussent l'audace jusqu'à tenter d'enlever leurs compagnes. Ne pouvant plus vaincre, Samori négocie. Tout au moins, il le tente. Mais ses partenaires ont compris que le lion vient de perdre ses dents. Faut-il lutter encore ? A quoi bon ? Les morts paraissent soudain bien plus nombreux que les vivants.
Nous sommes à la fin de septembre: le 27, l'almami réunit ses conseillers. Parmi eux, son vieil ami, le griot Moryfindian… Il contemple longuement l'assemblée épuisée. Ces visages où les os transparaissent, ces dignitaires aux boubous crottés. Il leur dit : « La guerre est finie. »
Il leur lit la lettre qu'il veut envoyer au gouverneur par l'intermédiaire de son fils Tiranké-Mori :
« L'objet de la présente lettre est de te faire savoir que ton envoyé est venu. Il m'a dit ce dont tu l'avais chargé et surtout de remettre mes fusils. J'ai alors interrogé mes sofas et tous mes chefs ; mais ils ont tous refusé : « Tu n'accepteras pas cela, m'ont-ils dit, ni nous non plus. Nous ne voulons pas devenir sofas chez les Français. » Ils m'ont trompé, et trahi, ils se sont enfuis et réfugiés chez vous en vous donnant tous leurs fusils pour avoir la vie sauve. A mon tour, je viens me mettre au service du gouverneur. »
Un silence suit cette lecture. Qui pourrait discuter ou répondre ? L'inévitable est là. Tiranké-Mori s'avance jusqu'aux pieds de son père qui lui remet la lettre. Il s'éloigne avec ses compagnons.
Peut-être l'avenir de l'almami aurait-il été moins cruel si Tiranké-Mori avait pu joindre immédiatement les colonnes françaises. Mais, mal informé, ce n'est que le 2 octobre qu'il se présente au poste de commandement. Il est reçu par Lartigue.
Celui-ci ressent une bouffée de joie : enfin la voici, cette reddition inconditionnelle qu'il attendait ! Sans perdre un instant, le commandant dicte sa réponse à l'almami : que celui-ci ne craigne rien. Qu'il dépose les armes et croie en l'amitié de la France.
Lartigue tient à ce que ses hommes portent eux-mêmes - le message et raccompagnent Tiranké-Mori. Soudain parvient une nouvelle incroyable : le capitaine Gouraud s'est emparé de Samori au milieu de son camp.
Ce message, qui foudroie Tiranké-Mori et son escorte, paraît tout aussi surprenant aux Français. En effet, Gouraud n'a jamais eu mission de capturer l'almami. Il effectue depuis le 24 septembre une opération de reconnaissance. Son but ? Repérer la position des fuyards. S'en approcher le plus près possible, les canaliser, les obliger à se diriger vers les troupes de Lartigue qui attendent sur le Cavally. Cela et rien de plus. Gouraud a raconté dans ses mémoires sa marche hallucinante au pays de la mort : seuls des cadavres à demi décomposés occupent les villages ; les mourants ayant essayé d'atteindre les points d'eau forment autour des sources des charniers d'une puanteur écúurante. Il est alors difficile, voire impossible, de trouver un puits non pollué. La pluie ne cesse, pas.
C'est ainsi que, le 29 septembre, les tirailleurs parviennent à Kpoangwine. Là ils trouvent quelques hommes de l'arrière-garde de Samori. Sans combat, ils se rendent, apprenant à Gouraud que le gros de l'armée campe à Géoulé, non loin de là.
Le capitaine soupèse rapidement ses chances. Est-il possible de s'emparer de Samori ? Du moins peut-on le tenter. Gouraud donne des ordres très stricts. L'important est que l'almami ne se doute de rien. Il semble, d'après les témoignages, se garder médiocrement vers l'ouest. Donc, surtout, qu'on avance sans bruit.
« Comme consigne générale, il est recommandé de conserver les tirailleurs absolument groupés. Défense leur est faite de tirer un coup de fusil sans l'ordre de l'officier ou du sous-officier commandant la section et, à ceux-ci, le capitaine recommande de ne tirer qu'en cas de nécessité absolue. Pour prendre Samori, il ne faut pas un combat… »
Sept heures du matin dans la clairière de Géoulé. Samori, devant sa case, lit comme à son habitude le Coran. Les femmes vont et viennent. Elles préparent les rares nourritures qu'elles ont pu trouver. Les guerriers procèdent à leurs ablutions du matin. Un peu à l'écart, malgré l'extrême disette, se tient un petit marché où les plus habiles parmi les dioula revendent ce qu'ils ont pu grappiller la veille. Tout est calme. Pour quelques instants, il ne pleut pas.
Soudain, une rumeur sourde. Elle provient du petit marché. Samori lève la tête : il n'aime pas être dérangé dans ses méditations. Les guerriers et les femmes suspendent leurs gestes. Alors surgissent les tirailleurs. Les uns s'arrêtent, fusil braqué à l'entrée du camp, les autres, protégés par leurs camarades, le traversent à toute vitesse, bloquant les autres issues.
Ici, les témoignages divergent. Pour les uns — les Français —, Samori, que sa haute taille et son turban auraient rendu facilement reconnaissable, se serait enfui : « Il courait comme un jeune homme, à la recherche d'un cheval, sans armes, tenant encore à la main les feuillets du Coran. »
On lui crie:
— IIo, Samori (Rends-toi, Samori !)
« Il s'engage dans un petit bois. C'est là que trois tirailleurs lui barrent le passage. Il crie, il gesticule… »
Pour les autres, ses compagnons, les faits se seraient passés de façon différente. L'almami aurait eu un rêve prémonitoire. Au matin, il aurait fait appeler un de ses lieutenants :
— Va dire aux femmes de se préparer, aurait-il dit. Nous partons, car j'ai rêvé que les Blancs approchent.
L'envoyé, à mi-chemin du camp des femmes, aurait aperçu les Français. Il serait revenu vers son maître
— Fuis ! L'ennemi est là !
L'almami aurait à peine levé les yeux de son Coran.
Après l'arrestation, un des gardes aurait menacé de son fusil les tirailleurs. Samori l'en aurait empêché :
— Ne tue pas. Dieu l'a voulu.
Puis, aux sofas qui l'entouraient
— Ne tirez pas. L'heure a sonné.
Quoi qu'il en soit, à 8 heures, l'almami est aux mains de Gouraud. Gardé par 4 tirailleurs, il est enfermé dans sa case. Là, il fait sa seconde prière. Désormais, il refuse de parler avec les hommes et ne veut s'adresser qu'à Dieu.
Cependant, Gouraud s'inquiète. Où sont Sarankényi et Mouktar ? Les fils de Samori conservent des sofas . Il importe qu'ils se rendent. Sans tarder, le capitaine envoie des émissaires : si Sarankényi et Mouktar résistent, leur père sera exécuté. S'ils déposent les armes, ils auront la vie sauve.
Les deux frères ne résistent pas. Ils se présentent devant Gouraud et ils lui livrent leurs fusils. Le lendemain, le capitaine fera le bilan du butin : seulement 580 fusils à tir rapide et 1 000 fusils à pierre : un trésor médiocre, surtout composé de poudre d'or. Voilà à quel degré de faiblesse était réduit un des plus grands souverains de l'Afrique de l'Ouest.
Certains voulurent cependant que le trésor de l'almami ne soit pas tombé aux mains des Français, qu'il l'ait enfoui quelque part durant son dernier exode. Beaucoup le souhaitent. Mais qui le sait ?
Gouraud, encombré par ce prisonnier prestigieux, quitte, dès le 1er octobre, les régions dévastées. Le 9, il remet Samori aux mains du commandant Lartigue.
Alors commence le dur exil. Si Gouraud, homme de qualité, a traité avec respect le grand vaincu, il n'en est pas de même de Lartigue : celui-ci rassemble tous les préjugés de son temps. N'ayant plus peur de Samori, il le méprise. Alors qu'il était prêt à lui accorder, lorsqu'il était libre, une reddition honorable, il revient sur toutes les promesses qu'il avait faites à Tiranké-Mori. S'il n'a pas pouvoir ultime de décision, sa position paraît nette: puisqu'il a été pris les armes à la main, aucune raison d'accorder quoi que ce soit à l'almami.
Pour le moment, il escorte le prisonnier, faisant de sa capture une victoire personnelle. Il se réjouit lorsque les populations locales fêtent beaucoup moins la capture de Samori que la paix attendue si longtemps. Le 17 octobre, la colonne parvient à Beyla. Les instructions d'Audéoud l'y attendent: qu'on emmène Samori à Kayes avec ses 15 femmes, ses fils aînés et ses principaux conseillers. Les responsables de la mort de Braulot resteront à Beyla où ils seront jugés par une cour martiale (cette dernière décidera la mort de deux kélétigui, et en particulier du griot Amara-Dyéli, qui seront fusillés).
Sarankényi-Mori ne fut pas inquiété. S'il participa au procès, ce ne fut qu'à titre de témoin. A l'issue des débats, il devait rejoindre Samori avec sa mère et ses jeunes frères.
Des sofas, en grand nombre, furent envoyés aux travaux forcés du chemin de fer. Nombreux furent les parents et alliés de Samori qui se rallièrent. Certains d'entre eux allaient s'illustrer comme officiers ou sous-officiers, pendant la Première Guerre mondiale et en particulier aux Dardanelles.
Mais que devenait l'almami ? Les Français d'Afrique saluent avec bonheur l'annonce de sa chute. Le Journal officiel de Saint-Louis consacre sa première page à l'événement :
« L'A.O.F. est désormais débarrassée de l'irréconciliable ennemi qui pendant quinze ans a semé la terreur des rives du Haut-Sénégal à celles de la Volta. »
En France, la capture de l'almami fait moins de bruit. La métropole s'intéresse alors davantage aux problèmes intérieurs (affaire Dreyfus) qu'à l'Afrique. Cependant, les responsables éprouvent un grand soulagement. Mais que faire du vaincu ? Lui permettre de rester au Soudan ? Trop dangereux. Il est une colonie au climat jugé redoutable. Une bonne terre d'exil selon les conceptions du temps. On câble au gouverneur du Congo : n'aurait-il pas une résidence à proposer pour un prisonnier dangereux ? La réponse parvient : il existe au Gabon une île très isolée tout à fait convenable. Qu'on lui amène ce pensionnaire.
Le 22 décembre au matin, dans la forteresse de Kayes. L'almami est invité à sortir de sa prison. On l'emmène devant l'hôtel du gouverneur. Toutes les troupes y sont assemblées. Trentinian, gouverneur du Soudan, sort de la résidence. Il a revêtu sa tenue d'apparat. Il s'arrête devant Samori et sa suite qu'on a placés face à l'entrée. Le gouverneur tient un papier qu'il lit. Le traducteur répète ses paroles. Samori ne semble pas comprendre. Qu'entend-il au milieu du pathos administratif difficile à interpréter ? Que malgré ses « crimes », la France généreuse va épargner sa vie mais qu'il va être « déporté sur une terre d'Afrique si lointaine qu'on ignorera et son nom et ses forfaits ».
Ainsi parle Trentinian. Samori et son fils Sarankényi-Mori veulent répondre. Déjà le gouverneur leur a tourné le dos et le clairon couvre leurs voix.
Qu'avait voulu déclarer l'almami ? Il semble qu'il se soit élevé contre cette ultime trahison. Pour lui, les propositions qu'il venait d'accepter au moment de sa capture demeuraient valables. Il paraît s'être attendu à retourner, selon les conventions, à Sanankoro. La nouvelle de son exil le pétrifie. Alors que son courage avait étonné jusqu'aux Français, il connaît le désespoir.
Cependant, il conserva sa dignité pour prendre, le jour même, congé des siens. Sans comprendre ce que le silence peut avoir d'éloquent, un Français décrit la scène :
« Samori ne songea à étreindre aucun des siens. Personne ne vint se jeter dans ses bras. Saisissant son haut bâton de commandement, il se dirigea vers la porte du campement. Parvenu au seuil, il s'arrêta, se retourna et leva le bras gauche vers sa smala. Sur ce signe d'adieu, des clameurs retentirent. »
Le soir même de ce 22 décembre, on l'embarque sur le fleuve Sénégal. Le 4 janvier 1899, il parvient à Saint-Louis où on l'interne. Pourtant, on ne le maintient pas dans sa prison, on le montre à travers la ville comme preuve de la suprématie française.
Etre le fauve que l'on promène, l'objet de la curiosité malsaine quand on a été l'almami!
Un soir, on lui apprend que son départ pour l'exil est fixé au 20 janvier, le lendemain. Alors, le conquérant refuse. Dans la nuit, il s'isole un instant. Le garde africain qui dort auprès de lui entend un léger cri. Il se précipite… Il trouve Samori avec son boubou plein de sang. L'almami vient d'essayer de se percer le cúur. Sans doute est-il trop vieux. A un certain âge, faut-il qu'on manque tout et jusqu'à son suicide — extraordinaire pour un musulman ? La plaie est peu profonde. Un médecin le soigne. Il n'a fait que retarder l'exil.
Ce geste a-t-il été provoqué par la perspective de la déportation ? Peut-être pas uniquement. Samori vient, en ce 19 janvier, de recevoir un dernier coup : alors qu'on a donné le choix à certains de ses amis et de ses femmes, la plupart ont refusé de le suivre. Autour de lui, il ne reste personne, sinon la très fidèle Sarankényi Konaté et ceux qui comme Sarankényi-Mori et Moryfindian sont eux aussi condamnés à l'exil. Sa longue vie a-t-elle provoqué si peu de dévouements ? Lui, le meneur de peuples, est-il tellement seul ?
Lorsqu'il embarque, le 5 février, il n'y a que 7 personnes autour de lui… Sept personnes pour le soutenir contre la curiosité qui, de port d'escale en port d'escale, le poursuit.
Sarankényi Konaté et Moryfindian devaient être rapatriés en 1905. Par contre, Sarankényi-Mori, bien qu'absous du meurtre de Braulot, en demeurait tenu plus ou moins responsable. Il vivota jusqu'en 1920 à Libreville, où il s'était fait commerçant. A cette date, il obtint à son tour de rentrer dans son pays où il mourut en 1937.
Mais que dire des derniers jours de Samori ? Comme l'avaient décidé les Français, on l'interna au Gabon dans des conditions matérielles supportables. Son lieu de résidence était la petite île fluviale de Missanga. Il y disposait d'une concession de 20 mètres sur 30 dont il ne devait pas sortir. A part ses compagnons, nul ne parlait sa langue. Tout lui était étranger : le mode de vie, la nourriture, rien qui puisse lui rappeler la merveille des savanes immenses.
Qui aurait résisté ? Il ne résista pas. Le 2 juin 1900, il est mentionné à l'état civil du centre administratif dont dépend Missanga :
« Samori, déporté politique du Soudan, ex-almami de Oussoulou [sic]… domicilié à Ndjolé [lieu de déportation] est décédé à quatre heures trois quarts du soir. »
En annexe, le certificat du médecin militaire attestant que le prisonnier mourut de pneumonie.
De pneumonie ou de désespoir ? Peut-être des deux. Il fut enterré dans l'île même et sa dépouille y demeura jusqu'en 1969, date à laquelle le président de la République de Guinée obtint qu'elle soit transférée dans sa patrie.
Cependant, dernière dérision, l'authenticité du corps transporté jusqu'en Guinée demeure douteuse.
Qui repose dans le mausolée de Tumbo, après avoir fait triomphalement le tour des principales villes guinéennes ? Même si un corps jadis sans gloire y avait été honoré, y a-t-il, nous pardonnent ceux qui révèrent les cimetières, tromperie véritable ? Et sa patrie, l'a-t-il jamais quittée ?
Prononcez le nom de Samori dans toutes les villes et les campagnes que nous avons citées au cours de ce récit. Voici les langues qui s'animent.
Selon les régions, on bénira jusqu'à la trace encore conservée de ses pas ou l'on maudira les rigoles encore marquées dans la terre rouge, rouge de latérite mais rouge aussi du sang qu'il fit injustement couler. Les vieillards, dont les pères l'ont peut-être connu, partent en lutte pour l'attaquer ou le défendre.
Les jeunes, un peu plus détachés, essaient ardemment de comprendre puis prennent parti à leur tour. Qui pourrait être indifférent ? Car :
« Du sable il fit une citadelle et beaucoup de grains de ce sable périrent… »
[Home | Bibliothèque
| Histoire
| Recherche | Aser | Bambara | Bambugu | Bozo Jakhanke | Jalonke | Jawara
Kagoro | Kasonke Konyanke | Koranko | Lele | Maninka | Marka | Mau | Mikifore | Nono
Sankaran | Sidyanka | Soninke | Susu | Toronka | Wasulunka
]
Contact : info@ webmande.site
webMande,
webAfriqa,
webPulaaku,
webFuuta,
webCôte,
webForêt,
webGuinée,
Camp Boiro Memorial,
afriXML, BlogGuinée. © 1997-2013. Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.
Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.